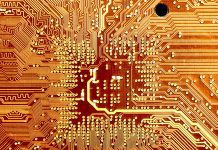Ce texte est la postface d’un recueil de textes réunis par Elina Fronty et paru récemment aux éditions Dehors : « Vivantes. Des femmes qui luttent en Amérique latine » (Paris, 2023).

« Nous ne cherchons pas la propriété de la terre, nous proposons un autre art de l’habiter1. » Ces mots, prononcés par la leader Mapuche Moira Millán, résument bien la portée critique et transformatrice des féminismes latino-américains. Comme le montrent en effet les articles rassemblés dans le présent recueil, ces pensées féministes ne visent pas à trouver une place au sein des structures sociales dominantes (qu’elles soient économiques, politiques, culturelles), mais cherchent bien plutôt à les transformer profondément, ouvrant ainsi la place à d’autres manières d’organiser les rapports sociaux. Pour ce faire, les féministes du Sud commencent par enraciner leur perspective dans les mémoires des luttes collectives inscrites dans les corps des femmes et dans les graphies de leurs territoires. Ensuite, elles effectuent un double mouvement. D’un côté, elles dénoncent le caractère intrinsèquement meurtrier du projet historique d’accumulation matérielle sur lequel s’est bâti l’ordre social dominant. D’un autre côté, elles proposent des alternatives dont la particularité est de voir dans la sphère de la reproduction de la vie (humaine et non humaine) – qui a historiquement été assignée aux femmes – un endroit privilégié dans lequel peuvent se rencontrer des « techniques de sociabilité » en mesure de nous enseigner d’autres façons de se rapporter à l’Autre (femmes, peuples racisés, enfants ou nature), d’organiser l’économie, la politique et les rapports sociaux en général.
Leur l’objectif n’est pas de bâtir des sociétés où les femmes occuperaient la place actuelle des hommes, dans la mesure où cela signifierait de maintenir la logique patriarcale qui établit des hiérarchies entre les genres. Leur appel vise plutôt la construction commune d’une société à partir d’une « conception différente de la vie qui, au lieu d’être fondée sur la domination et les hiérarchies, repose sur le tissu relationnel de la vie2 ». C’est que le féminin est ici pensé à la manière d’une fonction sociale construite au sein de l’histoire des femmes qui se caractérise par l’enracinement, le soin, la relationalité, la pluralité et l’interdépendance.
Dans la première partie de ce texte je reviendrai sur l’épistémologie « enracinée » de ces féminismes. À cela suivra, dans la deuxième partie, une analyse de la manière dont les féministes du Sud ancré interprètent le rapport entre le patriarcat et la colonialité. Dans la troisième partie, nous analyserons la façon dont ces théories emploient la perspective de genre pour mettre en lumière les logiques de domination plus générales qui configurent le système colonial/capitaliste/patriarcal/terricide qui domine à l’heure actuelle. Cela nous permettra d’esquisser dans la dernière partie la proposition avancée par les féminismes du Sud ancré en vue de transformer les structures actuelles de domination patriarcales et néocoloniales.
Dans cet essai, nous allons employer le terme « féminismes du Sud ancré » au lieu de « féminismes latino-américains » ou de « féminismes du Sud Global ». En employant le terme « Sud ancré », nous voulons mettre en lumière l’existence, au sein de ces pensées, d’une rationalité topologique accordant un rôle central à la Terre. En outre, nous souhaitons contrecarrer tout autant l’abstraction que l’extirpation implicite qui sont inscrites dans le terme de « Sud Global ». Les mouvements du sud ont beau tisser des relations transrégionales et transnationales, il n’en demeure pas moins qu’ils se caractérisent par le fait d’avoir comme point de départ et d’arrivée un attachement critique et nourrissant, c’est-à-dire vivant et réciproque, avec leur localité3.
Une épistémologie enracinée
Les féministes du Sud ancré proposent une théorie sociale visant à expliquer les causes des problèmes vécus par l’humanité et à proposer des chemins alternatifs pour les résoudre4. De manière plus profonde, les féministes du Sud ancré conçoivent la perspective de genre comme une porte d’entrée qui permet d’analyser la situation de la société dans son ensemble, tout en mettant en rapport le genre avec d’autres éléments constitutifs de notre scène historique, telles la race, la classe et la destruction de la Terre, et ayant pour objectif la transformation des structures sociales, dans l’optique d’améliorer les conditions de vie de toutes et de tous. Ainsi, la féministe communautaire Julieta Paredes explique que « nous ne voulons pas nous penser contre les hommes, nous voulons nous penser femmes et hommes en rapport avec la communauté5 ».
Pour ce faire, les féministes du Sud ancré enracinent leurs perspectives dans la mémoire collective des luttes des femmes racisées, un geste épistémologique qui implique d’effectuer l’analyse du système dominant à partir de l’extériorité de l’extériorité. La première extériorité est constituée par la perspective des communautés qui ont été historiquement racisées. Il s’agit de l’adoption d’une perspective décoloniale. La seconde extériorité est celle des subjectivités qui ont été infériorisées au sein même des communautés racisées en raison de leur condition de femmes, mais qui ont su développer tout au long de leur histoire des connaissances et des manières d’établir des rapports sociaux dont l’objectif est la régénération de la vie (humaine et non humaine). Il s’agit là de la perspective des damnées parmi les damnés.
Dans le passé se trouvent les sources historiques des formes autonomes que le colonialisme a essayé de détruire et dont il faut se ressaisir pour continuer à exister.
Les féministes du Sud ancré tournent leur attention vers l’histoire (anti)coloniale, parce que « la seule chose que nous avons devant nous c’est le passé6 ». Pour elles, le passé constitue l’avenir dans deux sens : tout d’abord, parce qu’il nous rappelle les formes d’oppression et les violences auxquelles les peuples ont été soumis ; ensuite dans le sens où, se trouvent dans le passé les sources historiques des formes autonomes que le colonialisme a essayé de détruire et dont il faut se ressaisir pour continuer à exister7. 1492 est en effet un moment charnière au sein des féminismes du Sud ancré, car, tout comme l’ont montré les auteurs du projet Modernité-Colonialité/Décolonialité, il donne lieu à de nouvelles identités géospatiales auparavant inexistantes (l’« Amérique », l’« Europe », l’« autochtone », le « blanc », le « noir »8) ; il entraîne l’avènement de l’eurocentrisme en tant que modèle de connaissance qui érige la production de savoir européenne en étalon à partir duquel juger les connaissances et les pratiques non européennes9 ; et, enfin, elle provoque l’expulsion de la plus grande partie de l’humanité vers des zones de sous-humanité10. Il est donc nécessaire de prendre la blessure coloniale – et non une identité figée et immuable – comme point de départ de leurs analyses, dans la mesure où cette expérience a façonné non seulement les structures sociales, mais aussi les subjectivités contemporaines, ainsi que les manières que nous avons de nous rapporter à celles-ci.
Or, l’articulation de l’approche décoloniale avec la perspective du genre, permet aux féministes du Sud ancré de dévoiler des formes d’oppression reproduites au sein des féminismes du Nord, et ce notamment en proposant une critique matérialiste de la catégorie « femme ». Pour les féminismes du Sud ancré – comme pour les féminismes afro-états-uniens – l’emploi de la catégorie « femme » dans les discours féministes du Nord n’est aucunement neutre. L’usage de ce terme sans aucun autre qualificatif constitue bien au contraire un mécanisme épistémologique de pouvoir qui contribue d’un côté à l’occultation de multiples formes de domination auxquelles les femmes non blanches sont soumises et de l’autre à ériger la lutte de femmes blanches en modèle à suivre aux quatre coins du monde.

À la suite de Kimberlé W. Crenshaw, Maria Lugones soutient ainsi que l’usage du terme « femme » sert à occulter la position des femmes de couleur, parce que « les catégories sont construites comme des formes homogènes, elles ont tendance à déterminer ce qui est dominant dans le groupe comme étant la norme ; de telle sorte que « femme » renvoie à femelle, bourgeoise, blanche, hétérosexuelle, « homme » à mâle, bourgeois, blanc, hétérosexuel et « noir » renvoie à mâle, hétérosexuel, noir11 ». Or l’histoire moderne/coloniale montre qu’il n’en va pas de même qu’on soit une « femme-blanche », une « femme-métisse-blanche », une « femme-autochtone » ou une « femme-noire », dans la mesure où la race opère justement comme un marqueur de pouvoir qui sert à différencier les formes d’extraction, sans rétribution du travail humain et du travail de la nature. Par conséquent, la ligne de couleur détermine les types de violences auxquelles les corps genrés sont soumis. La dimension coloniale s’exprime alors par le fait qu’on occulte les violences les plus accrues commises du côté obscur de la ligne de couleur, et que certains privilèges des femmes blanches sont bâtis sur l’oppression de femmes racisées12.
La critique féministe décoloniale nous avertit donc du fait qu’être femme ne nous met pas à l’abri d’occuper la place de la domination patriarcale. De cela résulte l’importance de cultiver une attitude réflexive à l’égard de soi-même par le regard d’autrui. Il ne s’agit donc pas de jouer la concurrence pour le titre de « premières victimes » des structures de domination. Cela reviendrait à reproduire le narcissisme colonial que les féminismes du Sud ancré essaient si obstinément de briser. Bien au contraire, l’argument des féministes du Sud ancré consiste à affirmer qu’il est nécessaire d’effectuer une autolimitation de sa perspective à l’aide d’un ancrage dans un lieu de vie et de lutte. C’est à cette condition qu’il devient possible d’établir une relation authentique avec les autres perspectives, toutes aussi limitées. Ce croisement de perspectives situées permet d’avoir une meilleure intelligence quant à l’ensemble des mécanismes de pouvoir et la manière dont ils opèrent de façon différenciée, bien qu’interconnectée. C’est en s’accrochant à cette ligne que l’on parvient à saisir les singularités et les lignes de continuité qui existent entre les différentes formes de domination.
On introduit ainsi le mot d’ordre « il n’y a qu’une manière d’atteindre la libération féminine, celle des mouvements du Nord ». Voilà contre quoi les féminismes du Sud ancré se révoltent.
D’un autre côté, la dimension coloniale présente dans certains féminismes du Nord s’exprime dans la croyance selon laquelle les femmes racisées doivent suivre le même chemin de libération que les sœurs du Nord pour être sauvées. Cette tendance se retrouve notamment dans le féminisme institutionnel défendu par les agences de coopération internationale et les politiques de développement. Dans un tel état des choses, on persiste à concevoir les femmes racisées comme agents passifs du savoir, parfaitement incapables de comprendre leurs propres problèmes et de formuler des alternatives. On introduit ainsi le monde-Un dans lequel il n’y a qu’une manière d’être véritablement humain13, désormais sous forme du mot d’ordre « il n’y a qu’une manière d’atteindre la libération féminine, celle des mouvements du Nord ». Voilà contre quoi les féminismes du Sud ancré se révoltent.
Mais leur critique va plus loin, dans la mesure où elle vise à montrer l’inefficacité politique de cette manière de mener la lutte. Et force est de se demander comment il pourrait être concevable de lutter contre le patriarcat en employant partout les mêmes outils et les mêmes stratégies, alors que lui-même opère de manières fort différentes selon les géohistoires.
Les féministes du Sud ancré en appellent ainsi à penser et à pratiquer le féminisme de manière décoloniale, c’est-à-dire « en visant l’inclusion de mondes multiples au lieu de leur exclusion14 », tout en reconnaissant par là même le fait que les femmes racisées participent de manière active à leur libération d’après leurs vécus, leurs géohistoires et leurs analyses indépendantes15. Dès lors pour ces pensées, être féministe ne peut signifier agir de telle ou telle manière. Le féminisme décolonial se comprend au contraire à la façon d’une attitude historique partagée contre l’oppression, pouvant et devant s’exprimer de manière différenciée16. L’enracinement de la perspective dans les mémoires des luttes collectives parvient ainsi à introduire la pluralité au sein de l’épistémologie. Dès lors, il devient possible de parler des histoires des femmes : femmes-noires, femmes-autochtones, femmes paysannes, femmes-blanches, femmes-métisses-blanches, etc.
Et c’est grâce à l’interrogation des géohistoires à l’aide d’une approche du genre que les féministes du Sud ancré parviennent à dévoiler des formes de domination patriarcales existant au sein même de leurs peuples, ce qui leur permet d’en montrer le caractère historico-politique, c’est-à-dire susceptible d’être modifié. Concrètement, elles critiquent l’idée, soutenue par les sujets racisés eux-mêmes, que la domination du masculin sur le féminin constitue un signe essentiel de l’identité de la communauté, et qui devrait donc être défendu et maintenu dans un souci de lutte contre le pouvoir colonial. L’intérêt épistémologique réside alors dans le fait que les féministes parviennent à effectuer une critique de la tradition à partir de leur propre tradition. La perspective des femmes devient ainsi l’antidote contre le fétichisme du passé. Mais dans la mesure où la manière de concevoir l’imbrication entre le genre et la race est loin d’être homogène, il existe des positions très diverses au sein de ces féminismes. Nous allons examiner ces positions dans la partie suivante.
Genre et colonialité ou colonialité et genre ?
Au sein des féminismes du Sud ancré on peut identifier deux positions divergentes sur les origines du patriarcat et sur sa relation avec la colonialité. Bon nombre d’autrices soutiennent que le patriarcat n’émerge, dans les sociétés extra-européennes, qu’avec la colonisation. Cette lecture est suggérée principalement par la philosophe argentine María Lugones, qui articule les études menées par la sociologue Oyèrónké Oyěwùmí sur le peuple Oyo des Yoruba au Nigéria17 avec la théorie de la colonialité du pouvoir d’Anibal Quijano. À la suite de la sociologue Nigérienne, Lugones soutient l’idée que le patriarcat n’existait pas dans les sociétés d’Abya Yala d’avant la « Conquête ». Mais à la différence de Oyěwùmí, elle explique que le genre est une catégorie qui a été employée exclusivement pour catégoriser les sujets blancs qui se trouvaient du côté visible de la colonialité. Pour les sujets qui se trouvaient du côté le plus obscur, à savoir le côté colonisé marqué par la race, le genre a opéré à travers son absence, car au lieu d’assigner un genre aux « femelles », elles ont été réduites à la condition d’animales, à un sexe sans genre. Ici, le genre a donc opéré comme mécanisme pour établir une ligne de division entre humains et sous-humains, garantissant l’extraction différenciée du travail sans rémunération. Du côté « clair » se trouvaient les femmes blanches, assujetties en tant que femmes au foyer puis en tant que femmes salariées, tandis que du côté obscur se situaient les femmes racisées, soumises à des régimes d’exploitation extrême, traitées comme des animaux de charge et sujettes à des violences sexuelles inouïes résultant d’un imaginaire qui les réduisait à leur seul sexe.
L’idée selon laquelle le patriarcat n’émerge qu’avec le colonialisme est réfutée par un second grand courant de féminismes du Sud ancré. Cette lignée est composée d’intellectuelles telles que Julieta Paredes, Silvia Rivera-Cusicanqui, Rita Laura Laura Segato et les femmes zapatistes. Pour elles, la première position qui associe les origines du patriarcat dans les pays extra-européens à la colonisation pose deux grands problèmes. Premièrement, cette explication fait abstraction des archives historiques et anthropologiques qui montrent l’existence d’une hiérarchie entre le masculin et le féminin au sein des sociétés précoloniales. Deuxièmement, cette interprétation tend à idéaliser un passé, dont l’existence est plus que douteuse, en jouant de manière inconsciente le jeu du colon qui exotise les peuples non européens. Contre ces interprétations, les autrices du second courant suggèrent plutôt que des formes sociales patriarcales, bien que différentes, existaient déjà dans les sociétés précoloniales. Cette différence s’explique en insistant sur la distinction entre la dualité et le dualisme.

Selon Rita Laura Segato et Silvia Rivera-Cusicanqui, le patriarcat pré-intrusion se caractérise par sa conception duale de la relation entre les genres. Ainsi que l’explique Segato, la dualité est une forme du multiple dans laquelle les termes de la relation sont conçus comme étant complémentaires et ontologiquement complets. Dans un patriarcat fondé sur la dualité, le féminin n’est pas conçu comme étant en défaut par rapport au masculin, et ce malgré l’existence d’une hiérarchie entre les deux termes – le masculin étant perçu comme plus prestigieux que le féminin18. Le patriarcat était bien présent dans ces sociétés, mais « atténué [au regard du patriarcat européen] en raison du parallélisme des genres19 ». Segato nomme ce type de patriarcat un « patriarcat de basse intensité », et considère qu’il perdure toujours dans certains peuples d’Amérique latine, bien qu’il ait été transformé par la « Conquête ».
Selon Julieta Paredes, un « assemblage de patriarcats » (entroncamiento de patriarcados) s’opère au moment de l’intrusion coloniale ; le patriarcat constituant le maillon ayant permis la coopération des colonisés eux-mêmes avec l’entreprise coloniale20. Selon cette lecture, les structures patriarcales existantes dans les sociétés précoloniales ont profité à la « stratégie délibérée des autorités [coloniales] pour répandre la terreur, annihiler les résistances, réduire au silence des communautés entières et dresser les gens les uns contre les autres21 ». Cette stratégie a consisté à faire des hommes amérindiens les interlocuteurs privilégiés des colonisateurs, donnant lieu à une « alliance tacite entre les mâles de la société dominée et les mâles de la société conquérante22 ».
Les hommes racisés ont à la fois été émasculés par le pouvoir colonial et catapultés dans leur position de pouvoir à l’intérieur de leur communauté.
Pourquoi les hommes autochtones se sont-ils laissés capturer plus facilement que les femmes ? Loin de donner une réponse essentialiste, les féministes du Sud ancré répondent en se tournant vers la longue histoire de la division sociale du travail. Alors que les tâches liées au déplacement, comme la chasse, la guerre ou les négociations avec d’autres peuples étaient généralement attribuées aux hommes, les femmes étaient, elles plus souvent en charge des travaux attachés au lieu, comme l’agriculture, la préparation des aliments ou encore le tissage23. C’est ce partage qui aurait rendu les hommes plus vulnérables à la capture coloniale. Avec l’assemblage des patriarcats, les hommes racisés ont à la fois été émasculés par le pouvoir colonial (car leur assujettissement au colonisateur « leur a montré toute la relativité de leur position masculine24 »), et catapultés dans leur position de pouvoir à l’intérieur de leur communauté (car leur rôle de négociateurs avec les colonisateurs « leur a donné un accès privilégié aux ressources et aux connaissances sur le monde du pouvoir25 »). L’assemblage de patriarcats, effectué dans le cadre du projet historique d’accumulation de capital, a ainsi donné lieu à une nouvelle manière d’établir et de concevoir les rapports entre le féminin et le masculin.
Une transformation radicale se produit donc au moment de l’intrusion coloniale, donnant cette fois lieu à un « patriarcat de haute intensité8 ». La forme de la relation cesse d’être celle de la dualité, et se meut en un dualisme, lequel présuppose une logique binaire. Comme l’explique Segato, « [d]ans le monde binarisé de la modernité, l’autre de l’Un est destitué de sa plénitude ontologique, réduit à remplir la fonction d’alter, l’autre de l’Un comme représentant et référent de la totalité26 ». Dès lors, les corps et les activités que l’on considère appartenir à la sphère féminine cessent d’être perçues comme étant complémentaires à celles de la sphère masculine, pour devenir déficientes, incomplètes et dénuées de rationalité. C’est en outre cette logique binaire qui est à la base de l’expulsion des sphères politiques des processus de reproduction de la vie qui – comme l’ont bien montré Maria Mies et Silvia Federici – commencent à être identifiées au domaine de l’État et à la sphère du marché. Dénués de mécanismes de protection sociale, les corps féminisés sont dorénavant exposés à des formes de violence, phénomène social nécessaire à la production de plus-value.
Malgré les divergences qui séparent les autrices des deux courants, on peut constater qu’elles se rejoignent dans l’idée partagée que le système colonial est intrinsèquement patriarcal. De ce point de vue, l’assemblage du genre et de la race est non seulement nécessaire à l’accumulation du capital, parce qu’il permet de justifier l’extraction non rémunérée du travail, des savoirs et des territoires colonisés, mais plus encore parce qu’il rend possible l’implication des mâles dominés dans la colonisation de leur propre peuple et, donc, d’eux-mêmes.
Deux raisons nous conduisent à penser que la position des féministes affirmant que le patriarcat existait dans les sociétés non-européennes bien avant 1492 est plus porteuse pour un projet décolonial. Premièrement, cette lecture traite les sujets colonisés non pas comme de simples victimes, mais comme des agents politiques à part entière. Deuxièmement, elle évite la réification, voire la fétichisation du passé, faisant advenir à la conscience collective la partie la plus honteuse du passé, celle de la servitude volontaire. Ainsi, Paredes explique que décoloniser le genre « signifie récupérer la mémoire des luttes de nos arrière-grands-mères contre un patriarcat qui existait avant même l’invasion coloniale27 ». Cette mémoire, les féministes du Sud ancré la trouvent inscrite dans leurs corps et dans les graphies de la terre. C’est pourquoi nous allons examiner maintenant la manière dont les féministes du Sud ancré analysent l’histoire à partir de leurs corps-territoires.
La violence commise dans les corps-territoires des femmes racisées
Les auteurs du tournant décolonial ont aussi bien saisi l’importance de la production des savoirs eurocentrés que l’occultation de connaissances autochtones dans l’asservissement des peuples dominés. Les féministes du Sud ancré élargissent la compréhension de ces mécanismes de domination en montrant le rôle déterminant que joue la violence contre les femmes racisées dans le processus de conquête et de colonisation et ce jusqu’à ce jour. La thèse centrale est que l’exploitation des femmes et des entités féminisées (telles la nature, les corps des enfants ou le corps de personnes de genre non hétéronormé) n’est pas une forme de domination parmi d’autres. Bien plutôt, le patriarcat constitue « la base qui fonde toutes les inégalités et les expropriations de valeur qui construisent l’édifice de tous les pouvoirs – économique, politique, intellectuel, culturel, etc.28 ». C’est dans les corps féminisés, que l’humanité a appris et continue à apprendre l’infériorisation de l’Autre, sa domination, et, à l’ère capitaliste/coloniale, sa chosification. Selon ces autrices, la violence effectuée contre les corps féminisés a au moins deux fonctions : elle sert à produire une subjectivité psychopathique, insensible à la douleur d’autrui et capable d’effectuer des actes de cruauté contre l’ensemble du vivant, ensuite cette violence constitue une arme de guerre pour déposséder des peuples entiers de leurs territoires.
Selon Segato, le patriarcat opère à travers un « mandat de masculinité », qui exige de la part des hommes de prouver continuellement leur masculinité, notamment en exprimant leur pouvoir sur le corps des femmes. La violence contre les femmes opère ici à la manière d’un énoncé qui transmet un message selon deux axes. Sur l’axe vertical, le message s’adresse à la victime, l’obligeant à se comporter d’une manière déterminée, à « normaliser » ses conduites – ne pas s’habiller d’une certaine manière, ne pas se déplacer dans certains endroits à certaines heures, etc. Sur l’axe horizontal, le message s’adresse aux pairs masculins (présents ou absents de la scène violente) en réaffirmant l’appartenance à la corporation masculine et en exprimant l’exercice d’une souveraineté sur le corps violenté.
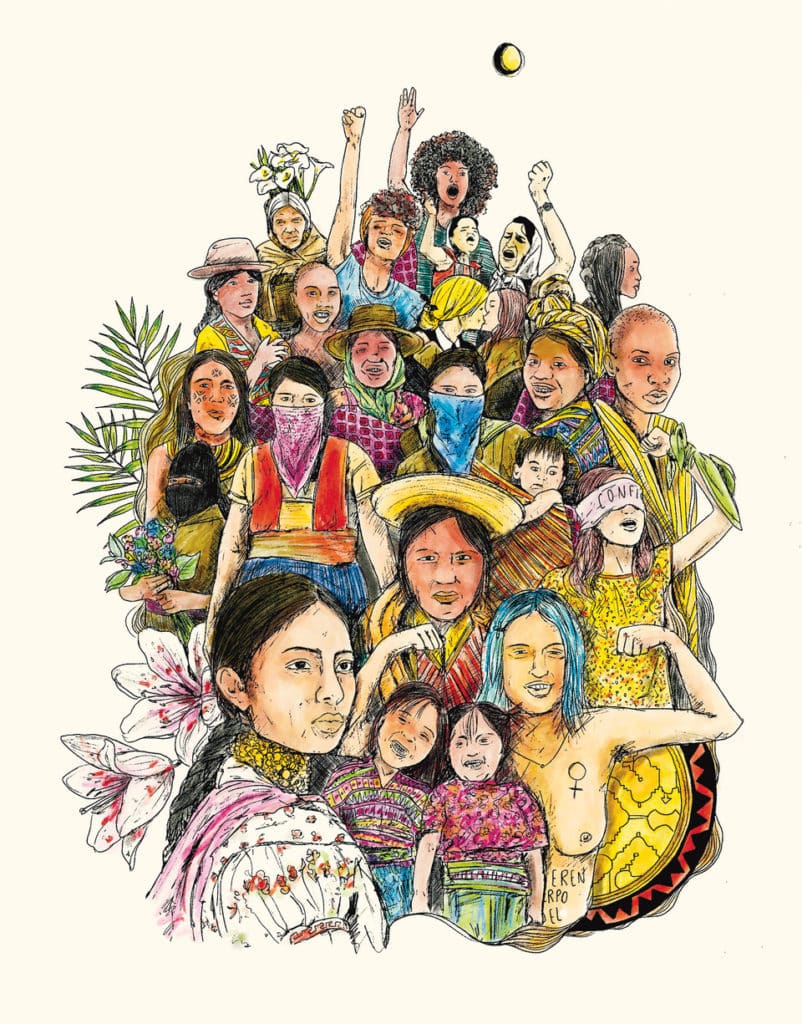
Bien que le mandat de masculinité opère dans toutes les sociétés patriarcales, la violence contre les femmes offre la particularité d’être employée comme arme de guerre dans des contextes comme celui de l’Amérique latine, où la guerre de conquête n’a jamais pris fin. Le viol, l’assassinat ou encore le démembrement des corps féminins sont des pratiques récurrentes dont usent les groupes armés pour exprimer leur contrôle face aux autres groupes ennemis29. Ces groupes armés ont bien entendu toujours des intérêts économiques, dans la mesure où ils agissent ou bien en tant que « défenseurs » des intérêts des entreprises nationales ou transnationales de l’économie légale, ou bien en tant que bras armés des économies illégales.
Mais cette violence genrée ne s’adresse pas exclusivement aux autres groupes armés. Elle est de plus employée comme moyen pour déchirer le tissu communautaire des peuples noirs, paysans ou amérindiens, afin de s’approprier leurs terres et détourner leur force de travail vers l’économie extractiviste. D’un côté, ces violences agissent en employant le mandat de masculinité, dans la mesure où elles éveillent chez les hommes des communautés le sentiment d’avoir été incapables de protéger « leurs femmes », fonctionnant ainsi comme une manière de les émasculer et de déstructurer les rapports sociaux. D’un autre côté, cette violence engendre de la terreur dans les communautés concernées, les contraignant à abandonner leur terre.
Pour comprendre cela, il faut se rappeler qu’historiquement, les femmes noires, autochtones et paysannes ont toujours eu en Amérique latine la tâche vitale de tisser, de préserver et de transmettre les pratiques et les savoirs nécessaires à la survivance de leur peuple. Pensons par exemple au rôle qu’elles jouent dans la préservation des semences, la transmission de leur langue, l’apprentissage des formes de tissage à travers lequel les peuples racontent leur histoire. S’attaquer à leur corps constitue en conséquence une manière d’interrompre les modes de vie de ces peuples. La violence contre les corps féminisés devient le mécanisme par excellence de l’accumulation par dépossession. Considérée sous cet angle, la violence de genre a beau s’effectuer dans le corps des femmes, elle ne s’adresse pas pour autant en premier lieu à celles-ci.
C’est la manière de se rapporter au tissu de la vie qui détermine le caractère patriarcal ou non d’un sujet, et non le fait de s’identifier comme femme, homme ou personne non binaire.
Cette violence fait partie de ce que Segato appelle les « pédagogies de la cruauté ». Par ce terme, l’anthropologue argentine vise à désigner « tous les actes et les pratiques qui apprennent, habituent et programment les sujets à transmuter le vivant et sa vitalité en choses30 ». On produit ainsi une subjectivité qui se sent « comme étant extérieure à la vie, pour dominer à partir d’une extériorité, coloniser, spolier et piller31 ». La violence contre les femmes n’est donc pas une pratique dont les effets se borneraient aux seules femmes, elle est bien plutôt un moyen pour produire une subjectivité insensible à la souffrance d’autrui (peuples racisés, femmes, enfants et la Terre). L’exploitation et la destruction du sujet deviennent possibles seulement en produisant chez lui le sentiment d’être séparé du tissu de la vie et l’impression que l’Autre est réduit à l’état de simple objet. « [A]vec des sujets brisés et vulnérables, le monde de choses s’impose : […] la nature chose, le corps chose, les personnes choses »32. Segato peut ainsi conclure que la subjectivité patriarcale à l’ère de la colonialité a une « structure psychopathique dont la pulsion prédominante est instrumentale au lieu d’être relationnelle8. » C’est la manière de se rapporter au tissu de la vie qui détermine le caractère patriarcal ou non d’un sujet, et non le fait de s’identifier comme femme, homme ou personne non binaire. Agir de manière patriarcale consiste justement en cela : une action, une attitude spécifique face à l’autre et à soi-même, c’est-à-dire remplir une fonction sociale.
Dès lors, la blessure coloniale ne doit pas être comprise comme une blessure infligée exclusivement aux corps humains (si l’on entend par « corps » l’unité psychophysique d’un sujet), mais bien au tissu du vivant dans son entièreté, ce qui explique l’importance de la notion de terricide formulée par Moira Millán. Par ce terme, la leader Mapuche désigne le crime d’assassinat de la Terre commis par les États-nation et par les entreprises nationales et transnationales. Selon Millán, ce crime a un impact sur trois dimensions de l’existence. Premièrement, sur le plan matériel, car on s’attaque aux rivières, aux montagnes et aux personnes humaines. Deuxièmement, sur le plan perceptif, car les forces qui composent l’essence de la vie se trouvent dans les espaces naturels que les entreprises détruisent. Enfin, sur le plan de la culture des peuples opprimés, car l’extractivisme les prive de leur milieu de vie33. L’attachement à la Terre doit ici être compris de manière relationnelle. D’un côté, la cruauté déployée contre les femmes racisées entrave la transmission des savoirs qui contribuent à la régénération de la Terre et de l’autre, les économies extractivistes qui empoisonnent les rivières, polluent l’air, rendent malades les sols et détruisent les forêts, empoisonnent, rendent malades et détruisent les corps humains. S’il en est ainsi, c’est que le corps humain n’est pas simplement dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la Terre, mais il est Terre.
La notion de « corps-territoire » avancée par les féministes du Sud ancré permet justement d’exprimer l’unité vivante, voire historique, territoire-corps-Terre. Ce terme désigne à la fois le caractère relationnel et interdépendant du corps humain avec l’endroit qu’il habite, et, de manière particulière, le fait que le corps des femmes racisées a historiquement opéré comme lieu d’expression du pouvoir patriarcal. On trouve ici l’expression de l’ontologie relationnelle de ces peuples qui ont appris à sentir la nature comme un tissu auquel l’être humain appartient et qui le compose dans son identité34. Dans ce sens, le terme montre que la voie de la libération ne peut être atteinte qu’en libérant la Terre.
Grâce à l’enracinement dans la mémoire des corps-territoires, les féminismes du Sud ancré parviennent à dévoiler le lien matériel, direct et étroit qui existe entre l’économie concentrée sur les matières premières des pays du Sud, la destruction environnementale, les violences commises contre les corps racisées et féminisés et la reproduction d’une économie (post)industrielle dans les pays du Nord. Ce faisant, elles font apparaître sous un nouveau jour la formule féministe d’origine marxiste selon laquelle « [l]a reproduction est la condition transcendantale de la production35 ».
En même temps, le lien que les féministes d’Abya Yala établissent entre la destruction de la Terre et l’exploitation des femmes racisées les rapprochent des analyses d’écoféministes comme Vandana Shiva et Maria Mies. Ce lien n’a rien d’étonnant, dès lors que l’on se rappelle que ces deux autrices ancrent leurs analyses dans l’expérience des femmes rurales en Inde. Ces deux lignées du féminisme nous permettent ainsi de comprendre que le patriarcat-colonial doit être compris à la manière d’un système de relations sociales fondé sur la domination (peu importe qu’elle soit exercée par des hommes ou par des femmes) et l’exclusion de l’Autre. Ces analyses nous permettent ainsi de comprendre que la blessure coloniale est une blessure effectuée dans le tissu de la vie, qui demande en conséquence des stratégies de transformation relationnelle.
« Domestiquer la politique » : la proposition des féminismes du Sud
Les féministes du Sud ancré affirment que la clé pour sortir de la boucle infernale des violences patriarcale, coloniale, capitaliste et terricide se trouve dans l’histoire des femmes et qu’elle doit en conséquence prendre son essor dans la sphère de la reproduction historiquement assignée aux femmes. Cela signifie que la division sexuelle et raciale du travail n’a pas seulement opéré à la manière d’un vecteur de domination. Grâce à leur intelligence politique et au déploiement des stratégies collectives de survivance, les femmes du Sud ancré sont parvenues à développer des « techniques de sociabilité » spécifiques, ainsi que des « styles de négociation, de représentation et de gestion36 » non patriarcaux, qui constituent de véritables alternatives aux logiques de la politique étatico-centrée et de l’économie de la valeur d’échange. Tel que l’explique Segato, le projet est celui de « domestiquer la sphère politique » au lieu de « politiser la sphère domestique ». Selon Segato, la voie qu’elle propose, n’est pas celle d’une transposition « de la sphère domestique à la sphère publique, [ce n’est pas rechercher] l’assimilation [du domestique] par la grammaire du public pour atteindre un certain degré de politisation. [Elle propose] de creuser la voie inverse : « domestiquer la politique », la débureaucratiser, l’humaniser, grâce à une domesticité repolitisée37 ».
Un tel projet implique, inévitablement, un processus de désarticulation du mandat de masculinité, en cherchant à rebâtir les relations sociales sur six principes :
1. le soin des conditions matérielles et symboliques nécessaires à la reproduction de la vie humaine et non humaine ; 2. la conscience de l’inter-dépendance entre humains et non-humains, sans pour autant affirmer une ontologie plate ; 3. la réciprocité ; 4. la spiritualité ; 5. l’enracinement au milieu de vie ; et 6. l’affirmation de la pluralité comme fait de vie, nécessaire au savoir, à la politique et à l’économie38.
Le chemin pour ce faire n’est pas celui de la révolution visant à remplacer d’un seul coup une totalité par une autre39. De manière similaire au poststructuralisme, les féministes du Sud ancré considèrent que la transformation de la matrice coloniale et patriarcale doit venir d’un mouvement sans doute plus modeste, mais plus réaliste et efficace, qui consiste à « travailler sur les écarts et les fractures de la réalité sociale existante » dans le but de retrouver « les traces abandonnées d’une histoire différente40 ». La clé se trouve donc dans l’analyse des pratiques journalières, situées et existantes, en sélectionnant les éléments authentiquement transformateurs au sein de celles-ci et en saisissant les « “horizons [alternatifs] de désir” des hommes et des femmes qui jour après jour transforment et s’attachent à transformer leur réalité sociale, située et concrète41 ». La proposition des féministes du Sud peut donc être caractérisée comme une authentique politique du quotidien.

Prêter attention à ces pratiques journalières nous permet de décoloniser notre imagination et nos espoirs, parce qu’ainsi se matérialise le rêve d’un changement, qui devient alors crédible et désirable. Bien entendu, une telle politique du quotidien en appelle à un usage décolonial de la théorie pour investir le terrain des luttes sociales. Ici, la pratique décoloniale de la théorie consisterait à « identifier quelles sont [les] caractéristiques et [les] mécanismes de production et reproduction » des modes de vie ou des projets historiques axés sur l’accumulation de relations existantes, dans le passé comme dans le présent, mais ayant été occultés par les dispositifs de pouvoir, ce qui rend possible de les désigner grâce à un vocabulaire qui exprime leur valeur.
En partant d’une analyse des institutions sociales et des luttes communautaires amérindiennes (notamment en Bolivie, au Mexique et au Guatemala), Gutiérrez-Aguilar et Salázar Lohman proposent une théorie de la valeur d’usage comme une forme de reconstruction du tissu relationnel de la vie. Ici, la production de la valeur d’usage – prédominante par rapport à la production de la valeur d’échange – ne se borne pas à la production des biens matériels pour la consommation et la satisfaction des besoins purement biologiques. Bien plutôt, elle est une manière de tisser des rapports entre les membres de la communauté (humains et non-humains) en satisfaisant leurs besoins matériels et symboliques. Ces pratiques sont fondées sur la réciprocité et le soin de et avec la terre qui nous nourrit et qui doit en retour être nourrie par les humains. C’est pourquoi ces pratiques impliquent que le cœur de la production économique et des décisions politiques soit la régénération de la vie. Ce faisant, ces théories suggèrent un critère de justice matérielle interspécifique – à savoir la régénération des cycles naturels – à partir duquel il devient possible d’organiser les institutions humaines et les relations sociales.
Le projet des féminismes du Sud ancré est un projet d’autonomisation politique et de ré-humanisation qui exige de faire histoire des membres d’une communauté et de reconnaître la Terre comme agent historique
Ainsi la dimension régénératrice de la matérialité vivante qui forme la Terre s’articule avec la problématique des mécanismes décisionnels et participatifs. En effet, l’un des grands efforts de ces théories consiste à réfléchir aux moyens de régénérer la richesse (entendue comme valeur d’usage) qui contribuent simultanément à la reconstitution du tissu social et à l’autonomisation politique des peuples, entendue comme capacité à prendre des décisions. C’est en ce sens que les autrices affirment que la « politique au féminin » requiert des pratiques, des connaissances et des espaces où convergent les démonopolisations de l’accès à la richesse et du droit à décider. Posés en termes positifs, nous pourrions dire que le projet des féminismes du Sud ancré consiste à créer des modes polycentriques42 d’organisation du social, tant au niveau de la production des biens pour soutenir la vie que de la prise de décisions. Il s’agit d’un projet d’autonomisation politique et de ré-humanisation qui exige d’une part d’activer la puissance politique de faire histoire des membres d’une communauté et, d’autre part, de reconnaître la Terre comme agent historique devant participer à l’organisation sociale. Nous nous trouvons face à des pensées qui constituent des véritables oikonomia.
Conclusion
Les féminismes du Sud ancré nous invitent à changer de perspective, à construire des formes sociales où les relations sont à la fois le point de départ et la fin poursuivie. Or, la construction d’une telle perspective ne suppose pas qu’elle soit créée à partir de rien. Elle existe déjà dans l’histoire des communautés damnées par le colonialisme, qui sont tout de même parvenues à réinventer leurs modes de vie. Un tel regard ne réifie pas le passé, mais cherche à activer ce qu’Eboussi Boulaga appelle une « mémoire vigilante ». Il s’agit d’une compréhension historique des causes des problèmes actuels et d’une sélection réfléchie des outils, existant dans chaque tradition, capable de contribuer à la transformation des structures génératrices d’injustices. Ainsi, loin de constituer quelque simple idée utopique, la proposition de la politique au féminin est ancrée dans l’histoire des femmes qui « non par essence, mais par expérience historique accumulée » ont développé un type singulier d’« attention », « d’administration des ressources disponibles » et de « résolution de conflits »43. Les féministes latino-américaines rejoignent sur ce point la conception des éco-féministes Vandana Shiva et Maria Mies selon lesquelles les femmes du Sud ne doivent pas être comprises comme de simples victimes du système. Bien au contraire, et dans la mesure où leurs pensées n’ont pas encore été complètement dépossédées et colonisées, elles sont en mesure de nous enseigner des pratiques, des savoirs et des paradigmes alternatifs permettant de soigner le tissu de la vie44.
Nous pouvons ainsi affirmer qu’une épistémè différente de celle moderne est en train d’émerger dans les féminismes du Sud. Au lieu d’être axée sur la figure de l’Homme, elle est axée sur la dimension relationnelle du corps-territoire, toujours collectif, faisceau de rapports historiques entre l’humain et le reste de la Terre. Le fait que ces perspectives soient construites à partir non seulement de la communauté humaine, mais aussi de la communauté qui se produit avec les non-humains (et les entités complexes comme les montagnes, rivières, forêts…), et les milieux de vie, nous permet d’affirmer qu’il s’agit d’une épistémè productrice d’une rationalité topologique. C’est pourquoi nous pouvons considérer que la politique au féminin est un paradigme-autre de la politique. Ce paradigme ouvre la porte à une politique de la Terre habitée qui ne cesse de nous rappeler ce que les grands-mères afro-colombiennes enseignent depuis longtemps : « que le territoire est joie et tristesse, que le territoire est la vie et la vie n’a pas de prix, que le territoire est la dignité et celle-ci n’a pas de prix45. »
Image d’accueil : Rassemblement, lors du premier vote au Sénat pour le droit à l’avortement en Argentine, Anita Pouchard Serra, Buenos Aires, 11 décembre 2020.
Notes
- Moira Millán cité par Verónica Gago, La potencia feminista : O el deseo de cambiarlo todo, 2019, p. 109.[↩]
- Arturo Escobar, Otro posible es posible : Caminando hacia las transiciones desde Abya Yala/Afro/Latino-América, Bogota, Desde Abajo, 2018, p. 32.[↩]
- Nous remercions le philosophe belge Marc Maesschalck d’avoir attiré notre attention sur ce sujet, et de nous avoir suggéré l’usage du terme « Sud ancré ».[↩]
- Adriana Guzmán et Julieta Paredes, « Feminismo comunitario » (entretien vidéo consultable sur Internet).[↩]
- Julieta Paredes, Hilando fino : Desde el feminismo comunitario (2008), Mexico, El Rebozo, 2013, p. 79.[↩]
- Adriana Guzmán, Julieta Paredes, « Feminismo comunitario », op. cit.[↩]
- Il s’agit là de ce que Aníbal Quijano appelle le « retour du futur », voir Rita Laura Segato, « La perspective de la colonialité du pouvoir et le tournant décolonial », dans Les Gauches du xxi e siècle. Un dialogue Nord Sud, Paris, Le Bord de l’eau, 2016.[↩]
- Rita Laura Segato, ibid.[↩][↩][↩]
- Une perspective cognitive partagée par les Européens et par tous ceux qui sont éduqués selon ce modèle.[↩]
- Nelson Maldonado-Torres, « On the Coloniality of Being : Contributions to the development of a concept », Cultural Studies, vol. 21, n° 2‑3, 2007.[↩]
- María Lugones, « Colonialidad y género », Tabula Rasa, n° 9, 2008, p. 82.[↩]
- Les femmes zapatistes écrivent : « Et sachez bien que ce n’était pas toujours un homme qui m’exploitait, qui me volait […]. Il y avait aussi beaucoup de femmes qui me traitaient ainsi. Et qui le font toujours. », voir dans ce livre : « Paroles des femmes zapatistes… », p. 84.[↩]
- Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence Africaine, 1955.[↩]
- Arturo Escobar, Autonomie et design. La réalisation de la communalité, Toulouse, Europhilosophie, 2020 (consultable sur Internet).[↩]
- Rita Laura Segato, « Que cada pueblo teja los hilos de su historia: La colonialidad legislativa de los salvadores de la infancia indígena », dans La Crítica de la colonialidad en ocho ensayos, Buenos Aires, Prometeo, 2013.[↩]
- Julieta Paredes, Hilando fino desde el feminismo comunitario, op. cit., p. 76.[↩]
- Oyèrónke Oyěwùmí, The Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender Discourses, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997.[↩]
- Rita Laura Segato, « Género y colonialidad: Del patriarcado comunitario de baja intensidad al patriarcado colonial moderno de alta intensidad », dans La Crítica de la colonialidad en ocho ensayos, op. cit. Voir aussi Silvia Rivera cusicanqui, Un mundo ch’ixi es posible: Ensayos desde un presente en crisis, Buenos Aires, Tinta Limón, 2018, p. 40.[↩]
- Silvia Rivera Cusicanqui, « Un llamado a repolitizar la vida cotidiana », art. cit.[↩]
- Julieta Paredes, Hilando fino desde el feminismo comunitario, op. cit.[↩]
- Silvia Federici, Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive (2004), Marseille/Genève/Paris, Senonevero/Entremonde, 2014, p. 367.[↩]
- Silvia Rivera cusicanqui, « Un llamado a repolitizar la vida cotidiana », art. cit.[↩]
- Rita Laura Segato, La Guerra contra las mujeres, Madrid, Traficantes de Sueños, 2016, p. 115.[↩]
- Rita Laura Segato, « Género y colonialidad: del patriarcado comunitario de baja intensidad al patriarcado colonial moderno de alta intensidad », art. cit., p. 87.[↩]
- Rita Laura Segato, ibid., p. 86.[↩]
- Rita Laura Segato, ibid., p. 93‑94.[↩]
- Rita Laura Segato, ibid., p. 71.[↩]
- Rita Laura Segato, La Guerra contra las mujeres, op. cit., p. 19.[↩]
- Colectivo otras negras… y ¡feministas!, Elba Mercedes Palacios, María Campo, et al., Feminicidio y acumulación de capital, Quito, Abya Yala, 2019.[↩]
- Rita Laura Segato, Contra-pedagogías de la crueldad, op. cit., p. 11.[↩]
- Rita Laura Segato, La Guerra contra las mujeres, op. cit., p. 80.[↩]
- Rita Laura Segato, ibid., p. 30.[↩]
- Moira Millán, « Moira Millán y el concepto de Terricidio », 2020, vidéo consultable sur Internet[↩]
- Arturo Escobar, Sentir-penser avec la Terre. L’écologie au-délà de l’Occident, Paris, Seuil, 2018.[↩]
- Verónica Gago, La Potencia feminista : O el deseo de cambiarlo todo, op. cit., p. 126.[↩]
- Rita Laura Segato, La Guerra contra las mujeres, op. cit., p. 25.[↩]
- Rita Laura Segato, « A Manifesto in Four Themes », Critical Times, vol. 1, n° 1, 2018, p. 204 sq.[↩]
- Lina Alvarez Villarreal, « Œconomies de la Terre habitée. Une perspective décoloniale sur la physiocratie », Carnets du CPDR, n° 178, 2021, p. 11.[↩]
- Raquel Gutiérrez Aguilar, Huáscar Salazar Lohman, « Reproducción comunitaria de la vida : Pensando la transformación social en el presente », dans Producir lo común. Entramados comunitarios y luchas por la vida : El Apantle, revista de estudios comunitarios, Madrid, Traficantes de Sueños, 2019.[↩]
- Rita Laura Segato, La Crítica de la colonialidad en ocho ensayos, op. cit., p. 57.[↩]
- Raquel Gutiérrez Aguilar, Huáscar Salazar Lohman, « Reproducción comunitaria de la vida : Pensando la transformación social en el presente », art. cit., p. 52.[↩]
- Nous empruntons le terme à Ostrom Elinor, « Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems », The American Economic Review, vol. 100, n° 3, 2010.[↩]
- Rita Laura Segato, Contra-pedagogías de la crueldad, op. cit., p. 67.[↩]
- Vandana Shiva, Staying Alive : Women, Ecology and Survival in India, op. cit., p. 45.[↩]
- Francia Márquez, « Voluntariado », Francia Márquez Mina, 2021 (consultable sur Internet).[↩]