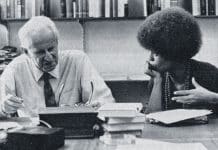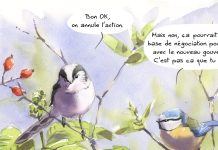Celles qui pleurent leurs maris défunts ou leurs enfants mort-nés ne font pas que pleurer. Elles luttent, aussi. Beaucoup pour les autres. Et enfin, pour elles. Durant l’année 2024, plusieurs femmes de victimes des essais nucléaires à Maohi Nui (nom de la Polynésie Française) se sont retrouvées devant des tribunaux administratifs dans différentes villes de France1. Aucune de ces procédures n’a jusqu’à présent abouti. Mais, avec leurs avocat·es, les veuves tiennent le coup : la multiplication des audiences pour être reconnues « victime par ricochet », statut qui désigne celles et ceux qui ont souffert et souffrent encore de la situation et de la perte d’un être cher, est une nouvelle tentative vers la modification de l’actuelle loi de réparation – la loi Morin. Ce statut a déjà été concédé aux victimes de l’amiante, d’accidents médicaux ou d’attentats. Alors, qu’attend le législateur ?, se demandent celles dont j’ai recueilli la parole.
Entre 1960 et 1996, la France a effectué 210 essais nucléaires, 17 au Sahara algérien, ancienne colonie française, et 193 en Polynésie, toujours « territoire d’outre-mer » de la France. De sa maison du Lot, Arlette Dellac, 83 ans et une voix encore pleine d’énergie, raconte. Gérard, son mari, ne peut plus parler. « Il est encore vivant mais gravement touché par une maladie dégénérative vasculaire », dit-elle en s’excusant de devoir s’interrompre durant l’entretien pour lui ouvrir la porte des cabinets. « Le 13 février 1960, la première bombe française explose en Algérie. Il est réquisitionné, lui le jeune appelé de 22 ans, et, sous les ordres d’un officier, il plante le drapeau français dans le cratère, au point zéro. La zone est si contaminée qu’après 24 heures sous la douche de décontamination, le compte Geiger crépite toujours quand on le passe sur les cheveux ! ». L’appelé rentre très vite dans le Lot, rencontre Arlette, devient plombier zingueur. En 1991, il contracte un cancer de la peau, qui lui vaudra 38 opérations au visage.
Des dizaines d’articles, livres, rapports, émissions de radio ou documentaires ont raconté l’histoire de Gérard Dellac et celle des milliers d’autres irradié·es par les campagnes d’essais, en Algérie et, surtout, à Maohi Nui2. Aujourd’hui, alors que les survivants se font de plus en plus rares, leurs femmes sortent de l’invisibilité. Il n’en a pas toujours été ainsi : elles se sont d’abord activées dans l’ombre, épaulant leurs maris tout au long de cette bataille fastidieuse de l’obtention du statut de victimes. Souvent seules, lorsque leurs conjoints ont été emportés par les cancers, elles ont affronté ce que l’expert et lanceur d’alerte Bruno Barillot appelait le « négationnisme nucléaire » : le mensonge3 puis l’obstruction d’État, le secret-défense jusqu’en 2021 et l’ouverture de 80% des archives, les officiers qui refusent de parler, l’absence de volonté politique, des autorités françaises qui prétendent durant 50 ans, contrairement à d’autres pays, que leurs expérimentations étaient « propres » et ne représentaient aucun problème pour la santé.

Faire leur la bataille des maris
Au milieu des années 1990, alors même que la dernière campagne de tirs à Maohi Nui orchestrée par Jacques Chirac a fait l’objet de protestations partout dans le monde [voir l’entretien avec Hinamoeura Morgant-Cross], l’omerta tombe. D’anciens appelés racontent publiquement leurs maladies contractées dix, vingt ou trente ans après être revenus en France. C’est à cette époque qu’Arlette et Gérard montent au front : « On a d’abord été devant les tribunaux militaires pour réclamer une pension ». Une dermatologue avait fait le lien entre son cancer de la peau et la descente dans le cratère atomique en 1960. « Le tribunal d’Albi nous répond que ‘l’irradiation est une circonstance aggravante comme le soleil’ et que ‘l’Armée n’est pas responsable’, alors on fait appel ! On va devant les juges à Toulouse, à Nantes, jusqu’au Conseil d’État ! ». Parallèlement, Arlette et Gérard lancent un appel à témoignage dans le journal L’Ancien d’Algérie et commencent à rencontrer d’autres jeunes appelés qui souffrent de pathologies cancéreuses, mais aussi cardiaques.
Cette médiatisation prend un tour nouveau avec la création de deux associations en 2001. L’Association des Vétérans des Essais Nucléaires (AVEN) d’une part, dont Arlette est l’une des instigatrices. Parmi les fondateurs, le lanceur d’alerte Bruno Barrillot mais aussi le docteur Jean-Louis Valatx, ancien médecin chef de l’Armée. À plusieurs milliers de kilomètres, à Maohi Nui, une association jumelle voit le jour la même année, Moruruoa e Tatou. La défense des victimes civiles et militaires s’organise alors grâce à ces deux associations, avec l’appui du cabinet d’avocats Teissonnière et Topaloff, spécialisé dans les maladies professionnelles, ainsi que de médecins alliés. « Je vais rapidement aider à constituer les dossiers, pour réunir les preuves devant les tribunaux, raconte Arlette. En 2002, je reçois la page 14 du livret médical de mon mari, l’Armée n’a pas jugé bon de m’envoyer le reste. J’apprends qu’il a reçu la dose de 15 millisieverts (mSv) en quelques minutes alors que la dose à ne pas dépasser est de 1 mSv par an. »
« Mon mari est décédé en 1998 d’un cancer foudroyant. Il avait 47 ans. Il avait passé 10 mois sur la base d’Hao lorsqu’il avait 20 ans, en 1971, lors de son service militaire. »
Françoise Grellier
Arlette a, pourrait-on dire, de la chance : « lorsqu’on demandait les dossiers médicaux, les archives militaires répondaient bien souvent qu’elles ne possédaient aucun document ». À l’AVEN, de nombreuses femmes s’engagent à des postes de responsabilité. C’est le cas d’Anne Tardieu, longtemps présidente de l’antenne Finistère, qui s’occupera particulièrement de l’accompagnement des veuves, ou encore de Françoise Grellier, la présidente actuelle, que je rencontre non loin du Mont Saint Michel, par une journée pluvieuse de l’été 2024. « Mon mari est décédé en 1998 d’un cancer foudroyant. Il avait 47 ans. Quelques années plus tard, je me rends à une réunion de l’AVEN, dans le Finistère. C’est plein à craquer ! Là, je suis frappée par les récits des vétérans : leurs problèmes de dos, de digestion, d’arthrose, c’est exactement ce dont mon mari souffrait, très jeune. Il avait passé 10 mois sur la base d’Hao lorsqu’il avait 20 ans, en 1971, lors de son service militaire. J’ai compris que les récits des autres m’aideraient à apaiser l’incompréhension. Alors je me suis engagée, pas forcément pour moi car son cancer n’est pas reconnu, mais pour tous les autres. »
Françoise adhère à l’AVEN en 2003. « C’est comme travailler à temps plein ! », confesse-t-elle. Alors que nous quittons le bar, la tenancière nous interpelle : « J’ai entendu votre conversation. Mon père a piloté les avions qu’on envoyait après la bombe pour prélever la radioactivité. Mon frère est né avec un doigt en moins, ma mère a toujours dit que c’était à cause de son géniteur ! ». Françoise la presse de rejoindre l’association. Sur la route qui me ramène au camping, je retourne ce témoignage surprise dans ma tête, ébranlée par ce qu’il signifie : combien de contaminations ont pris la forme d’anecdotes familiales, de ces « on dit » qui nous échappent et étouffent en sourdine la douleur des mères ?
Il faut être solide et entourée lorsque, devant les tribunaux et à la place des maris, les veuves prennent en plein visage le mépris et la mauvaise foi de l’État français. Les ouvriers, nettoyeurs ou chauffeurs qu’elles représentent devant les cours de justice, n’avaient pas droit aux dosimètres alors qu’ils travaillaient en zones contaminées. Dans l’impossibilité de prouver leur exposition à la radioactivité, elles se retrouvent face à des verdicts qui leur refusent justice.

Des mobilisations et, enfin, une loi
En 2006, Unutea Hirshon, femme politique Maohi, indépendantiste et anti-nucléaire, présente un rapport accablant écrit par la commission d’enquête sur les essais nucléaires de l’Assemblée de Maohi Nui. « Pour la première fois, des parlementaires élus décidaient de faire leur propre expertise sur les essais nucléaires français, contre l’avis de l’État », lit-on sur le très instructif site internet du Mémorial des essais, fondé à la suite du rapport pour diffuser des connaissances étouffées ailleurs. En avril 2009, un verdict historique et fortement médiatisé est rendu au tribunal du travail de Papeete en faveur de huit victimes Maohi des essais à Moruroa. Le tribunal reconnaît explicitement les fautes commises par l’État et le Commissariat à l’énergie atomique.
En juin 2010, après un an et demi de travail parlementaire et de négociation avec les associations, la loi Morin est votée. « On l’a attendue 10 ans ! » s’exclame Arlette, dont le mari a été le premier à être indemnisé. La législation concède enfin un droit à la réparation dans le cas de 21 types de cancers contractés à la suite des irradiations. Mais elle occulte le préjudice subi par les populations non militaires, « au grand soulagement des législateurs un temps pris de vertige à l’idée du nombre de personnes qu’il s’agirait alors de prendre en considération4 » si les victimes civiles étaient reconnues. L’association Moruroa e tatou exprime sa déception dès la promulgation de la loi. Quant aux membres de l’AVEN, en insistant sur la fierté d’avoir servi la France5 et sur une position « ni pour ni contre le nucléaire », ils et elles facilitent l’obtention d’une loi spécifique tout en contribuant à l’inégalité de traitement entre militaires et habitant·es. « Je ne suis pas contre la politique de dissuasion de la France. Mon mari est resté fier d’avoir contribué à la puissance nationale, me dit Arlette. On voulait surtout être reconnus, comme les soldats morts pour la patrie le sont en période de guerre. »
En 2010, la législation concède enfin un droit à la réparation dans le cas de 21 types de cancers contractés à la suite des irradiations. Mais elle occulte le préjudice subi par les populations non militaires.
Les sept premières années, sur 1 108 dossiers reçus, le ministre de la Défense n’a accordé que 17 indemnisations et le CIVEN, 136 ; sur ces 30 bénéficiaires, seuls 4 Maohi étaient concernés.
La loi est laborieusement améliorée au fil des ans. En 2017, la charge de la preuve est inversée : c’est désormais au CIVEN de prouver que le cancer n’est pas radio-induit. En 2018, le seuil de 1 millisievert est introduit7. En 2019, deux autres maladies sont ajoutées à la liste. Ces aménagements tardifs permettent une augmentation spectaculaire du taux d’acceptation des demandes. En 15 ans, 2 846 personnes ont saisi le Comité, 1 026 ont été reconnues victimes8. « 60% des dossiers que je dépose sont aujourd’hui acceptés », se félicite Cécile Labrunie, avocate au sein du cabinet TTLA & associés, spécialisé dans la défense des victimes de maladies professionnelles et de scandales sanitaires. Pour la députée Mereana Reid Arbelot, « c’est mieux qu’il y ait une loi plutôt qu’il n’y en ait pas ! Mais elle mérite un bon toilettage, au mieux une refonte totale. De nombreux·ses Polynésien·nes n’y ont pas recours, à cause de la difficulté de constitution des dossiers. Il est évident qu’il faudrait que la commission d’indemnisation ait une antenne à Tahiti ! ». La députée pose la question suivante : le statut de victime ne devrait-il pas être élargi à toutes les personnes travaillant sur le territoire lors de la période des essais atmosphériques ?

Victimes par ricochet
« Pour toutes les veuves, je plaide le préjudice moral d’accompagnement, explique Maître Labrunie, entre deux rendez-vous. Quand on apprend à 35 ans que son mari va décéder dans quelques mois et qu’on a un enfant de 5 ans. Quand on avait une vie commune et qu’on pouvait espérer passer encore un peu de temps ensemble. C’est le bouleversement des conditions d’existence qu’il s’agit de faire reconnaître ! Ces femmes ont assuré seules l’éducation des enfants, ont dû déménager lorsqu’elles ne pouvaient plus payer les charges d’un logement. Parfois, je plaide aussi le préjudice patrimonial : quand un époux ou un père était encore en activité et qu’il y a perte économique ». C’est ce qu’Arlette résume en quelques mots : « Tout d’un coup, on porte tout : la charge émotionnelle, domestique, économique ».
La charge domestique, quand ce sont les femmes qui assurent généralement ce rôle, prend une nouvelle dimension : « C’est comme être seule. Il ne pouvait plus jouer son rôle de père, je m’occupais des trois enfants, les nourrir, les habiller, les amener à l’école, les écouter, écouter leurs histoires et leurs pleurs », se rappelle encore Anne, dont le plus jeune fils avait 10 ans quand son père, ingénieur agronome, est tombé malade. La mère de famille, devenue veuve à 50 ans, raconte l’ultra-vigilance forcée au sein de l’espace domestique, lorsque, durant les dernières années, elle doit par exemple s’assurer que son mari ne répond pas au téléphone car il n’arrive plus à comprendre les appels. Sans oublier le rôle d’aide-soignante, d’infirmière, « les nuits à veiller », les rendez-vous chez le médecin puis à l’hôpital, l’administration des traitements.
D’autres, qui se destinaient au travail de femme au foyer, se sont au contraire retrouvées à devoir subitement chercher du travail, au décès de leur conjoint. « J’en ai rencontré une qui s’est remariée aussitôt, presque du jour au lendemain, pour pouvoir nourrir ses enfants », me dit Françoise Grellier, qui rappelle aussi le contexte traditionnel des années 1970-1980, quand les femmes n’avaient pas les mêmes conditions économiques qu’aujourd’hui.
« Les veuves se sont d’abord battues pour leurs conjoints, elles n’ont pas pensé à se battre pour leurs droits propres. »
Cécile Labrunie, avocate
Gisèle Laumes9 était mariée à un capitaine de frégate qui avait assisté à cinq essais nucléaires en 1968 sur l’atoll de Moruroa depuis le porte-avion Clémenceau. En 1991, on diagnostique au vétéran un cancer du colon. Il meurt quatre ans plus tard. Elle se souvient : « le matin, c’était l’angoisse à l’idée d’aller à la boîte aux lettres. J’avais peur des analyses médicales et de devoir mentir à mon mari pour le rassurer ». Gisèle a vu la retraite de son mari tomber de 15 000 francs à 3 500 francs : « Heureusement que j’ai les légumes du potager et que j’aime jardiner ! », reconnaît-elle. Quand il décède, elle a 50 ans. « Le calvaire de la maladie et cet accompagnement qui nous isole m’ont empêché d’imaginer me remettre un jour en couple. J’avais trop peur de le revivre une deuxième fois ! », confesse-t-elle.
« La bataille devant les tribunaux administratifs n’essuie que des rejets, regrette Cécile Labrunie, son avocate. Le juge considère que les actions sont prescrites, car les victimes disposent depuis plus de 4 ans des informations les amenant à porter plainte. » Elle ajoute : « Les veuves se sont d’abord battues pour leurs conjoints, elles n’ont pas pensé à se battre pour leurs droits propres. Du côté du Civen, je vois qu’il n’y a pas d’opposition à ce que les familles soient aussi indemnisées. Il faut maintenant la volonté du législateur », tempête-t-elle. L’avocate, avec son confrère Maître Neuffer, conseil historique de l’association Moruora e Tatou et des familles des anciens travailleurs de Moruroa et Fangataufa, milite pour un barème d’indemnisation au titre du préjudice moral et d’accompagnement des conjoints, enfants, petits-enfants a minima. « Je me suis faite insulter par ma belle-famille, ils disaient que je voulais juste du fric, se rappelle douloureusement Gisèle. Ce que je veux, c’est que l’État reconnaisse sa responsabilité dans ma souffrance, l’argent n’est pas important ! ».

Tisser les liens sans attendre la justice
L’absence de prise en compte, aussi bien par l’État et sa justice que par la société, des spécificités du travail invisible fourni selon une répartition des tâches assignée par le genre est une expérience singulière, auquel on se confronte à travers le récit des autres victimes. Entendre les vécus communs, se sentir concernées par la même histoire, permet souvent de révéler la légitimité des vécus qui sont considérés comme ne valant pas grand-chose. « J’ai aidé à constituer les dossiers de nombreuses veuves, car j’avais eu les mêmes difficultés, témoigne Anne Tardieu. Au téléphone, on pouvait se parler pendant des heures ! Elles me disaient : heureusement qu’il y a l’association, pour se rendre compte qu’on n’est pas seules ».
Dans la série « Atolls irradiés », lire aussi : Hinamoeura Morgant-Cross, « En Polynésie, ‘La grandeur de la France, je la porte avec ma leucémie’ », avril 2025.
En 2012, Anne Tardieu est à l’initiative d’un voyage jusqu’à Tahiti, entrepris avec une dizaine d’autres veuves rencontrées à travers l’association AVEN. Plusieurs bénéfices ressortent de cette aventure collective dans un territoire dont elles ont tant entendu parler sans y avoir jamais mis les pieds. D’abord, continuer à nourrir les liens interpersonnels, mais cette fois dans une expérience joyeuse – il s’agit aussi, l’espace de quelques jours, de sortir la tête des dossiers médicaux. Ensuite, rencontrer à Tahiti les membres de l’association Moruroa e Tatu, avec qui elles sont en contact depuis de nombreuses années. Enfin, réaliser ce que la bombe française a fait de ce côté du globe, ce qu’il y a de spécifique dans l’expérience des habitant·es de Maohi Nui. Les veuves, tout en embrassant la cause des victimes, se confrontent aussi à des discours contre l’État français, son programme nucléaire, sa colonisation. « Il y avait cette bombe gravée au-dessus de la croix de Lorraine, c’était quelque chose », se souvient Françoise en évoquant le mémorial à Papeete, un monument décoré par des artistes Maohi, où sont réunies des pierres provenant de Hiroshima et de Nagasaki et des différents sites d’essais nucléaires à travers le monde. « On se racontait nos histoires, complète Anne Tardieu. On se sentait plus proches les unes des autres ».

La parole aux femmes Maohi
Sur la page web dédiée aux veuves du Mémorial virtuel10, je découvre ce message : « Le vécu de ces veuves mériterait bien plus que quelques lignes sur le ‘Mémorial virtuel’, tant leurs histoires personnelles et familiales sont poignantes. C’est cette femme polynésienne d’un docker de Moruroa qui a appris subitement que son homme venait d’être évacué de toute urgence à Paris et qui n’a reçu qu’un cercueil quelques jours plus tard. C’est aussi cette jeune femme de militaire qui apprend que son mari a été hospitalisé à l’hôpital militaire de Percy et qui, convoquée par la hiérarchie militaire de son mari, est enjointe sous la menace de garder le secret qui emportera son mari à la mort.11 ». C’est la vie d’une habitante de Maohi Nui qui est évoquée en premier. Une priorisation salutaire et juste, alors que, parmi les expériences féminines face à l’atome, que le combat des veuves a rendu visibles, les luttes des femmes Maohi sont encore trop souvent absentes.
« Je pense que mes enfants sont morts parce que mon mari travaille à Moruroa. »
Une mère Maohi
Je suis touchée par ces femmes blanches âgées contraintes à des dizaines d’années de lutte contre l’État français, comme je suis indignée par l’oubli qui frappe d’autres expériences. Celles que je lis, par exemple, dans cette brochure de témoignages recueillis par Greenpeace International, Testimonies : witnesses of French nuclear testing in the South Pacific, publiée en août 1990, quelques années avant les premiers récits des militaires irradiés du Sahara. Plusieurs femmes y prennent la parole, comme cette mère Maohi, dans un texte intitulé « Mon bébé est devenu tout dur, dur comme le bois »12. Son mari travaillait à Moruroa.
Notre premier enfant est née en 1975. Elle a tout le temps des douleurs à l’estomac mais elle va à l’école et ça se passe bien. Mon deuxième était prématuré de 7 mois et demi, il est mort le jour de sa naissance. Mon troisième enfant est arrivé à terme. Il est mort deux semaines plus tard. Sa peau se décollait aussitôt qu’on la touchait. Eugène, mon 4e bébé, est mort à 2 mois. Il a été hospitalisé à Tahiti. Il est devenu rigide comme du bois, on ne pouvait plus ouvrir ses poings. On m’a empêchée d’être avec lui durant les deux semaines à l’hôpital. Puis ils ne m’ont pas donné de certificat de décès. Notre 5e enfant est vivant, il va bien. La 6e est née à terme. Mais les médecins ont dit qu’elle était prématurée, elle est morte le lendemain. Pourtant elle pesait 3 kilos. Le septième est vivant et se porte bien. Mon huitième est né prématuré à 6 mois et demi. Mon neuvième, une fille, est morte à 8 mois. Le dixième enfant est né au milieu de l’année 1985. Elle a été opérée du cœur en France. Elle va devoir y retourner pour une nouvelle opération. Elle semble aller bien. Je n’ai pas de problèmes de santé. Mes sœurs non plus, elles n’ont pas eu de problèmes avec leurs enfants, sauf deux fausses couches. Je pense que mes enfants sont morts parce que mon mari travaille à Moruroa.
Sur 12 enfants nés, seuls 6 ont survécu.
D’autres femmes, Thérèse, Maeva, et Toimata, certes minoritaires parmi la vingtaine d’autres témoignages, livrent leur mémoire singulière, passée sous silence de ce moment historique, celui de l’arrivée sur leurs îles du Centre d’expérimentation du Pacifique en 1963. Et avec lui, le débarquement de milliers de militaires français et de travailleurs, celui aussi de l’alcool et de la prostitution, des scientifiques qui prélèvent sans explication, qui se taisent ou bien disent que tout ira bien, des poissons intoxiqués qui causent la maladie grave de la ciguatera13.

Assurer le travail du soin en territoire irradié
Puis elles mettent des mots sur les spécificités de la condition des femmes en territoire irradié. Leur lecture révèle l’autre front sur lequel se battent aujourd’hui les victimes et les associations : celle des répercussions des irradiations sur l’ADN et donc sur les enfants qui naissent, mais aussi des conséquences psychologiques sur celles qui portent le travail de soin. Thérèse raconte que, sans savoir pourquoi, sur Tureia, « toutes les femmes enceintes sont évacuées de l’île à partir du cinquième mois ». Elle se rappelle aussi de cet enfant « en bonne santé ». Puis, « quand elle a eu 5 ans, elle a commencé à avoir des problèmes aux yeux, elle est aujourd’hui paralysée et ne peut plus marcher ». Maeva raconte que son enfant de 19 mois, son aîné, est né sans anus. Opéré à Paris, « il doit y retourner pour une seconde opération ». Hinano témoigne : « J’ai eu un bébé prématuré qui a été emmené en avion militaire à Tahiti. Le jour d’après, j’ai reçu un message disant qu’il était mort. Son corps ne m’a jamais été renvoyé, je n’ai jamais reçu de certificat de décès, ce qui veut dire qu’officiellement le bébé est toujours vivant. Je ne sais pas comment retrouver l’infirmière militaire qui a pris mon enfant. Je ne sais pas ce que je peux faire. Même maintenant, après des années, j’en fais des cauchemars. »
Du combat des veuves à celui des Maohi ayant porté des enfants malades, les diverses expériences de l’atome permettent de révéler la spécificité de l’expérience des femmes à l’irradiation, puisque la division genrée du travail les amène à exercer le travail domestique, celui du soin – sans oublier le fait de porter et donner naissance. « Ma fille est infertile : même si on ne peut pas prouver quoi que ce soit, je garderai toujours le doute », me glisse Françoise Grellier lors de notre entrevue. Devoir accepter une infertilité, faire le deuil de fausses couches à répétition, porter dans l’anxiété une grossesse parce qu’on pense que l’enfant va mourir en naissant, se faire prendre son bébé par l’hôpital à peine on vient de le mettre au monde, sont des expériences matérielles et intimes de femmes, qu’il devient urgent de relégitimer, tant elles sont encore invisibilisées, parfois au sein même des associations de victimes. D’autres endroits du monde ont vu des collectifs spécifiques émerger : les Mères en colère de la Hague en France, le collectif MamaBecq ou Happy Island à Fukushima au Japon14. À Maohi Nui, ces thématiques liant maladie, corps de femmes, reproduction et soin aux enfants peuplent pourtant les fictions : des romancières ma’ohi (Rai Chaze, Chantal T. Spitz ou Titaua Peu) visibilisent les conséquences sanitaires du Centre d’Expérimentation du Pacifique – du nom de la structure installée par la France pour la réalisation des essais nucléaires (ouverte en 1963 et aujourd’hui fermée). Dans ces fictions, si les employés du nucléaire sont des hommes, ce sont les femmes qui meurent de cancer, le plus souvent aux parties du corps associées à la reproduction, les seins ou l’utérus.

Comment lutter pour nos enfants malades ?
« Comment concevoir qu’un choix industriel ou gouvernemental signifie que nous soyons porteurs de gènes difformes et que nos petits enfants seront mort-nés si nos enfants ont de la chance », demande ainsi la romancière et poétesse américaine Marge Piercy dans son livre, La mort lente, en 1982. C’est cette quête de sens et de justice sur la transmission entre générations que mènent aussi nombre de parents contaminés par l’atome. Je rencontre Michel Tanemaruatoa Arakino dans le bar de son village, à la périphérie de Lyon. Ce Maohi de 64 ans est venu en France pour se soigner et lutter pour la reconnaissance des maladies radio-induites. Ancien scaphandrier au service contrôle biologie de l’armée de 1981 à 1999, il a été irradié à 27 ans en 1987 après un essai nucléaire sur l’atoll de Mururoa. « Je veux une prise en charge médicale par l’État de mes maladies et de celles de mes enfants à travers un véritable plan sanitaire, explique-t-il. Qu’on n’ait pas besoin de prouver qu’on était là à tel endroit ». Michel Tanemaruatoa a cinq enfants, qui ont tous des maladies rares étranges, handicaps ou malformations. « J’ai repris des études de bio pour comprendre pourquoi mes enfants ont des maladies inconnues », ajoute-t-il.
« Dès qu’il s’agit du nucléaire, il y a volonté de cacher. »
Christian Sueur, pédopsychiatre
Une initiative personnelle qui témoigne de la difficulté à être soutenu par la communauté scientifique, plus prompte à dénier le caractère « scientifique » de certaines études établissant le lien entre les expositions aux radiations des parents et différentes pathologies15 qu’à s’atteler à en ouvrir d’autres. C’est ce que dénonce le docteur Christian Sueur, dont l’étude publiée en 2018 a été dénigrée par un rapport de l’Inserm16. Responsable de l’unité pédopsychiatrique du centre hospitalier de Maohi Nui jusqu’en 2017, il a observé que, sur 271 enfants consultés pour des troubles envahissants du développement, 69 ont développé des anomalies morphologiques et/ou des retards mentaux. Pour le pédopsychiatre, ces pathologies sont liées à des déficiences génétiques susceptibles d’avoir été provoquées par des retombées radioactives sur les grands-parents. Les objections de « non-scientificité » rencontrées à la suite de ces analyses sont symptomatiques de la « fabrique de l’ignorance17 » d’une communauté de chercheurs concentrés sur l’échec à « prouver scientifiquement » l’imputabilité de pathologies génétiques transgénérationnelles, et donc à décréter que l’hypothèse d’une responsabilité des retombées nucléaires vis-à-vis des pathologies neurodéveloppementales constatées en surnombre chez les enfants Maohi, n’est pas « scientifique ». « Dès qu’il s’agit du nucléaire, il y a volonté de cacher, confiait-il au Parisien18. Je constate que dans les archipels comme les Tuamotu, rares sont les médecins civils. En revanche, on note la présence de médecins militaires. Je ne remets pas en cause leurs capacités de diagnostic ou de thérapie mais je m’interroge sur leur indépendance et leur transparence ».

Fissurer l’omerta du nucléaire, dépasser les désaccords dans la lutte
L’écrivaine Maylis de Kerangal a posé son vélo pour fouler la « zone critique », comme elle la nomme : le sol où sont enfouis des tonnes de déchets radioactifs, à la Hague, d’où je suis moi-même originaire. Dans son texte « Sol bouleversé », écrit à l’occasion de l’exposition L’âge atomique : les artistes à l’épreuve de l’histoire (Musée d’Art Moderne de Paris, 2024), elle parle de cette radioactivité dont les « retombées, telles les spores d’un virus insaisissable et mortel, exportaient toujours plus loin les conséquences sanitaires de l’explosion ». C’est face à cette « exportation des conséquences » dans leurs vies, leurs corps et ceux de leurs enfants, que les personnes que j’ai rencontrées luttent. Leurs questions font résonner celles que j’ai enfouies en moi, qui suis née sur cette « zone critique », celle des contaminations diffuses et silencieuses, des fuites qui disparaissent des rapports, des taux de leucémie trop élevés.
Et pourtant : on ne critique pas la bombe. Au contraire, plusieurs veuves défendent la politique de dissuasion française et l’importance de l’arsenal nucléaire.
Alors que j’écris les dernières lignes de ce reportage, je suis à nouveau perturbée par le choc de l’ignorance collective et de la puissance des combats de celles dont j’ai recueilli ou collecté l’histoire. Comment est-il possible qu’autant de victimes soient encore aujourd’hui ignorées ? Qu’aucun Comité d’indemnisation des victimes des essais n’ait encore été installé à Tahiti ? Que les voix qui s’élèvent, puissantes et sans appel, soient si implacablement étouffées ? C’est que le négationnisme nucléaire reste solide. Et qu’il en faut, des décennies, pour le fissurer. Les femmes de l’AVEN, Françoise, Anne, Arlette, Gisèle, et des dizaines d’autres sœurs disséminées partout en France et sur les territoires colonisés, continuent de lui porter des coups. C’est cette histoire populaire de lutte dont nous héritons qu’il faut continuer à écrire, alors que le récit dominant fabrique des avenirs radieux et atomiques pour le monde entier.
Mais il y a autre chose qui me perturbe : cette admiration et cette colère que je ressens en écoutant ces femmes vieilles et fortes, dont l’État a gâché la vie au nom de la puissance française, se heurte à l’incrédulité quand je lâche le téléphone. Autant de douleurs vécues et de mépris reçus, et pourtant : on ne critique pas la bombe. Au contraire, plusieurs d’entre elles défendent la politique de dissuasion française et l’importance de l’arsenal nucléaire. Que faire de cette ligne de rupture, alors qu’elles viennent de rejoindre ma cosmogonie des militantes inspirantes, aux côtés des Britanniques de Greenham Common, de celles et ceux qui ont marché à Bure avec les Bombes Atomiques, des voisines de cœur du collectif Piscine Non Merci à la Hague ? N’ont-elles rien à se dire ? Ou, au contraire, peuvent-elles fomenter des alliances ? Je n’oublie pas en effet que cette ligne de rupture empêche ces « femmes de », attachées au statut militaire de leurs maris, de s’entendre véritablement avec celles et ceux qui luttent en Maohi Nui – « trop militant » me dira la présidente de l’AVEN. Il est certain qu’Hinamoeura Morgant-Cross [voir entretien] n’est pas du genre à ménager l’État français, mais plutôt à vouloir faire exploser le système colonial nucléaire.
Je sens pourtant que nous perdrons en puissance à faire de ces lignes de clivage des murs qui nous sépareraient. Que les témoignages recueillis ici exposent d’autres manières de lutter, qui ne sont pas moins valables que d’autres. Qu’il est une invitation à renforcer nos imaginaires féministes face à des destins malmenés par la combinaison du patriarcat et du système nucléaire-colonial. Qu’il faut nous rencontrer, partager nos expériences meurtries. Dire nos désaccords et trouver l’endroit où, ensemble, au coude à coude, nous luttons contre l’injustice.
Les photos illustrant ce reportage ont été prises par le réalisateur Larbi Benchiha, qui prépare un film sur le voyage à Tahiti des veuves des victimes des essais à Maohi Nui. Larbi Benchiha a réalisé plusieurs documentaires sur les essais nucléaires français au Sahara et dans les atolls de Maohi Nui, comme Bons baisers de Moruroa (2016) ou encore Vent de sable, le Sahara des essais nucléaires (2008), présenté à New York en mars 2025 au festival World Beyond War et à Rio de Janeiro le 25 mai 2025 à l’International Uranium Film Festival.
Les deux illustrations dans l’article sont les œuvres de l’artiste HTJ. Son compte Instagram : @htjdesigns
L’image d’accueil est l’œuvre de l’artiste Margaux Bigou. Son compte Instagram : @margauxbigou

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Dans les villes de Strasbourg, Montpellier, Rennes.[↩]
- Ces documents comportent presque exclusivement des témoignages d’hommes. Ceux de femmes victimes ou concernées par le combat pour la reconnaissance sont presque inexistants. On pourra se référer notamment à : Bruno Barrillot, Les essais nucléaires français 1960-1996. Conséquences sur l’environnement et la santé, Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits (1996) ; Vincent Jauvert, « Essais nucléaires. Les archives interdites de l’armée », Le Nouvel Observateur, 5-11 février 1998 ; Les Gambiers sous le vent nucléaire, reportage du 11 avril 2008 dans l’émission Thalassa sur France 3 ; Vent de sable, documentaire réalisé par Larbi Benchiha (2008) ; Gerboise bleue, documentaire réalisé par Djamel Ouahab (2009) ; Rendez-vous avec X, Les dégâts nucléaires français en Polynésie (France Inter, 2013) ; Bons baisers de Moruroa, documentaire réalisé par Larbi Benchiha (2016) ; « Les irradiés pour la France : Essais dans le Sahara à Reggane et In Amguel », dans Hommes contaminés, nature polluée (3/4), un documentaire d’Anice Clément et Marie-Ange Garrandeau pour France Culture ; Barthe Yannick, Les retombées du passé. Le paradoxe de la victime, Le Seuil, 2017 ; « Essais nucléaires : en Polynésie française, l’explosion atomique qui ne s’est pas passée comme prévu », sur franceculture.fr, 9 mars 2021 ; Renaud Meltz et Alexis Vrignon (dir.), Des bombes en Polynésie. Les essais nucléaires français dans le Pacifique, Éditions Vendémiaire, 2022.[↩]
- Après le tir de la première bombe française à Maohi Nui, le 2 juillet 1966, la forme et les dimensions du nuage ne sont pas « conformes aux prévisions ». La radioactivité mesurée des légumes et des eaux dépasse de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de fois la radioactivité normale de ces éléments. Le rapport du médecin qui note ces chiffres effrayants indique qu’« il sera peut-être nécessaire de minimiser les chiffres réels de façon à ne pas perdre la confiance de la population qui se rendrait compte que quelque chose lui a été caché dès le premier tir. »[↩]
- Yannick Barthe, Les retombées du passé : Le paradoxe de la victime, Éditions du Seuil, p. 166.[↩]
- Voir Yannick Barthe, « Droit d’en être fiers », chapitre 6 de Les retombées du passé : Le paradoxe de la victime, op. cit.[↩]
- La faiblesse des indemnisations s’explique par le fait que c’est la victime qui doit fournir la preuve de l’irradiation : elle doit réunir des éléments de preuve très difficile à se procurer, de lieu, de temps et de pathologie ; justifier de l’une des 21 maladies radio-induites reconnues par décret du Conseil d’État, justifier avoir résidé ou séjourné dans des zones géographiques, en des moments déterminés. De plus, la victime d’une des 21 maladies « bénéficie d’une présomption de causalité à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais puisse être considéré comme « risque négligeable » », en d’autre terme « probabilité très faible » : une mesure qui l’empêche généralement d’être reconnue victime.[↩]
- Comme l’explique devant la Commission parlementaire Alain Christnacht, président du CIVEN de 2017 à 2021, la nouvelle méthodologie « repose sur la notion de doses annuelles efficaces engagées provenant des activités nucléaires, reçues par rayonnements externes et par contamination interne, comme l’a expliqué Mme Aubin, et admissible pour tout public, et non seulement dans le cas polynésien. La dose minimale, fixée conformément aux recommandations des organismes internationaux spécialisés et à une directive de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) de 2013, est de 1 millisievert. Ces normes internationales ont été intégrées dans le droit français par le code de la santé publique, notamment à l’article L1333-2 et à l’article d’application L1333-11. Cette dose très faible, qui n’est susceptible d’entraîner une maladie radio-induite, a été considérée comme la meilleure manière de concilier la suppression du risque négligeable, décidée par le Parlement et respectant l’esprit du vote, avec l’objectif de la loi Morin d’indemniser uniquement les personnes dont la maladie était causée par ces rayonnements. »[↩]
- Chiffres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).[↩]
- Les nom et prénom ont été modifiés pour garantir l’anonymat.[↩]
- Le site moruroa.org, aujourd’hui http://moruroa.assemblee.pf/, a été créé à l’initiative de M. Oscar Temaru, président de l’Assemblée de Maohi Nui et membre du parti indépendantiste. Mme Unutea Hirshon qui présida la commission d’enquête de l’Assemblée de Maohi Nui sur les essais aériens en 2005 a eu la charge de la mise en place du site.[↩]
- « N’oublions pas les veuves ! », site Mururoa, mémorial des essais nucléaires français.[↩]
- Cet extrait a également été publié dans le livre de la militante anti-nucléaire Zohl De Ishtar, Daughters of the Pacific (1994). La brochure de Greenpeace a été traduite en français par la militante écologiste et protestante Solange Fernex. Il est intéressant de noter que sur c’est encore une femme qui fait ce travail gratuit de traduction et de transmission.[↩]
- L’augmentation des cas de ciguatera est une autre conséquence de l’arrivée de l’atome et de ses infrastructures : le dragage des coraux du lagon pour générer d’énormes quantités de ciment (afin de mettre sur pied une piste d’atterrissage, par exemple) a empoisonné la faune, rendant les poissons toxiques. Une maladie qui n’est pas apparu avec les essais mais qui a pris des proportions terrifiantes au moment de la construction des infrastructures, empoisonnant et tuant les animaux et intoxiquant des milliers d’humains. « C’était sans doute idiot de vouloir encore manger du poisson alors qu’on sait bien qu’ils sont tous contaminés », s’interroge Hinano dans son témoignage. Mais comment cesser de consommer la denrée la plus disponible et nutritive des îles ?[↩]
- À ce propos, on pourra lire « Les Mères en colère de l’industrie nucléaire », de Philippe Brunet, Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, 2010, pp. 129-142 ; ou écouter « Japon – Fukushima, avec les femmes et les mères en lutte », podcast « Je reviens du monde d’avant », France Inter, 16 août 2020.[↩]
- La brochure de Greenpeace de 1990 note par exemple que le rapport Gardner, une étude britannique sur les enfants des travailleurs de l’usine de retraitement de Sellafied, établit un lien entre les expositions aux radiations des pères et le niveau de leucémie des enfants. Une autre étude sur les femmes exposées aux tests américains sur les îles Marshall Rongelap a constaté un taux anormal de pertes reproductives (66% d’entre elles en avaient fait l’expérience). 7,4% de leurs enfants avaient des souffles cardiaques, contre 2 à 3% des enfants états-uniens. Le taux de problèmes congénitaux comme le syndrome de Downs, l’assymétrie faciale, des démarches anormales étaient également décrit comme « surprenant » dans cette étude.[↩]
- Analyse scientifique du rapport : « Les Conséquences génétiques des Essais Nucléaires Français dans le Pacifique, chez les petits-enfants des Vétérans du Centre d’Expérimentation du Pacifique et des habitants des Tuamotu Gambiers », décembre 2018, INSERM.[↩]
- C’est ce qu’explique Christian Sueur en réponse aux deux rapports INSERM dans un billet du 5 août 2021 sur son blog Mediapart, « Les conséquences sanitaires du nucléaire : la ‘sciences asservie’ ».[↩]
- « Essais nucléaires en Polynésie : un médecin dénonce « une omerta » », Le Parisien, janvier 2018.[↩]