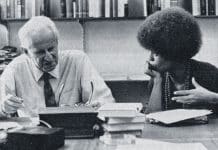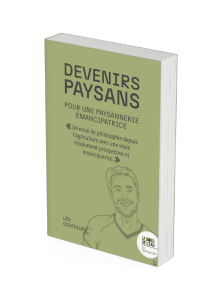
Extrait du livre de Léo Coutelec, Devenirs paysans. Pour une paysannerie émancipatrice, paru en 2025 aux éditions Le Bord de l’eau dans la collection « En Anthropocène », 192 pages.
« J’entends les silences et je pense aux arbres ; ils sont là, nus, ils ne plastronnent pas, ils ne sont pas glorieux, ils sont tenaces, accrochés dans la pente des hivers et du temps. Je ne sépare pas les arbres et les paysannes. » Marie-Hélène Lafon1
« Prendre la pétromasculinité au sérieux signifie prêter attention aux désirs contrariés des patriarcats privilégiés, à mesure que s’étiolent leurs fantasmes fossiles. » Cara New Daggett2
« Nous saluons toutes les femmes qui, à partir de différents territoires, soutiennent la vie, l’alimentation, les soins et les transformations sociales. (…) Nous, les femmes, continuons à marcher, à dénoncer la violence et les crimes environnementaux et sociaux, à lutter contre le pillage de nos richesses et le massacre des peuples. Nous continuons à tisser des réseaux et des alliances pour démasquer le patriarcat, le capitalisme et le néolibéralisme qui menacent la vie sur la planète. » La Via Campesina3
Mesurer la réussite d’une ferme à la taille de ses tracteurs, organiser un concours de labour ou une course de moiss’batt-cross, porter des habits de travail à l’effigie d’une marque de machines agricoles, manifester à coups de gros tracteurs pour faire démonstration de puissance mécanique, assumer sa dépendance aux combustibles fossiles par la consommation ostentatoire de carburants ou d’engrais chimiques, sont autant d’indices que l’agriculture est progressivement devenue une pétroculture. Et que cette dernière est avant tout une « pétromasculinité4 », concept forgé par la politologue Cara New Dagett. La domination masculine et l’affirmation d’une virilité autoritaire trouvent dans la mécanisation démesurée de l’agriculture un point d’appui, avec une identification du travail « à l’expérience virile du contact avec la machine5 ». Le refus d’admettre l’évidence de la crise climatique par la continuation assumée d’une agriculture pétro-dépendante est l’une des manifestations de cette pétromasculinité. La responsabilité des hommes dans le désastre agricole en cours est évidente, et pas simplement parce qu’ils sont numériquement bien plus nombreux que les femmes, mais aussi et surtout parce qu’ils dominent la « profession » par l’adhésion sans réserve au mythe fossile qui assure leurs privilèges.
C’est une lecture que l’on peut faire des mouvements récents d’agriculteurs des syndicats de droite (FNSEA [Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles], JA [Jeunes Agriculteurs] et Coordination rurale), dont le centre revendicatif était le refus des normes environnementales, l’arme principale une ribambelle de gros tracteurs et les visages médiatiques essentiellement masculins. Ce qui était défendu au fond, au-delà des slogans creux de diversion distillés par les directions syndicales, c’était une forme de pétromasculinisme agricole que nous définissons comme la domination masculine dans l’agriculture s’affirmant par la défense du régime fossile. Selon cette approche, épuiser la terre, polluer les sols et les eaux, homogénéiser les paysages, détruire la biodiversité ne sont pas les objectifs principaux de l’agriculture productiviste, ce sont des conséquences d’une finalité bien plus insidieuse, celle qui consiste à maintenir et à défendre les privilèges d’une culture patriarcale basée sur l’autoritarisme fossile. Dagett définit le régime fossile comme la « logique de gouvernement qui dépend matériellement et psychologiquement de la consommation intensive de combustibles fossiles6 ». La deuxième dimension de cette dépendance, la dimension psychologique, bien que moins souvent mise en avant, est pour autant déterminante en cela qu’elle permet de justifier une posture d’autorité, là où « le pouvoir explosif de la combustion s’est trouvé grossièrement assimilé à la virilité7 ». Dans un contexte où la responsabilité de la combustion d’énergies fossiles dans la crise climatique est avérée, défendre le régime fossile et le faire de façon ostentatoire peut être considéré comme une forme de violence, que certains qualifient de « carbofasciste8 », dont le but est de réaffirmer et conserver le pouvoir masculin blanc. C’est pourquoi Daggett parle d’une « convergence catastrophique » entre masculinité, combustion fossile et autoritarisme.
Une paysannerie émancipatrice passe donc nécessairement par un refus de cette pétroculture patriarcale. En contrepoint, c’est un écoféminisme paysan que l’on voit naître et s’intensifier9. De nombreuses paysannes s’installent hors du cadre dominé par la démonstration d’une puissance mécaniste et viriliste, et dans une conscience du caractère systémique des dominations de la terre et du corps des femmes pour penser et vivre l’activité paysanne différemment, sans pour autant faire sécession. Prendre soin de la terre et des animaux autrement, revendiquer des pratiques de subsistance10 pour se défaire de la dépendance au système productif masculin, gagner en autonomie décisionnelle et pratique, refuser la division sexuelle du travail agricole11, adapter le travail pour qu’il ne soit plus aliénant, se former et se renforcer au sein de collectifs non mixtes12 sont autant de visées pour sortir des pétrocultures qui renforcent la domination masculine dans l’agriculture.
Dans une telle perspective, il ne s’agit pas « d’inclure les femmes dans l’agriculture » ou d’affirmer que « leur place est différente », ce serait encore accorder du crédit à la conception patriarcale de l’agriculture, car ces politiques « paternalistes d’empowerment des femmes », devenues à la mode, ne contribuent qu’à accélérer « la destruction des bases matérielles de leur pouvoir, les privent de la joie de l’autonomie13 ». Plutôt que l’instrument d’une soi-disant diversité au sein du corporatisme agricole, la perspective écoféministe dans l’agriculture s’invente en autonomie et dans la pluralité des expériences14, elle renouvelle profondément les pratiques et les imaginaires, elle est le cœur et le moteur d’une paysannerie émancipatrice qui cherche à défaire les dominations. Et elle reste le rempart et l’alternative la plus solide au pétromasculinisme agricole en cela qu’elle ne cherche pas seulement à proposer des ajustements techniques ou des pratiques différentes, mais propose un renouvellement profond de la culture de l’agriculture par la construction de relations écologiques au vivant humain et autre qu’humain qui permettent de rompre simultanément avec la domination masculine, l’asservissement au régime fossile et à l’autoritarisme qui les accompagne. La façon dont les femmes paysannes ont investi de façon autonome La Via Campesina, le plus grand mouvement de paysannes et paysans au niveau mondial, et qui défend un « féminisme paysan et populaire », est illustratif de ce devenir écoféministe de la paysannerie.

S’ouvrir à ce devenir pourrait aussi être une forme de mise à distance de l’emprise d’un autre mouvement de fond qui structure, et parfois sclérose, les pensées et pratiques paysannes, le familialisme. Ce dernier fait de la famille l’unité élémentaire de la société politique et se comprend comme « un mode d’organisation de la cité qui articule la détention de l’autorité politique et la position dans la famille15 ». Dans l’agriculture, le familialisme se loge derrière l’idée que le modèle à défendre et à promouvoir est celui de l’exploitation agricole familiale, où le travail agricole s’organise en famille et où se confondent les sphères privées et professionnelles. Cette défense d’une agriculture familiale, souvent réduite à une agriculture de couple, est assez transversale au sein du syndicalisme agricole, de droite comme de gauche. La cohérence et l’intrication entre le travail domestique et les tâches agricoles sont ainsi régulièrement valorisées, tout comme le souhait d’une vie pleine qui puisse dépasser la séparation entre les dimensions familiales, professionnelles et sociales. L’influence historique de la JAC (Jeunesse agricole catholique), mouvement créé dans les années 1920, dans la formation des cadres des mouvements syndicaux en est sûrement un facteur déterminant bien que cette organisation ait aussi été un vecteur important de la prise en compte de la cause des femmes paysannes16.
La perspective écoféministe dans l’agriculture renouvelle profondément les pratiques et les imaginaires. Elle est le cœur et le moteur d’une paysannerie émancipatrice qui cherche à défaire les dominations.
Malgré des avancées dans la reconnaissance de certains droits sociaux pour les paysannes, l’invisibilité du travail féminin, la non-déclaration de la conjointe au sein de la ferme, les différentes formes de violences subies17 ou encore la division sexuelle des tâches persistent. Et l’on observe que ces phénomènes ne sont pas l’apanage d’une vision traditionaliste de l’agriculture, ils traversent toutes les visions de l’agriculture, y compris chez les « néoruraux » ou au sein des mouvements d’agriculture biologique18. Le rôle subordonné des femmes dans l’agriculture, notamment en termes de reconnaissance de droits, a des racines profondes et s’apparente à la situation des femmes en général sous la IIIe République : « si elles ne sont pas admises dans la citoyenneté électorale, c’est parce qu’en tant que membres subordonnés de la famille, on les suppose présentes dans le vote émis par les hommes au nom de l’intérêt général19 ». C’est parce que la famille est considérée comme l’unité de base de l’organisation d’une activité agricole, au sein de la laquelle est supposée une unité d’intérêts et d’opinions, que « ses membres subordonnés sont privés du droit de vote. (…) lorsque le pater familias s’exprime à travers le vote, c’est toute la famille qui s’exprime derrière lui20 ». C’est pourquoi aussi, les femmes n’ont été reconnues comme agricultrices qu’en tant que membre d’une famille, fille, mère ou épouse ; et que les termes de « chef de famille » et de « chef d’exploitation » se sont souvent confondus. La défense d’une agriculture familiale est intenable si elle ne s’oblige pas à cet examen critique.
Il ne s’agit pas de dire qu’il faut abolir la famille ou qu’une paysannerie émancipatrice serait obligatoirement une paysannerie hors du cadre de la famille. Ce que l’écoféminisme paysan apporte c’est un questionnement sur les modalités de faire famille d’une part – notamment en libérant celle-ci de son emprise patriarcale et hétéronormée21 – et sur la place de celle-ci au sein de l’activité paysanne – par une mise à distance de sa centralité pour donner plus d’espaces d’autonomie aux femmes paysannes et ouvrir à des formes collectives plus diversifiées ; pour désimbriquer les enjeux de patrimoine, de famille et travail. C’est pourquoi l’expression « hors cadre familial » devrait avoir, selon moi, un sens bien plus générique, et porter non plus seulement sur l’absence d’une filiation agricole mais sur toutes les dimensions de la vie paysanne lorsque celle-ci n’est plus centrée sur une logique familiale de production22, autrement dit lorsque la paysannerie n’est plus soumise à l’emprise du familialisme.
➤ Lire aussi | Ils ont 20 ans pour sauver le capitalisme・Léo Coutellec (2019)
Image d’accueil : Jerry Kavan sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci ❤️ !
Notes
- LAFON Marie-Hélène, VETTORETTI Alexis, 2024, Paysannes, Ulmer, Paris.[↩]
- DAGGET Cara New, op. cit., p. 52.[↩]
- LA VIA CAMPESINA, 2025, Appel à l’action antifasciste.[↩]
- DAGGET Cara New, op. cit.[↩]
- JARRIGE François, Techno-critiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, La Découverte, 2014, p. 154.[↩]
- DAGGET, op. cit., p. 26.[↩]
- Ibid, p. 29.[↩]
- Antoine DUBIAU définit le « carbofascisme » comme la convergence d’intérêts entre le capitalisme fossile, les grandes entreprises productrices d’hydrocarbures et les forces politiques d’extrême droite.[↩]
- Le concept d’écoféminisme paysan a notamment émergé à l’occasion des rencontres, en non-mixité choisie, des travailleuses de la terre qui se sont déroulées les 17 et 18 septembre 2022 à Vezin-le-Coquet. Il sera aussi utilisé dans la déclaration des 84 paysannes de la Confédération paysanne réunies les 16 et 17 novembre 2023 à Montreuil : « Notre féminisme est écologique, paysan et populaire. Il se veut solidaire des personnes opprimées et exploitées et comprend profondément que l’exploitation des femmes et de leurs corps est intrinsèquement liée à l’exploitation industrielle de la nature et de ses ressources par le capitalisme et le patriarcat. L’écoféminisme paysan et populaire veut avant tout célébrer la vie, notre rapport sensible au monde et nous reconnaître comme vivantes parmi le Vivant, pour amener à une entière valorisation d’une agriculture paysanne, autonome, durable, nourricière, qui régénère les sols et mise sur les alliances et les coopérations interespèces » (consultable en ligne sur le site de la Confédération Paysanne).[↩]
- PRUVOST Geneviève, 2021, Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance, La Découverte, Paris.[↩]
- DEMATHIEU Agathe, 2022, « Comprendre la division sexuelle du travail agricole : comment les techniques contribuent à la perpétuer ? », AgriGenre. Source en ligne, consulté le 13 avril 2025 : <https://agrigenre. hypotheses.org/11345>.[↩]
- WEILER Nolwenn, 2024, « Agriculture et féminisme, une alliance heureuse », Basta.[↩]
- AZAM Geneviève, 2023, « Penser et agir depuis la subsistance : une perspective écoféministe », Revue Terrestres.[↩]
- À ce titre, je conseille vivement la lecture de l’enquête sociologique de Constance Rimlinger sur les expériences de vie en lien avec la terre de personnes féministes et non hétérosexuelles : RIMLINGER Constance, 2024, Féministes des champs. Du retour à la terre à l’écologie queer, PUF, Paris.[↩]
- VERJUS Anne, 2013, « Familialisme » in : ACHIN Catherine et BERENI Laure, Dictionnaire. Genre et science politique : Concepts, objets, problèmes, Presses de Sciences Po, Paris, p. 251-262. [↩]
- MARTIN Jean-Philippe, Histoire de la nouvelle gauche paysanne. Des contestations des années 1960 à la Confédération paysanne, 2005, La Découverte, collection « Cahiers libres », p. 37-38.[↩]
- SALMONA, Michèle, 2003, « Des paysannes en France : violences, ruses et résistances », Cahiers du Genre, 35 (2), p. 117-140.[↩]
- SAMAK Madline, 2017, « Le prix du “retour” chez les agriculteurs “néo-ruraux”. Travail en couple et travail invisible des femmes », Travail et emploi, 150.[↩]
- VERJUS Anne, op. cit.[↩]
- Ibid.[↩]
- CHOLLET Mona, 2021, Réinventer l’amour. Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, La Découverte, Paris.[↩]
- Logique qui reste bien présente, y compris dans les mouvements d’agricultrices qui revendiquent une reconnaissance économique de leur travail. Voir : COMER Clémentine, 2022, « Luttes d’agricultrices ou d’épouses au travail ? Retour sur l’histoire d’un féminisme paradoxal (1970-2010) », Entreprises et histoire, 107(2), p. 110-123.[↩]