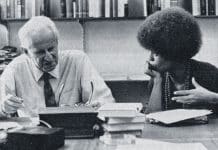Comment rendre justice à celles et ceux qui ont payé le prix de la puissance nucléaire ? Une enquête en trois volets de Naïké Desquesnes et Léna Silberzahn.
Enquête
Atolls irradiés
Lutter et réparer après les essais nucléaires en Polynésie (Ma'ohi nui)
Chez nous, ce sont des bombes qui ont explosé, comme à Hiroshima et Nagasaki, même s’il n’y avait pas de villes ou de millions d’humains directement en dessous. Le terme « essai » est terriblement minimisant et vise à cacher la réalité. Les mots sont importants.
Entre 1960 et 1996, la France a fait exploser 210 bombes nucléaires : 17 dans le désert du Sahara algérien puis 193 en Ma'ohi Nui, l’autre nom de la Polynésie. Les « essais » nucléaires, que nous nommerons plutôt « expérimentations », ont fait de très nombreuses victimes — la plupart des 23 maladies radio-induites aujourd’hui reconnues sont des cancers graves — et ont provoqué des dégâts écologiques considérables. Pourtant, les ravages des bombes nucléaires sont longtemps restés largement ignorés.
En 2021, le chercheur Sébastien Philippe et le journaliste Tomas Statius publient le livre Toxique : Enquête sur les essais nucléaires français en Polynésie. L’ouvrage est accompagné de la mise en ligne des « Moruroa Files » par les médias Disclose et Interprt. Basée sur 2000 documents déclassifiés et étayée par des modélisations scientifiques, cette enquête fait enfin la lumière sur les conséquences des expérimentations nucléaires en Ma'ohi Nui.
Les auteurs y démontrent ce que militant·es et lanceur·euses d’alerte dénoncent depuis des décennies : environ 110 000 personnes ont été dangereusement exposées à la radioactivité. C'est-à-dire la quasi-totalité de la population des archipels polynésiens à l’époque des essais nucléaires. « En Polynésie, écrivent les auteurs de Toxique, l’héritage des essais nucléaires français est inscrit dans la chair et dans le sang des habitants ».
Depuis 2024, une commission d’enquête française se penche sur les conséquences des essais nucléaires en Polynésie, dans l'idée de proposer une éventuelle refonte de la loi de 2010 relative à l'indemnisation des victimes. Après une suspension liée à la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, les auditions ont repris en janvier 2025. Le rapport final est attendu pour le mois de juin 2025.
Comment les premier·es concerné·es vivent-ils et elles avec cet héritage, et comment mènent-ils et elles, au quotidien, la lutte contre le déni de leur parole et de leurs expériences ? Que peut apprendre le mouvement antinucléaire hexagonal de leurs combats pour la vérité, la justice et la réparation face à la contamination et au mensonge d’État ?
Naïké Desquesnes et Léna Silberzahn, respectivement journaliste et chercheuse, se sont rencontrées lors d'un rassemblement antinucléaire et féministe en 2019 à Bure. Dans les trois textes de ce dossier, elles cherchent à éclairer les vécus et les combats des survivant·es, selon une perspective attentive aux questions du genre et de la colonialité.
En Polynésie, l’héritage des essais nucléaires français est inscrit dans la chair et dans le sang des habitants.