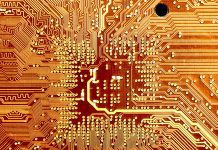De nos jours, la démocratie semble moins exprimer le mouvement de libération d’un peuple qu’accompagner la soumission générale des formes de vie à l’impératif mondialisé d’une économie de marché. L’articulation entre politique et économie, caractéristique de la démocratie moderne et fondement, comme le rappelle Hannah Arendt[1], de l’impérialisme et de l’exploitation des multiples formes de vie, semble atteindre, dans le contexte de la mondialisation économique, son point d’achèvement. La politique pensée comme capacité à affirmer un devenir collectif singulier se trouve subordonné à un ensemble de mécanismes économiques de capture et de mesure homogénéisants, instituant le règne d’une équivalence générale des êtres du monde. Le modèle démocratique moderniste se trouve dans l’incapacité d’y mettre un terme puisqu’il contribue, au contraire, à instaurer la conformité aux valeurs dominantes de production et de libre-échange qui évaluent toutes les entités vivantes en terme de ressource exploitable. Or, comme le rappelle l’historienne Nicole Loraux[2], avant de désigner un modèle de gouvernement, la démocratie signifie la victoire (le kratos) du peuple (le demos) contre les tyrans. Elle est l’expression d’un soulèvement, d’un mouvement de libération, avant de s’instituer en régime de gouvernement ou en mode d’exercice du pouvoir. C’est l’irruption du « kratos » et la mise en crise du pouvoir qui ouvre et rend possible un devenir collectif. Si le « kratos » de l’antiquité grecque puis celui de la modernité européenne ont été celui du soulèvement d’un peuple (le peuple des hommes), le « kratos » à venir s’indique dans le soulèvement du commun. Ce commun n’est pas du « comme Un », un fond d’identité et d’unité réunissant sous l’insigne de l’universel la diversité des lignes de vie qui le traversent, mais la condition de possibilité d’une multiplicité de devenirs-Collectifs composés à la fois d’humains et de non-humains.
Là où le modèle démocratique moderne institue un espace politique où l’homme se prend pour seule fin du monde, s’opposant à une nature qu’il cherche sans cesse à conquérir et à transformer en l’intégrant dans le système d’une économie globalisée, l’ouverture au commun nous engage à repenser la politique par-delà tout anthropocentrisme, à repenser le rapport de l’humain au monde depuis les choses communes de la nature, d’une nature pensée comme domaine de l’inappropriable. Car la nature n’est pas un ensemble d’objet, un ensemble d’entités discernables et appropriables, mais l’écart qui ouvre à une multiplicité de devenirs-mondes. En tant que lieu de vie commun, elle « n’appartient à personne mais son usage est commun à tous »[3]. C’est pourquoi la condition de possibilité de la multiplicité des formes de vie est indissociable d’un processus de désappropriation qui libère le commun de son appropriation par l’Homme. L’avènement du commun appelle un soulèvement. Ce soulèvement s’effectuera par la vivance des Collectifs et leurs devenirs-mondes.
Une politique du différend
C’est à travers le concept de différend que Lyotard a tenté de penser la multiplicité de ces devenirs-mondes. Le différend s’exprime, selon lui, entre des manières d’être au monde incommensurables les unes aux autres. « On ne peut pas déduire la légitimité de l’une de celle d’une autre. Il y a trois pôles de légitimité : le narratif, la révélation ou obligation, la délibération, ce qui permet de distinguer trois grands modes de l’être-ensemble : les sociétés sauvages et païennes, les sociétés du théologico-politique, la société démocratique-capitaliste, trois rapports au corps : l’inscription de la loi sur le corps, l’incarnation, l’objectivation, trois surfaces d’inscription : la marque et ses supports, l’incorporation, la représentation. Dès lors on dira qu’il y a différend quand un locuteur respectant l’une de ces normes se trouvera comme chez Kafka dans l’incapacité de se faire entendre par le tribunal de l’autre norme. Or la mondialisation a quasiment universalisé la norme de délibération au détriment des autres normes »[4]. Par-delà cette distinction entre trois systèmes de normes, ce qui nous intéresse ici c’est l’idée de différend comme expression du caractère indérivable d’un mode d’être par rapport à un autre. Or c’est ce différend que le processus de globalisation économico-politique impulsé depuis l’Occident ne cesse de nier ou de neutraliser, non seulement en imposant à l’ensemble du monde un seul modèle politique légitime (celui de la délibération) -modèle anthropocentré-, mais aussi en reconstruisant l’espace et le temps mondial depuis le principe d’une loi globale. Comme le montre Lyotard, la question du différend déborde celle du langage rationnel, puisqu’elle met en jeu des rapports sensibles au monde intraduisibles dans les termes d’un langage unique et universel. Etre au monde c’est d’abord être pris dans un rapport sensible à celui-ci, c’est-à-dire s’inscrire dans le mouvement d’un topos, d’un paysage, une manière singulière d’articuler l’espace et le temps. C’est pourquoi la négation des différends à l’œuvre dans la globalisation économico-politique est indissociable d’une manière de reconstruire l’espace et le temps en territoire univoque et homogène décomposable en parcelles (en propriétés matérielles et immatérielles).
En ce sens, ce que l’on a qualifié de « colonisation » ne désigne pas seulement la soumission d’un pays à un autre, d’un Etat à un autre, d’un peuple à un autre, mais l’imposition stratégique à l’ensemble des êtres du monde, qu’ils soient humains ou non-humains, d’un régime de loi et de normes unique. L’arme première de la colonisation n’est autre que l’appropriation et son encadrement juridique. C’est elle qui permet de neutraliser les différends et de nier la multiplicité des formes de vie qui habitent le monde. « Le droit colonial, nous dit le juriste Etienne Le Roy à propos du rapport à la terre de peuples africains, a pour première préoccupation d’effacer plus ou moins substantiellement le droit coutumier au nom de la »civilisation »[5]. […] Le deuxième objectif de la colonisation est de généraliser la propriété privée sur le modèle civiliste de l’article 544 : »Le fait de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue… ». […] Le problème fondamental est que les sociétés africaines ne connaissent pas le droit de propriété privé de la terre […]. On connaît le droit de propriété en Afrique mais on ne connaît pas le droit de propriété foncière. […] On s’efforça d’imposer notre conception comme s’il y avait la possibilité d’une table rase, alors que les africains ont bien sûr d’autres façons d’organiser les rapports foncier qu’en fonction d’un droit de propriété exclusif et absolu »[6]. Pour les africains, « les droits coutumiers sont des droits communautaires ni individualistes ni collectivistes. Ils cherchent un équilibre entre les intérêts du groupe et ceux de l’individu ; équilibre toujours tensionnel, toujours relatif »[7]. Le processus de colonisation s’établit suivant une série d’étapes qui vont de l’imposition d’un régime de droit légitimant l’appropriation des terres, puis le quadrillage de l’ensemble des terres qui oblige les indigènes à « faire avec » le nouveau cadre imposé et, troisième étape, l’intégration de l’indigène lui-même par l’assimilation des normes de vie du colon, jusqu’à effacement complet du différend. C’est un même processus de colonisation/assimilation qu’ont subi les Aborigènes d’Australie.
En 1877, face à l’impossibilité de négocier ou de racheter les terres auprès des indigènes, la couronne britannique légitime l’appropriation individuelle des terres par les colons, appropriation qui se trouvera validée et encadrée juridiquement par le décret de terra nullius édicté en 1889. Ce décret opère une distinction entre « territoires établis » et « territoires inhabités » en s’appuyant sur la théorie de Locke à propos de l’agriculture comme voie d’appropriation. Or on voit ici le coup de force à l’œuvre, coup de force fondé sur une pétition de principe qui présuppose le régime de propriété qu’elle prétend établir. En effet, pour les peuples autochtones (aborigènes), la notion même d’une appropriation des terres n’a aucun sens, et moins encore la distinction entre « territoires établis », c’est-à-dire cultivés et « territoires inhabités », c’est-à-dire non cultivés, puisque ce sont des peuples nomades qui vivent principalement de la chasse et de la cueillette. L’appropriation des terres s’opère sur la négation du différend, c’est-à-dire du mode d’être singulier des Aborigènes. Car là où les colons organisent la parcellisation individuelle du territoire en propriétés, les Aborigènes vivent dans l’expérience d’un commun qui se fait au nom de la Loi (Tjukurrpa) et des récits des itinéraires ancestraux, itinéraires qui président à la formation du paysage, itinéraires manifestés au cours des rituels. Là où il s’agit pour le colon de répondre de soi et de sa propriété, il s’agit pour l’aborigène de répondre de la loi du commun.
Mais la négation du différend s’appuie aussi sur une confusion, celle qui consiste à confondre occupation d’un territoire et habitation d’un lieu de vie. La culture des terres s’indique ici comme vecteur d’appropriation, c’est-à-dire d’occupation stratégique des terres, bien plus que comme mode d’habitation. « L’habitation ne signifie pas selon [Tim Ingold] le fait d’occuper un lieu dans un monde prédéfini pour que les populations qui arrivent puissent y résider. L’habitant est plutôt quelqu’un qui, de l’intérieur, participe au monde en train de se faire et qui, en traçant un chemin de vie, contribue à un tissage et à son maillage. Même si ces lignes sont généralement sinueuses et irrégulières, leur entrecroisement forme un tissu uni aux liens serrés »[8]. Il s’agira, par exemple, de penser la co-existence possible des pistes d’animaux et des pistes d’humains, au sein d’un lieu de vie commun, sans que l’une impose à l’autre sa seule loi. Dans le contexte africain ou australien, cela veut dire que le différend entre colons et indigènes ne passe pas entre vie sédentaire et vie nomade, entre agriculture et chasse-cueillette (puisque certains collectifs africains vivaient aussi selon un mode sédentaire et agricole), mais entre un rapport stratégique d’occupation d’un territoire (c’est-à-dire l’exercice d’un pouvoir de domination) et un rapport d’habitation d’un lieu de vie, entre un régime de comportement imposé à l’ensemble des êtres qui traversent l’espace occupé et un espace-temps stratifié où s’articulent des modes d’être hétérogènes. Le différend culturel recoupe ici un rapport de domination politique qui n’a cessé de se maintenir jusqu’à aujourd’hui. On pourrait même dire qu’il s’est amplifié jusqu’à l’extermination (par assimilation) de toute forme de vie hétérogène[9].
Ainsi, la soi-disant reconnaissance du peuple aborigène par l’établissement du « Native title act », bien loin de laisser place (au sens propre et figuré) au partage du sensible aborigène, a constitué une nouvelle arme dans le processus de colonisation. Ce n’est qu’une fois l’ensemble des terres australiennes appropriées par les colons, que le Native title act a été prononcé. Or celui-ci entraîne la situation paradoxale que les Aborigènes, pour obtenir leur reconnaissance par les occupants, doivent prouver devant le tribunal de ces derniers leur qualité de « natif ». Nouvelle étape de la colonisation qui, après l’occupation des terres, en passe par la conformation du mode d’être aborigène aux lois, catégories et critères du colon blanc. « Les plaignants doivent prouver qu’ils sont bien autochtones et que la colonisation ne les a pas affectés »[10]. On se trouve ici dans la situation caractéristique du tort exprimé par Lyotard. « A la différence d’un litige, un différend serait un cas de conflit entre deux parties (au moins) qui ne pourrait pas être tranché équitablement faute d’une règle de jugement applicable aux deux argumentations. Que l’une soit légitime n’impliquerait pas que l’autre ne le soit pas. Si l’on applique cependant la même règle de jugement à l’une et à l’autre pour trancher le différend comme si celui-ci était un litige, on cause un tort à l’une d’elles (au moins, et aux deux si aucune n’admet cette règle). Un dommage résulte d’une injure faite aux règles d’un genre de discours, il est repérable selon ces règles. Un tort résulte du fait que les règles du genre de discours selon lesquelles on juge ne sont pas celles du ou des genres de discours jugé/s »[11]. Le tort consiste à nier les victimes au titre de simples plaignants à qui l’on doit réparation. Comme si l’extermination pouvait être « réparée », compensée par quelque réparation que ce soit. En faisant des victimes de simples plaignants on les contraint à se nier eux-mêmes, à nier leur singularité, pour pouvoir faire entendre leur parole dans un cadre et un système de référents que, non seulement ils ne partagent pas, mais qui a organisé leur extermination, non pas seulement extermination des Aborigènes pris individuellement, mais aussi de la vivance des collectifs aborigènes, de la singularité de leur devenir-monde. « Le Native title act, nous dit M. Préaud, prend à contre-pied la logique autochtone puisqu’elle va contre la multiplicité »[12], en obligeant les autochtones à s’identifier en groupes territorialisés. En ce sens, le Native title act n’est qu’une nouvelle étape de l’entreprise coloniale qui extermine en assimilant.
De nouvelles luttes de libération : des minorités aux singularités
C’est pourquoi, bien loin de correspondre à une période postcoloniale, la globalisation s’indique plutôt comme tentative de colonisation totale. Totale au double sens où le conflit en jeu n’oppose plus seulement des dominants et des dominés, mais des exterminants et des exterminés, ces derniers désignant non seulement des collectifs humains, mais aussi non-humains, des espèces animales en voie d’ « extinction », des espèces végétales transformées génétiquement, etc. C’est l’ensemble des formes de vie qui se voient ici être l’objet d’une tentative d’appropriation/assimilation/extermination, et plus particulièrement les êtres sauvages : populations autochtones, populations d’animaux[13] ou de plantes sauvages, petit à petit remplacées par des individus culturellement conformés ou génétiquement modifiés. Et si la nouvelle arme de la colonisation totale réside dans les technologies de l’information et de la communication, c’est qu’elles organisent « l’interopérabilité » de toutes formes de vie et d’expressions par l’uniformisation du code informationnel : de l’information électronique au langage humain en passant par le programme ADN de l’organisme, toutes les formes d’expression du monde doivent, en définitive, être convertibles dans les lois d’un régime d’équivalence universel, c’est-à-dire d’un fond « comme Un » défini par l’Homme occidental. « La théorie de la communication détermine une unité comptable en algèbre de Boole pour les phrases en général, le bit d’information. Les phrases peuvent être des marchandises sous cette condition. L’hétérogénéité de leurs régimes ainsi que des genres de discours (des enjeux) trouve un idiome universel, le genre économique, un critère universel, le succès, avoir gagné du temps, un juge universel, la monnaie la plus forte, c’est-à-dire la plus crédible, la plus susceptible de donner du temps, donc d’en recevoir. […] Les différends entre régimes de phrases ou entre genres de discours sont jugés négligeables par le tribunal du capitalisme. Le genre économique avec son mode d’enchaînement nécessaire d’une phrase à l’autre écarte l’occurrence, l’événement, la merveille, l’attente d’une communauté de sentiment. »On en finira pas » de prendre en considération l’incommensurabilité des enjeux et le vide qu’elle ouvre d’une phrase à l’autre »[14].
Penser le commun depuis la fêlure ou l’écart ce sera au contraire rendre possible l’expression des différends et donc de la multiplicité des formes de vie qui habitent le monde, ce sera penser le commun comme lieu de la non-homogénéité, de la non-équivalence. Le commun désigne l’espacement d’un être-avec sensible qui s’actualise dans l’expérience d’un topos (paysage). C’est ce rapport au topos qui distingue les luttes de types minoritaires des luttes autochtones – qui rejoignent de ce point de vue les luttes de communautés locales avec cette caractéristique commune d’avoir des « connaissances traditionnelles et de développer un usage coutumier de la diversité biologique, c’est-à-dire des espèces, des écosystèmes, etc »[15]– . Là où les luttes minoritaires s’inscrivent dans une démarche de revendication d’égalité de droits à l’intérieur du cadre référent de la majorité[16], participant ainsi, paradoxalement de la neutralisation du différend, les luttes autochtones expriment un différend radical qui en passe par d’autres manières d’habiter l’espace et le temps, qui remettent en question le cadre même imposé par le dominant[17]. C’est de ce différend (et non d’une différence) que témoigne Bronwyn, cette femme aborigène noire : « Nous les Noirs, on a jamais trop été féministes… Je pense que les féministes blanches nous ont vraiment fait du tort, aux femmes noires… Parce que t’as des femmes noires qui disent : »on est femmes avant d’être des Aborigènes ». Je pense pas que ce soit vrai… Parce que tu ne peux pas te permettre ce genre de choses quand tu as une lutte raciale, quand il y a un danger d’extinction… Tu ne peux pas te le permettre… »[18].
Ici s’indique une différence entre ce que l’on pourrait appeler des mouvements d’émancipation qui engagent la reconnaissance du dominé par le dominant, ce dont relèvent les luttes minoritaires, et des mouvements de libération qui mettent en question le cadre dominant de référence lui-même, affirmant leur puissance d’être par leur refus du pouvoir (refus d’occuper des positions dominantes dans la société de référence par exemple, c’est-à-dire à devenir d’une manière ou d’une autre « propriétaire » d’un « capital », qu’il soit matériel ou immatériel, quitte à se retrouver en situation de marginalité ou de précarité à l’intérieur du système). C’est pourquoi Jean-Louis Déotte a raison de dire que, à la différence de la politique du différend formulée par Lyotard, la démocratie pensée depuis l’épreuve d’une « mésentente », ainsi que l’envisage Rancière[19], ne fait que reconduire et présupposer le système de références dominant, la légitimité de son cadre politique. « Les sans-part, ces nouveaux prolétaires, décrits par Rancière dans La Mésentente parce qu’ils inaugurent une nouvelle place publique et donc un autre partage du sensible, inventent de nouveaux mobiles à l’action, de nouvelles revendications et de nouvelles argumentations. Mais parce qu’ils ont à convaincre le public de la justesse de leur mouvement, ils entrent nécessairement sous l’orbe de la norme délibérative. D’ailleurs, en cas de succès, ils rejoindront le monde légitime de ceux qui prennent part à la vie politique, sans reste. Les anciennes discriminations vont sauter, les femmes seront citoyennes à part entière, etc. Mais les sans-part auront dû se soumettre au principe de raison, ce n’est qu’à ce prix que leur révolte acquerra une légitimité. […] On pourrait dire, en reprenant le constat du Marx de La Question Juive : il condamne les sauvages, les païens et autres monothéistes à faire fi de leur communauté et à devenir des individus monadiques : démocratiques »[20].
L’autochtone est celui qui a subi le tort irréparable de la colonisation et/ou d’un massacre : d’une volonté d’extermination. Seule une décision politique, au sens de l’irruption d’un « kratos » peut répondre d’un tel tort. Celle-ci suppose de remettre radicalement en question cela même qui a organisé et continue d’organiser l’extermination de la multiplicité des formes de vie, c’est-à-dire le processus d’appropriation du monde par l’Homme. Elle nous engage à un processus de désappropriation par-delà tout anthropocentrisme, c’est-à-dire à une autre manière d’habiter le monde qui prenne en compte la multiplicité des formes de vie qui le composent. En ce sens la désappropriation suppose l’ouverture d’un tiers espace par-delà le partage public/privé (Etat/individu), partage qui reste pris dans la logique propriétaire puisque le public s’envisage comme propriété collective des hommes. Ce tiers espace doit donc aussi se penser par-delà le partage nature/culture, puisqu’il n’appartient pas à l’homme pensé dans son opposition à la nature. Cet espace n’appartient à personne : c’est l’espace des choses communes.
De l’inappropriable : le commun
Dans son ouvrage L’ennemi de tous, le pirate contre les nations, Daniel Heller-Roazen revient sur une distinction faite dans le droit romain entre trois types de choses inappropriables : les res publicae, les res universitatis et les res communis omnium (les choses publiques, les choses universelles et les choses communes). « Les choses publiques appartiennent au peuple romain, donc, par extension, à sa forme institutionnelle, l’Etat. Certaines sont destinées à un usage collectif, comme les rues et les places, les théâtres et les thermes ; d’autres, comme les esclaves, les mines et l’argent, servent les fins administratives de la République romaine. Nombre d’auteurs latins évoquent aussi des choses universelles ; si elles ressemblent formellement à celles qualifiées de »publiques », elles se reconnaissent au fait qu’elles n’appartiennent pas à la capitale mais à d’autres cités avec lesquelles elle est en relation. Enfin, pour les juristes, un troisième ensemble de choses extérieures à notre patrimoine se trouve dans la nature. Ce sont celles qui sont, par définition, »communes à tous ».[…] Les »choses communes », à la différence de toutes les autres, ne relèvent ni de la loi humaine, ni de la loi divine. C’est pourquoi aucun être unique – qu’il soit privé ou public, humain ou divin, vivant ou mort – ne peut les revendiquer légitimement. Elles sont directement issues d’un type de droit plus archaïque que le droit civil et le droit des gens, celui que les juristes romains appelaient le »droit naturel ». Pour les hommes de loi, sinon pour les philosophes, c’était un ordre juridique commun à tous les êtres vivants, les animaux comme les humains. Le Corpus iuris le décrit constamment en termes négatifs. »[21]
Or une disposition tirée de ce droit romain se trouve dans le Code Civil français de 1804 ; il s’agit de l’article 714 qui tient en deux alinéas :
« Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir ».
A partir de cette disposition, des juristes cherchent actuellement à formuler les bases d’un droit de l’environnement. Aussi, comme nous le rappelle le juriste Benoît Jadot[22], si les res communes figuraient dans le droit romain parmi les res nullius humani juris, c’est-à-dire parmi les choses n’ayant pas de maître mais pouvant faire l’objet d’une appropriation, les res communes se distinguaient des res nullius en tant qu’elles correspondaient « à ces choses que la nature a produites pour l’usage de tous. Elles sont données au genre humain et présentent des caractéristiques inépuisables : l’air, la lumière du soleil, l’eau courante, la mer et ses rivages, les animaux sauvages ». Ainsi les res communis ne peuvent être appropriées. Elles doivent être préservées dans leur globalité pour qu’elles puissent se régénérer[23] et l’on ne peut en user que localement et temporairement d’une façon passive ou active : respirer l’air, puiser de l’eau, pêcher des poissons dans la mer. « Ce faisant ils exercent sur la res communis un droit qui est un droit d’usage lequel doit être mis en œuvre de manière à ne pas gêner le droit d’autrui et en veillant à ce que la res communis conserve son caractère commun ».
Aussi, si les agents de la colonisation moderne ont trouvé leur principe de légitimation dans la disposition juridique du res nullius, c’est précisément en tant qu’ils opéraient volontairement la confusion de la res communis et de la res nullius (confusion criminelle car elle évacue ce qui rend possible la vie même : les res communes), leur permettant ainsi de réduire :
- le point de vue de la « totalité » (le commun non appropriable) au point de vue de la « particularité » (la parcelle) ;
- le droit d’usage au droit d’appropriation.
Sur le plan juridique l’enjeu consiste à rétablir la distinction entre res nullius et res communes, c’est-à-dire à extraire l’article 714 des dispositions générales du Code civil relatives aux différentes manières dont on acquiert la propriété pour repenser l’ensemble du droit (et d’abord du droit foncier) à partir de lui.
Cela implique notamment de rompre avec la conception de la propriété telle qu’elle a été formulée par Locke, conception anthropocentriste qui reconduit la double réduction mentionnée ci-dessus.
« Un homme qui se nourrit de glands qu’il ramasse sous un chêne, ou de pommes qu’il cueille sur des arbres, dans un bois, se les approprie certainement par-là. On ne saurait contester que ce dont il se nourrit, en cette occasion, ne lui appartienne légitimement. Je pose donc la question suivante : Quand est-ce que ces choses qu’il mange commencent à lui appartenir en propre ? Lorsqu’il les digère, ou lorsqu’il les mange, ou lorsqu’il les cuit, ou lorsqu’il les porte chez lui, ou lorsqu’il les cueille ? Il est visible qu’il n’y a rien qui puisse les rendre siennes, que le soin et la peine qu’il prend de les cueillir et de les amasser. Son travail distingue et sépare alors ces fruits des autres biens qui sont communs ; il y ajoute quelque chose de plus que la nature, la mère commune de tous, n’y a mis ; et, par ce biais, ils deviennent son bien particulier.[24] »
On voit chez Locke, dans son Traité du gouvernement civil, comment s’opère le glissement qui associe « l’appropriation » comme droit d’usage, c’est-à-dire comme temporaire et particulier, circonstanciel ou contingent, à l’appropriation comme droit de possession, essentiel à la condition humaine, c’est-à-dire comme « propre ». Chez Locke, cette définition permet notamment de répondre à la problématique de l’esclavage, en faisant de chaque être humain le possesseur de son corps et par extension de ce que le corps « met » de lui-même dans la nature par son travail.
Ainsi, la conception de la propriété lockienne suppose une rupture radicale entre le règne humain et le règne de la nature, ce qui justifie le recours au contrat social. Si la nature peut être soumise en « esclavage », livrée à la totale domination de l’humain (dans et par le travail), c’est en tant qu’elle appartiendrait à un règne de choses distinctes par essence. Ainsi, ce qui chez Locke justifie l’appropriation de la nature par l’homme tient dans l’articulation d’une double propriété : celle d’un propre de l’homme (générique) s’opposant à la nature, et celle du propre d’un homme (particulier) s’appropriant la nature. Locke pense le rapport de l’homme à la nature (comme monde du commun) du point de vue de l’individu-monade, d’un être clos sur lui-même, et jamais du point de vue collectif : il pense le général à partir du particulier.
L’ambition d’une réappropriation collective qui s’inscrit au cœur de la perspective marxienne et des luttes politiques qui s’en inspirent correspond à la volonté de rompre avec ce postulat individualiste. Mais cette perspective de réappropriation maintient l’idée d’un propre de l’homme (générique) distinct en nature des autres formes de vie et de non-vie qui forment le monde, c’est-à-dire d’une domination de la nature par l’homme[25]. Elle ne permet pas de prendre en compte l’extermination dont est victime la multiplicité des formes de vie de la nature. C’est ce que Deligny nous dit aussi à sa manière : « Je lui disais qu’entre le commun que j’essaie d’évoquer et le communisme, il n’y a pas, comme on pourrait le croire en se fiant au son des mots, un isthme qu’il serait facile de traverser à pied sec. Il y va d’une fêlure, d’une faille, à vrai dire infranchissable, le commun étant d’espèce et le communisme, l’à-faire des hommes, plutôt portés à dominer, c’est-à-dire à se croire.[26] »
Or, le geste d’appropriation de la nature qui se développe aujourd’hui à partir des nouvelles découvertes de la génétique (et de manière plus générale à travers la techno-science) nous oblige à penser la condition humaine dans la perspective d’une libération de la nature qui le déborde. Ce qui s’était originellement défini dans le double mouvement d’une libération de l’homme de sa condition d’esclavage et d’une domestication de la nature par les mains de l’homme, se transforme en processus de domestication généralisé. La domination technologique donne corps à cette impasse : à travers elle l’homme se soumet, au même titre que le reste de la nature, à sa propre domestication, devenue un processus autonome et automatisé. La domination technologique nous place devant ce constat que l’être humain fait partie d’un ensemble, tout en cherchant à soumettre cet ensemble aux seules règles anthropocentrées automatisées en dispositifs. C’est pourquoi elle postule une approche écosystémique (d’inspiration cybernétique) de cet ensemble pensé, suivant un modèle mécaniste, comme interaction d’éléments ontologiquement homogènes. La chose particulière ne serait qu’une partie subdivisible du tout, la pièce remplaçable d’une totalité. Et si elle intègre une dimension dite « immatérielle » (la qualité de vie, par exemple) c’est toujours en tant que celle-ci peut faire l’objet d’une mesure, d’une quantification, d’une objectivation, d’une « évaluation ». Ce qui se trouve ainsi évacué de la problématique du commun, c’est toute cette part inobjectivable du Collectif : ce qui tient du sauvage et de l’inappropriable.
Au seuil du politique : du hors économie et du hors droit
Redonner une place aux choses communes c’est, dans la perspective du droit de l’environnement, penser un droit d’usage distinct du droit de propriété. En effet, la chose commune, comme le rappelle Jean-Yves Cherot, n’est pas « un bien commun dont la régulation ne dépendrait que de l’arrangement éventuel entre les usagers de la chose. Par définition ce n’est pas une propriété et les relations sur l’usage de la chose ne sont pas réglées par convention entre des propriétaires agissant collectivement. Les titulaires d’un droit sur les choses communes n’ont pas de titre de propriété.[…] Le statut de chose commune empêche le marché de fonctionner en faisant sortir la gestion des choses communes du jeu des négociations contractuelles ». A la différence des biens, les choses communes sont inappropriables. Il en va ainsi pour l’eau, l’air, les animaux sauvages, mais cela pourrait valoir pour l’ensemble des choses du monde. Ainsi que le signale Alain Sériaux : « L’article 714 du Code civil demeure volontairement non limitatif. »Il est des choses… » se borne-t-il à affirmer. Dès lors, rien n’interdit au juriste d’imaginer, au chapitre des choses communes, d’autres biens que l’air, l’eau ou le vent. Pourquoi pas la lumière, comme le suggère Demolombe ? Et au-delà les astres, les planètes, la faune, la flore, ou, plus rationnellement, tout ce qui contribue peu ou prou à l’agrément de la vie des hommes sur terre, à ce qu’il est aujourd’hui convenu de nommer l’équilibre écologique de notre planète ? […] A rallonger encore la liste, l’on découvrirait peut-être qu’au fond, tout est commun à tous, car, dans une mesure variable, même les choses que d’aucuns possèdent en propre, ont une dimension collective. N’importe quel lopin de terre ferait banalement l’affaire. Dans nombre de sociétés traditionnelles, celles des chasseurs-cueilleurs notamment, la terre est traitée comme une chose commune. […] L’on perçoit par là la force littéralement explosive de la notion de chose commune. Si tout est commun, comment justifier alors l’appropriation, qu’elle soit privative ou même collective ? Alors qu’au fil des siècles qui nous ont précédé la grande question juridique sur laquelle s’appuyaient toutes les autres fut celle de la propriété, il n’est pas excessif de dire qu’aujourd’hui les termes du débat se sont renversés. »[27] En distinguant la chose commune du bien commun, il s’agit de dégager un domaine de choses et de valeurs qui ne peuvent faire l’objet d’un commerce, d’une négociation, d’une économie.
Mais la limite du droit de l’environnement réside dans le fait de penser encore ce tiers espace comme « patrimoine commun de l’humanité ». Ce que confirme le terme même d’ « environnement » qui désigne un ensemble de choses relatives à l’homme. C’est toujours du point de vue de la vie humaine que la question du commun se trouve posée. En ce sens elle ne rompt pas avec la conception même qui rendit possible la confusion entre res communes et res nullius. En effet, c’est ne pas voir que l’anthropocentrisme est au fondement de la généralisation de la logique économique et propriétaire. Cette position ambiguë du droit de l’environnement qui s’exprime dans la notion de « patrimoine commun de l’humanité » tient sans doute au statut paradoxal du droit par rapport aux choses communes qui constituent en tant que telles un domaine hors droit. « Enoncer que les choses communes n’appartiennent à personne conduit à dire que celles-ci échappent à toute maîtrise juridique, sont, comme on l’a vu en présentant les res communes romaines, hors du commerce. Il en va de même du droit de vivre dans un environnement conservé, dès lors que ce droit, inhérent à l’existence même de la personne humaine, s’analyse en une prérogative extra-patrimoniale. Ainsi, l’environnement et le droit de vivre dans un environnement conservé ne peuvent se prêter aux transactions juridiques »[28].
Seule une prise en compte du hors droit peut accueillir le différend, permettre une sortie du régime de l’équivalence généralisée et la considération de la valeur incommensurable des différentes formes de vie du monde. Mais alors, comment penser le statut du droit dont la fonction a principalement été de contresigner la mainmise de l’homme sur le monde ? C’est ce que nous rappelle à sa manière le juriste François Ost dans son introduction à « Quel avenir pour le droit de l’environnement ? » : « Science et droit modernes partagent un même paradigme : il y a partage absolu, dualisme radical entre le sujet et l’objet. Par la pratique scientifique, le savant s’arroge une maîtrise sans frein sur la nature, que prolonge, en droit, le statut quasi souverain de la propriété. De plus, depuis la modernité, le rapport droit-science est surdéterminé au profit de la science qui s’est auto-proclamée détentrice d’une vérité absolue, objective, intemporelle, placée en dehors de tout arbitrage socio-politiques. Le droit de l’environnement contemporain traduit ce double asservissement : asservissement des choses sous le régime de l’appropriation privée et de la gestion technocratique, asservissement du droit qui perd son rôle de médiateur pour se réduire à celui de notaire de la norme scientifique. […] Ce n’est que dans la mesure où il réussira ainsi à maîtriser notre maîtrise de la nature, que le droit assurera sa fonction de médiation qui doit l’amener non à s’aligner sur le fait mais à instituer du sens (au prix de la contrefactivité), ni à renforcer les pouvoirs dominants – ici le pouvoir de la technoscience – mais à instaurer partout des contre-pouvoir[29] ». Or cette fonction médiatrice doit se penser au-delà d’une responsabilité collective de l’humanité face à une nature qu’elle devrait respecter. Si le droit doit se faire l’expression d’une décision politique, ce ne sera pas au sens d’un changement dans le mode de gouvernement mondial, mais dans la capacité à engager un processus de désappropriation qui démette l’homme de sa position de toute puissance pour le réinscrire dans le mouvement du naturer dont il est indissociable. C’est alors le statut du droit qui devra être radicalement repensé, en lui donnant un nouveau sens dans et à partir des choses communes, c’est-à-dire d’un espace qui se situe nécessairement hors droit, hors de l’emprise et de la décision de l’homme. Il s’agirait alors de penser le droit en relation à des coutumes. Le droit serait moins ce qui assoie la main-mise de l’homme sur les êtres de nature que l’articulation médiatrice qui, dans et à travers des pratiques et usages, ré-ouvre l’écart, l’espacement d’un hors droit et pose une limite à la volonté d’appropriation de l’homme. Il y aurait ici d’une certaine manière un retournement de la fonction du droit par rapport au rôle qui lui a été attribué tout autant chez les romains que dans la modernité européenne, c’est-à-dire celui de garantir et légitimer une propriété, d’assurer le contrôle d’un territoire par un pouvoir. Dans cette perspective, la problématique de l’usage constitue un point d’appui qui doit permettre de rompre avec la logique propriétaire, d’ouvrir un art du passage contre la logique de gouvernement (l’Etat) et son corollaire économique, le commercialisable (le privé).
Le juriste Alain Sériaux propose de penser l’usage dans les termes de l’usufruit marquant ainsi l’écart entre la jouissance d’une chose et sa disposition absolue (appropriation). « Quiconque capte à son profit telle ou telle parcelle d’une chose commune ne saurait ensuite la commercialiser : la mettre dans le commerce pour en tirer des bénéfices. […] Cette extra-commercialité radicale ne fait bien entendu pas obstacle à ce que cet exploitant soit rémunéré pour le temps et les matériaux dépensés pour que les choses communes puissent être transmises à autrui, mais elle s’oppose en revanche à tout versement d’un prix pour la chose captée elle-même. » Le privilège accordé à l’usage doit permettre d’éviter le pillage des choses communes et l’épuisement des ressources vitales par la prise en compte d’autrui (dans l’espace, la « communauté des autres », et dans le temps, les « générations futures »). En effet, même chez les romains, le maintient hors du droit (et du commerce) des choses communes exprimait l’existence de devoirs élémentaires, ceux consistant à ne pas priver quelqu’un de ce qui est indispensable à la vie.
L’approche juridique en termes de choses communes ouvre une politique du différend en préservant l’hétérogénéité des formes d’expression du monde. Elle préserve ce qui des choses communes échappe au droit, c’est-à-dire aussi à toute définition strictement « positivable », objectivable.
La démesure du sensible
Déployer l’espace des choses communes ce sera accueillir l’hétérogénéité des formes de vie sans hiérarchisation des unes par rapport aux autres selon leur plus ou moins grande « pauvreté en monde ». Car c’est l’être-avec de la multiplicité des expressions souveraines qui font monde, sa richesse et son sublime. C’est pourquoi l’usage ne peut être réduit à la seule logique instrumentale et utilitaire d’un partage économique des « biens » entre les hommes. La question de l’usage va au-delà de la question utilitaire – même si vitale – de l’épuisement des ressources. Car penser la nature en termes de ressources exploitables, c’est encore reconduire la logique économique d’appropriation de la nature, réduisant celle-ci au statut d’objet manipulable. Il faudrait penser l’usage en termes de praxis prise dans un topos, praxis qui engage un rapport sensible au monde, par-delà le partage sujet-objet, c’est-à-dire un rapport pathique de co-naissance, un ethos. C’est le partage du sensible dont elle est porteuse qui fait la qualité de la praxis : la qualité de son affectuation.
Le commun réside dans le « commerce » (Umgang) inintentionnel entre des corps, dans l’ambiance pathique provoquée par leur rencontre. Contre le commerce criminel des corps par l’économie capitaliste, il s’agit de se rendre sensible au mouvement pathique des corps en commerce (Umgang). Le commun des choses communes est la condition de possibilité du commun de l’être-avec pathique des êtres du monde, de la singularité d’un partage du sensible. C’est pourquoi, l’usage n’est pas autre chose qu’une affectuation, un usage affecté et affectant, une technique d’inscription sensible dans le topos (paysage), et non un ensemble d’actions performatives qui s’appuient sur des technologies stratégiques d’occupation.
Distinguant l’usage actif de l’usage passif, Alain Sériaux définit ce dernier en ces termes : « on jouit de la présence des choses communes sans avoir pour autant à en dériver définitivement vers soi une parcelle. Se promener en barque sur une rivière, respirer l’air pur des hauteurs, admirer la beauté d’un paysage ou se laisser doucement caresser par les rayons du soleil ». « L’usage » engage ici d’abord une relation sensible au paysage. Or ce qui vaut pour l’usage passif vaut tout autant pour l’usage actif, c’est-à-dire pour l’ensemble des activités transformatrices des choses communes. Transformer ne veut pas dire s’approprier mais inventer une technique d’articulation, un être-avec singulier qui n’épuise ni ne fonctionnalise pour un usage unique le mouvement du naturer. Le geste technique doit alors se penser comme articulation d’un sensible. Le sensible se déploie selon trois dimensions hétérogènes et indissociables. Il y a d’abord le sensible comme multiplicité des écarts, des variations et inadéquations par où se déploie le mouvement du naturer. Il y a, ensuite, la part sensible à l’oeuvre dans les usages des choses communes, c’est-à-dire dans la capacité à accueillir la multiplicité des formes de vie de la nature et à en permettre le renouvellement. Et enfin, les différentes formes d’expressions attachées à ces usages en fonction des manières de vivre mises en jeu : expression écologique, affective, esthétique, mémorielle, sacrée…[30]
Cette part sensible fait que la vie ne se réduit pas à du vivant pensé en terme de matériel (génétique) ou de matériau (cellule). Si une partie du vivant peut être soumis à la logique de la mesure et de la manipulation[31], la vie, elle, est démesurée. Et c’est cette démesure qui s’exprime à travers les expressions souveraines et inappropriables de la nature.
Le droit de l’environnement commence à prendre en compte cette dimension incommensurable du sensible. Ainsi dans le cas du cèdre du Liban jugé par le tribunal d’instance d’Avignon le 3 novembre 1992 à propos d’un litige entre deux voisins. Le propriétaire demande à son voisin de couper les branches du cèdre en s’appuyant sur l’article 673 du Code civil[32]. Mais, « le tribunal observant qu’une telle coupe »pourrait entrainer le dépérissement du conifère […] conséquence qui, eu égard à la valeur inestimable de cet arbre, serait sans commune mesure avec le désagrément occasionné par quelques branches se trouvant au-dessus d’une piste bétonnée utilisée comme aire de stationnement ». […] »La raison impose d’interpréter les dispositions contenues dans le Code civil en tenant compte de préoccupations tant écologiques qu’esthétiques ignorées par le législateur à l’époque et qui préside actuellement à l’émergence d’une législation tendant à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine naturel » ».
Seule la prise en compte de la dimension sensible (qui trouve ici son expression dans la dimension esthétique) peut être à la hauteur incommensurable du sublime qui s’exprime dans le mouvement du naturer. Aucun système d’équivalence, aucun discours scientifique, ne peut l’accueillir dans toute son ampleur, puisqu’il les déborde toujours déjà. Et cela car, comme le disait Whitehead, « les bords de la nature sont toujours en lambeau », ce qui veut dire que la nature n’est pas une totalité écosystémique que l’on pourrait réguler comme une machine. Elle est l’écart même d’une inadéquation qui ouvre et rend possible une multiplicité foisonnante, débordante, écart qui produit du différend. Et si l’animal constitue, pour Lyotard, la victime absolue, c’est qu’il est, comme l’ensemble des êtres de nature exclus de la sphère du langage délibératif, le représentant d’un rapport au monde qui passe d’abord par du sensible. « Le différend est l’état instable et l’instant du langage où quelque chose qui doit pouvoir être mis en phrase ne peut pas l’être encore. Cet état comporte le silence qui est une phrase négative, mais il en appelle encore à des phrases possibles en principe. Ce que l’on nomme ordinairement le sentiment signale cet état. »On ne trouve pas ses mots », etc. […] C’est l’enjeu d’une littérature, d’une philosophie, peut-être d’une politique, de témoigner des différends en leur trouvant des idiomes. »[33]
Mettre en oeuvre une « politique du différend », ce sera rendre possible les conditions d’un être-avec qui ne se réduise pas à un ensemble fini de relations mais qui engage toujours un écart inappropriable, une dimension sensible qui échappe à toute unité de mesure : ce que, couramment, l’on appelle la « vie ». Cette « politique du différend » est indissociable d’un soulèvement du commun, car le commun est ce qui sauvegarde la vie comme capacité d’advenue au monde et donc comme possibilité d’une multiplicité de devenirs-mondes.
(article publié dans la Revue Outis n°4, 2/2013, « Desconstructing democracy »)
[1] Hannah Arendt, L’Impérialisme – Les origines du totalitarisme, Trad. Martine Leiris, Fayard, Paris, 1982, p. 35.
[2] La Cité divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes, Paris, Payot, « Petite Bibliothèque Payot », 2005
[3] Extrait de l’article 714 du Code civil définissant les choses communes.
[4] Jean-Louis Déotte, Lyotard, penseur du différend culturel, http://revues.mshparisnord.org/appareil/index.php?id=115
[5] Le colonisateur arrive avec une conception du droit de propriété depuis le mouvement physiocratique du 18ème siècle qui est synonyme de civilisation (depuis l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme).
[6] Etienne Le Roy, in Droit et environnement, p. 73, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1995.
[7] Etienne Le Roy, Ibid., p. 83.
[8] Tim Ingold, Une brève histoire des lignes, éd. Zones sensibles, 2011.
[9] Et cela en dépassant progressivement les clivages « raciaux » puisque des « noirs » peuvent se comporter en colons tout autant que des « blancs ».
[10] Martin Préaud, « La terre à plusieurs, territorialités autochtones et déterminations juridiques australiennes »,Revue Multitudes n°41, p. 89, 2010.
[11] Jean-François Lyotard, le Différend, éd. de Minuit, Paris, 1984; p. 9
[12] Martin Préaud, op. cit.
[13] En 2008, la revue Nature informait des recherches en génie génétique menées par une équipe de chercheurs anglo-malaisiens pour la modification de moustiques porteurs de la dengue. L’argument sur lequel s’appuie cette recherche est : la lutte contre la dengue, maladie qui affecte en Malaisie une grande partie de la population. « Afin de lutter contre ce fléau, l’Institute for Medical Research de Kuala Lumpur a annoncé récemment être prêt à disperser des millions de moustiques mâles de l’espèce Aedes aegypti, espèce propageant le virus de la dengue, modifiés par génie génétique afin d’engendrer une descendance non viable (mort au stade larvaire). Les chercheurs malaisiens assurent qu’en concurrençant leurs homologues fertiles, ces mâles GM devraient provoquer un effondrement des populations de moustiques. » La modification génétique vise à « remplacer la population sauvage » par une population inoffensive du point de vue de la santé publique. http://www.spectrosciences.com/spip.php?article94
[14] Jean-François Lyotard, op. cit., p. 255.
[15] Armelle Guignier, « Le rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans le développement durable : figurants ou acteurs », Mémoire de DEA, in Cahier du CRIDEAU, n°11, Presses Universitaires de Limoges.
[16] Il s’agit, pour les minorités, d’être pris en compte dans le cadre normatif du dominant selon les termes d’une stratégie qui vise à une transformation de ce cadre de l’intérieur, comme on peut le voir dans la plupart des luttes minoritaires : mouvement féministe, gay et lesbien, mais aussi dans le mouvement des droits civils des noirs américains, etc.
[17] C’est parce qu’ils n’ont pas pu ou voulu intégrer le système dominant, que les peuples autochtones, en particulier améridiens et aborigènes, ont été physiquement exterminés.
[18] Bastien Bosa, Itinéraire aborigènes, éd. Karthala, Paris, 2012, p. 616.
[19] Jacques Rancière, La mésentente, éd. Galilée, Paris, 1995
[20] Jean-Louis Déotte, Ibid.
[21] Daniel Heller-Roazen, L’ennemi de tous, le pirate contre les nations, éd. du Seuil, Paris, 2010, p66
[22] Dans son excellent article : « L’environnement n’appartient à personne et l’usage qui en est fait est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir », in Quel avenir pour le droit de l’environnement ? Actes du colloque organisé par le CEDRE et le CIRT, sous la direction de François Ost et Serge Gutwirth, Facultés universitaires Saint Louis, Bruxelles, 1996.
[23] Et éviter le risque d’extinction.
[24] John Locke, Traité du gouvernement civil.
[25] Ce que reconduit à nouveau frais la théorie productiviste du Commonwealth de Tony Negri.
[26] Fernand Deligny, L’Arachnéen et autres textes, éd. L’Arachnéen, Paris, 2008, p. 192
[27] Alain Sériaux, Droit et environnement, Presses universitaires d’Aix-Marseille, Marseille, 1995, p. 24-25
[28] Benoit Jadot, in Quel avenir pour le droit de l’environnement ?, éd. des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1996, p. 127
[29] François Ost, in Quel avenir pour le droit de l’environnement ?, op. cit. p. 7-8
[30] Ainsi un cours d’eau sera, selon l’usage, considéré pour sa dimension écologique, sacré, ou esthétique, etc.
[31] Ainsi que l’établit la « logique du vivant » d’un François Jacob.
[32] Article 673 : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
[33] Jean-François Lyotard, op. cit., p. 29-30.