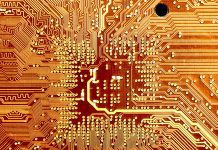Paul Blanquart, sociologue et philosophe, est profondément animé par le désir de nourrir une rencontre entre le christianisme – un christianisme marxiste révolutionnaire – et les diverses formes que peuvent prendre les mouvements d’émancipation sociale. L’écologie, à ses yeux, est de ces mouvements à rencontrer et à aimer.
Né dans le Nord de la France en 1934, Blanquart a été marqué depuis sa jeunesse par le mélange entre christianisme et marxisme caractéristique d’une large frange du syndicalisme ouvrier de cette région. C’est ainsi qu’il entre à vingt-deux ans chez les frères dominicains en pensant y trouver une « institution prophétique », donc ouverte à la critique sociale. Il a été actif sur bien des fronts. À l’international, il a entretenu des contacts avec les révolutions d’Amérique Latine et d’Afrique par exemple. En France, il fait partie des fondateurs du journal soixante-huitard Politique Hebdo, puis du mouvement Chrétiens-marxistes en 1974.
En 1977, il rejoint l’équipe d’un journal écolo militant, La Gueule Ouverte, fondé par Pierre Fournier avec l’aide de Charlie Hebdo. C’est de cette période que date sa rencontre avec l’écologie, qui se poursuit notamment aujourd’hui au sein de la fondation Un monde par tous1.
De ces mélanges et de ces rencontres est née une pensée singulière et inspirante, dont le texte que nous publions ici suit le flot. Comme une invitation à ce que, au fil de l’eau, le courant marxiste chrétien puisse rencontrer les autres sources de l’écologie politique française pour former un fleuve bouillonnant de vigueur et de diversité2.
Les aventures du ciel et de la terre3
Écrites à l’heure où la planète se meurt et l’humanité avec elle.
Avec la question : la foi peut-elle aider à les sauver toutes les deux, contribuant ainsi à la raison écologique ?
Ce que l’on se raconte est inséparable de la façon dont on se comporte. L’imaginaire et le réel renvoient l’un à l’autre dans une histoire. Factum (le fait) est un doublet de fictum (la fiction) et leur combinaison constitue le sens, orientation et signification. À des œuvres de fiction différentes voire opposées correspondent donc des manières d’être et d’agir distinctes voire contradictoires.
Or la Bible est une œuvre composite, où se mêlent en conflits et tiraillements multiples deux fictions-réalités antagonistes, qu’on a cependant qualifiées d’un même nom : « Dieu ». Contre cet amalgame, je distingue pour ma part D1 et D2.
Commençons par D2. 2 parce qu’il est historiquement et culturellement dominé par l’autre qui est donc 1, beaucoup plus ancien et répandu que lui. Mais il mérite d’être considéré en premier, car il est singulier, l’à part, le proprement biblique qui échappe à D1, lequel va s’introduire dans le Livre pour le contaminer. Beaucoup plus tard, dans un contexte mental plus proche du nôtre et dont il sera question plus loin, Pascal fera clairement la distinction : « Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, non des philosophes et des savants ».
Abraham, donc. Dans le récit, D2 lui dit : quitte (ton pays, ta parenté), sors. Je pense à « L’homme qui marche » de Giacometti. Quand on marche, on se met en mouvement, on n’est plus à une place assignée, clos dans une identité fixe. On décroche, on déroche y compris de soi-même, on a son centre de gravité hors de soi. Bref, on ek-siste4, dans un vide.
À Moïse, D2 dit la même chose : va. Mais il ajoute : je serai avec toi. C’est quoi, « je », c’est qui ? Réponse : je n’ai pas de nom, on ne peut pas me définir. Avec toi, je ne suis pas comme toi. À vrai dire, je ne suis pas comme quoi que ce soit, je ne suis rien de ce qui est : je suis l’Autre. D’une altérité irréductible, toujours à découvrir dans cette marche : je serai qui je serai. Telle est ma transcendance. Non celle d’un ailleurs, d’un au-dessus, d’un plus tard, d’un ciel. Mais celle de l’Autre ici, maintenant, à ta hauteur, sur terre. En toi. Car cette marche que nous faisons ensemble t’altère. En t’ouvrant sans passivité (tu marches), tu te creuses une intériorité, une subjectivité qui te fait être toi comme on ne l’a jamais été. Le vide s’en remplit d’un entre autres qui différencie, singularise chacun tout en le liant à d’autres. L’existence, c’est du relationnel, fait de rencontres et non d’états, d’évènements et non de permanences. En fin de compte, ce dont nous parle cette histoire de marche et de compagnonnage, c’est tout simplement de la vie en tant qu’elle est vivante. Elle est animée de confiance en l’Autre, en tout autre. L’homme qui marche devient homme de foi.
Mais cet imaginaire et la façon correspondante de se penser et de se comporter n’ont cours que chez un petit peuple, dans un petit coin, dans une bordure toujours menacée d’invasion. Car tout autour, en Mésopotamie et en Egypte, s’étalent de vastes empires, prétentieux et puissants, qui ne cherchent qu’à s’étendre. Et là, le ciel commande à la terre.
Ce ne sont en effet que tours, pyramides, ziggourats à étages, forme monumentale d’une même hiérarchie structurant chaque domaine. Escalier cosmique, du minéral au céleste, en passant par le végétal, l’animal et l’humain (hommes au dessus, femmes en dessous). Échelle sociale : le paysan est tout en bas qui gratte la terre, l’intellectuel est en haut qui a la connaissance du ciel (l’astronome notamment). En religion aussi les divinités s’empilent selon les degrés du cosmos et de la société, doublant les réalités naturelles ou les diverses activités humaines. Il y a un sommet à tout cela, un en-Haut, combinaison des astres, de l’empereur, du dieu des dieux (qu’on l’appelle Amon, Mardouk ou Zeus). Tel est l’imaginaire indo-européen : c’est D1. Par sa constante pression latérale, et en déportant chez lui l’élite du petit peuple qui en reviendra fortement influencée, il tente d’absorber D2 pour le neutraliser. En fabriquant le Livre, les scribes réaliseront cet amalgame. Mais dans les textes qu’ils compilent dans ce but continuent de se lire deux traditions antagonistes : celle des prophètes et celle des prêtres. Et elles s’affrontent.
Côté prêtres, nous sommes au Temple. C’est là que se tient l’au-dessus, le Très-Haut, à quoi tout se soumet de façon stable et ordonnée, à des places et par des règles minutieusement fixées. Tous les pouvoirs s’y retrouvent : le culturel bien sûr, le politique (le palais n’est pas loin), le financier (le trésor y est stocké). Ce Temple est également un abattoir, le lieu des sacrifices, notamment animaux, spécialité des prêtres. En signe d’inscription dans l’imaginaire D1, à titre de demande ou de remerciement, en culte, les membres de ce peuple y font l’offrande d’une part de tout ce qui compte dans leur vie, ainsi prise par l’intouchable du haut (sacrifier = faire du sacré).
Or les prophètes proclament avec force que D2 ne veut pas de sacrifices, mais la justice. Avec eux, nous ne sommes pas à Jérusalem où résident les dominants, mais plutôt dans le nord, dans des communautés rurales qui préfèrent s’organiser elles-mêmes. Qu’entendre par justice ? En termes actuels, je dirais plutôt l’égalité que l’équité. Équité : à chacun ce qui lui revient selon sa position dans l’ordre, le droit n’est pas le même suivant l’étage que l’on occupe, c’est la société de D1. Mais quelle égalité alors, tous pareils et la même chose à chacun ? Non. Car dans cette marche qu’est la vie, nous sommes avec D2 dans de l’entre autres. Contrairement au Très-Haut, l’Autre n’est pas au-dessus, mais à côté et en nous qu’il altère. Dans l’ensemble humain qu’il suscite, il n’y a donc ni supérieur ni inférieur, il n’y a pas non plus de conformités immobiles, mais une diversité de singularités actives. On y est donc égaux et différents. On peut supposer que, dans ces communautés où la relation n’opprime ni ne formate, ce que l’on fait et pense soit objet de discussion. Et donc qu’y est favorisé ce qu’on appellera plus tard liberté et raison.
Le Très-Haut ou le Vivant. Les vieux mythes sont les plus intéressants. Car s’ils circulent encore, c’est qu’ils sont les porteurs de significations variées, voire contradictoires, mais toujours actuelles. Ainsi Babel, dans la reprise qu’en fait la Bible. Quelque part en Mésopotamie, plusieurs tribus se rassemblent pour s’unir, en se donnant un même nom dans une langue commune. Dans ce but, et pour l’exprimer, ils construisent une tour, comme on le fait en ces lieux. Problème : est-ce la tour que coiffe D1 ou, de façon déjà moderne, une tour qui concurrence celle-ci jusqu’à un autre Ciel ? Auquel cas D1 n’a plus qu’à l’abattre. A moins qu’elle ne soit détruite par D2, qui disperse ainsi les humains sur toute l’étendue de la terre pour qu’ils s’y unissent en un grouillement de vie.
L’histoire racontée nous parle d’un prophète qui refuse l’amalgame et expose ce qu’est pour lui ce qu’on appelle « royaume ». Jésus de Nazareth est son nom. Il entre en scène en refusant de se mettre au service de ce qui tente habituellement les humains : la richesse, le pouvoir et la gloire. C’est bien là ce qui règne, des forces en dehors de nous qui oppriment et aliènent, et qu’on célèbre aux carrefours et sur les places publiques. L’homme de Galilée ne participe pas à ce culte. La prière, pour lui, c’est se mettre à l’écart pour retrouver en son intérieur un souffle, la respiration qui l’altère, celle de l’Autre. Et le royaume qu’il propose est fait de tout ce qui est animé de ce souffle. Ce royaume n’est pas ce monde-ci, ni un autre monde ailleurs, plus tard. Il est, ici et maintenant, l’autre du monde, dans celui-ci et l’altérant. Il se tient dans la relation nouée avec tout ce que le système D1 infériorise et exclut : catégories d’humains, conduites hors de ses codes et rites. Jésus parle sans la moindre distance et à égalité avec les femmes, les enfants, les étrangers, les gens de peu, les déviants. Provocateur, il ne craint pas pour lui-même l’exclusion, l’impureté, en transgressant les règles, le sabbat par exemple. Ouvrez-vous, répète-t-il sur tous les tons, altérez-vous, aimez tous ceux qui vous entourent, aidez particulièrement ceux qui ne vont pas bien, quelle qu’en soit la raison (dénuement, maladie, emprisonnement). Partagez avec eux, soyez fraternels !
C’en est trop pour le Temple. Le Nazaréen tape trop fort, trop systématiquement, sur l’ordre établi dont D1 est la clé de voûte. Et il attire trop de gens. On peut bien sûr le condamner doctrinalement, notamment sur cette étrange question de royauté concurrentielle. Mais ça ne suffit pas, il faut l’éliminer. Avec le concours d’un autre pouvoir de dessus, le bras armé romain, les prêtres sans se salir tuent le prophète.

En ce point de l’histoire (celle qu’on se raconte, imaginée, comme celle qu’on réalise par ses comportements), nous avons un problème : sa suite peut-elle encore s’inscrire dans le récit qui précède, alors que le prophète est mort ? Il y a trois hypothèses. Dans la première, ceux qui accompagnaient Jésus n’y croient plus et rentrent chez eux amers. Elle était pourtant belle cette promesse qu’il nous faisait (au fait, en quoi consistait-elle ?), mais c’est fini. On ne pourra jamais rien contre ces tours, ces pyramides, ces puissances en érection qui nous soumettent.
Dans la deuxième, certains de ces compagnons, au bout d’un certain temps de rumination, se disent : mais si, ça continue, car ce mort est vivant. Intoxiqués par D1, nous n’avions simplement pas bien compris ce qu’il ne cessait de nous dire à propos de la vie. Nous attendions qu’il renverse ces dominations et qu’il les domine à son tour. Qu’il exerce un commandement, qu’il devienne chef lui aussi. Mais, à la réflexion, c’était là remplacer des hauteurs par une autre, la subversion (le dessous dessus) ne changeait pas la forme des positions, le modèle d’organisation. Nous l’avons compris grâce à deux d’entre nous. Ils nous ont raconté que, désespérés, ils faisaient route quand un troisième homme se mit à marcher avec eux. Ils lui expliquent la cause de leur tristesse, et ils reprennent à trois tout le récit qui concerne D2. Lorsqu’ils s’arrêtent le soir pour manger, celui qui s’était joint à eux dans leur marche partage le pain (nous sommes vraiment en climat prophétique) et, simultanément, disparaît. Ils le reconnaissent alors : c’est bien lui, le mort est vivant, il vit dans le partage. Cette vision nous ouvre un nouvel horizon. Il est mort, donc en terre, là où il n’y a plus que partage, altération, jusqu’à la décomposition. Mais c’est également là que se compose, grâce au partage, tout ce qui naît. Le prophète parle encore et nous dit : la vie ne vient pas du Ciel, elle est une production de la Terre, c’est vers celle-ci qu’il vous faut vous tourner. Soyez des Terriens qui partagent.
Troisième hypothèse : la tradition sacerdotale prend en charge la suite du récit. Avec un double souci : tenir compte du nouveau contexte historique et des changements intervenus dans la façon de penser, et de telle sorte que le pouvoir des prêtres ne soit pas affecté. On passe ainsi d’un ancien testament à un nouveau, de Jérusalem à Rome, d’une cosmologie à une ontologie, d’Israël à l’Eglise, d’un peuple particulier à l’humanité entière. L’objectif est maintenu : il s’agit toujours de sauvegarder l’ordre établi et son Sommet, mais en y récupérant le prophète en raison de sa popularité chez ceux du bas, tout en neutralisant son discours d’opposant.
Tout s’organise alors autour de quelques affirmations enchaînées. La première : Jésus n’est pas mort, voilà pour satisfaire ses partisans. C’était un sacrifice commandé par D1, et voici pour les prêtres ainsi exonérés d’un meurtre, ils ne faisaient que leur travail. Qui est le sacrifié ? Le propre fils du Très-Haut, qui en devient un père. Un père est bon, forcément. C’est donc par pure bonté à l’égard de ceux qui, en bas, par leurs manquements multiples et variés (on dit péchés), par leur non-reconnaissance et respect de sa grandeur, étaient en dette à son endroit, qu’il leur envoie Fils, forcément bon lui aussi. Sa mission : réaliser une conciliation en effaçant la dette qu’il paie lui-même de sa vie. Mais c’est la forme humaine qu’il avait revêtue pour rencontrer les endettés qui meurt ainsi. Lui-même, mission accomplie, n’a plus qu’à remonter là-haut, dans sa vraie demeure avec Père. Devra-t-il redescendre si rupture se produit à nouveau ? Il a l’intelligence de laisser à sa place une institution qu’il inspire et qui fera médiation entre Ciel et terre : l’Eglise.
Dans le texte finalement proposé en histoire par cette Eglise qui rassemble des groupes variés, et donc des compréhensions diverses de ce qu’il s’agit de vivre, cette version sacerdotale domine, mais elle ne peut tout contrôler. Ça tangue dans l’amalgame. Par exemple en deux points particulièrement structurants et très liés : la kénose et l’emploi du mot fils. Pour les uns, à la demande de D1 Jésus descend toutes les marches du cosmos, y compris en lui-même, pour les réorienter vers le haut par sa remontée, et rétablir ainsi l’unité du monde entier sous le dôme céleste. D’autres sont d’accord avec Paul quand il s’adresse aux Corinthiens : c’est très bien d’être en bas, faible, sans noblesse, fou, non reconnu. Car « Dieu » a choisi ce qui n’est pas pour réduire à rien ce qui est. Il ne s’agit donc pas de monter vers ce haut où se joignent toutes ces dominations qui se prennent pour quelque chose, mais de le renverser ! Dans la kénose, D1 est ainsi anéanti et remplacé par l’Autre. Et celui-ci, nous l’avons vu, ne cesse de s’altérer lui- même, telle est sa vie. Pas étonnant, par conséquent, qu’il s’ouvre en fils, lequel est également en logique d’altération. Ce Jésus-là s’ouvre donc à tous ceux qu’il rencontre, pour les ouvrir à leur tour, et c’est de cela qu’il meurt. Fi donc de cette horrible histoire dans laquelle un père s’offre à lui-même un fils en sacrifice : D2, celui d’Abraham, interdit cette abomination. Et fi d’un fils ainsi compris. Le frère qui aime est bien plus attachant.
Et puisque le nouveau récit invente l’Eglise, il faut bien constater que cela tangue aussi à propos de celle-ci. Rien là de surprenant puisqu’elle est habitée de deux « Dieu » opposés. En ouverture de la nouvelle histoire, le texte retenu pour raconter Pentecôte correspond à celui de Babel pour les temps anciens. Abattus par sa mort, les disciples de Jésus sont enfermés, craintifs, serrés les uns contre les autres, assis par terre dans une même pièce : tout est fini et noir. Mais voici que du feu surgit. Ce pourrait être sous la forme d’une grosse boule qui, à la manière d’un haut-fourneau, fondrait en un bloc massif le multiple dont elle s’empare, et fabriquerait ainsi une unité puissante, quelque chose de compact qui s’imposerait uniformément à tout : D1 aime les coups de tonnerre, les ouragans. Non, c’est sous la forme de petites langues qui se dispersent pour se poser avec légèreté, une sur chacun. Eclairés de cette lumière, si personnelle, les effondrés se lèvent, se dispersent eux aussi, et dehors se mettent à parler du prophète et de D2 dans la diversité des langues. La vie, cet enchevêtrement créatif de différences, ne supporte pas les clôtures et les totalités. En prenant le pouvoir dans l’Eglise comme ils l’avaient dans le Temple, les prêtres ne respecteront pas ce texte dans leur comportement et ils bâtiront quelque chose de ressemblant à la grosse boule. Tant pis pour une universalité vivante.
L’histoire qu’écrivent ces prêtres ne peut s’inscrire dans la deuxième des hypothèses ci-dessus évoquées. Pour eux, c’est même leur raison d’être, la vie doit forcément venir du ciel. Il n’est donc pas question d’aller en Galilée rejoindre cet éveillé des morts, ou ce mort éveillé, pour partager le pain et le poisson avec ces petites gens qui vivent de la terre. Rester à Jérusalem ? Ce n’est plus là qu’on peut être puissant, un nouvel Empire y triomphe. Pour faire encore partie du haut, il faut se déplacer en son cœur, à Rome. Et là participer à la construction d’un système équivalent à ce que fut celui du Temple, dans lequel se conjuguent en sommet les différentes souverainetés. Cela requiert d’être accepté par cet empire, en son immense territoire. On ne peut l’être qu’en sortant du judaïsme qui, cultuellement, n’intéresse pas les Gentils. Pour autant, cet empire ne veut pas être sans religion, alors que les dieux de l’Olympe sont en train de mourir. Nous disposons donc d’un créneau où déposer les propositions que nous venons d’émettre en troisième hypothèse. Le christianisme présenté peut convenir. Il se veut universel, et il a retiré de Jésus tout ce que le prophétisme comportait de subversion sociale. Et, pour bien le faire sortir culturellement du vieux Livre, nous le faisons parler et penser dans la langue de l’empire : le grec. Novus Israël et vera religio, la religion catholique romaine est née.
Sa réussite sera fulgurante. Elle en viendra même à se substituer à l’Empire, auquel succédera ainsi la Chrétienté. Ce qu’on appelle foi y devient affaire d’institution et de dogme. Penser grec, c’est penser à la façon de Platon. Ce philosophe ne remet pas en cause la hiérarchie, mais la déplace de l’ordre du cosmique, de la force, à celui de l’être qu’il intellectualise, de la vérité : ontologie métaphysique. S’étagent des essences, des natures, suivant ce qui, de l’intellect ou de la matérialité, domine dans leur composition. Au sommet l’être le plus idéel, objet de science contemplative, celle de l’âme distincte du corps trop attaché au sensible.
Les prêtres-clercs de l’Eglise romaine inscrivent leur récit (la troisième hypothèse) dans cette façon de penser et définissent ainsi des vérités indiscutables, des dogmes. Au sommet « Dieu » est un pur Esprit, de nature parfaite en toutes qualités, éternité, bonté, infinité, etc. (on lui donne des noms, et au superlatif, contrairement au Sans nom qui parlait à Moïse). Cette nature est commune aux trois personnes que sont le Père, le Fils et l’Esprit. Ce Fils est composé de deux natures, la divine et l’humaine, inséparables en lui mais qu’on ne peut confondre (elles ne sont pas égales). Par la première, il n’est pas mort, mais au Ciel. Notre âme est elle aussi immortelle, nous irons donc au Ciel si elle ne se laisse pas pervertir par les désirs du corps. On doit croire aussi à l’Eglise, et donc lui obéir, puisque, étant d’en-Haut, elle est en mesure de définir ces vérités. Pas seulement d’ailleurs en matière de dogme, mais aussi de morale. En grec, la façon de se comporter doit respecter la hiérarchie de l’être. En société aussi, il y a du supérieur et de l’inférieur. La morale de l’Eglise ne s’oppose donc pas à l’ordre social établi, mais au contraire le justifie. Pauvre Paul ! Dans la même lettre dans laquelle il exhortait les Corinthiens à abattre toutes les dominations, il demande aux femmes de se soumettre à leurs époux, comme ceux-ci obéissent au Christ et celui-ci à Dieu. De qui parle-t-il alors, de l’Autre, de l’altérité-altérante, ou du sommet d’une tour ? Quelle contradiction !
Une fois à Rome, cette Eglise s’y fera reconnaître dans le club d’en haut par un coup de génie : en devenant riche. En cette ville ont en effet pouvoir et renommée ceux qui distribuent aux citoyens démunis de quoi vivre sans trop de manques. Par exemple le blé qui vient de leurs immenses propriétés d’Afrique du Nord, l’huile et le vin issus de leurs domaines plus proches du Latium. Ou une part de l’argent qu’ils retirent du commerce de ces produits. Ou encore des spectacles et distractions qu’ils offrent en des lieux adaptés (cirques, théâtres, stades), ou tout simplement dans la rue qu’ils embellissent de places et de statues d’eux-mêmes, qu’en retour ceux du bas vénèrent. On appelait cela l’évergétisme, on dirait aujourd’hui philanthropie. A ces gens élevés, l’Eglise dit : j’ai davantage à vous offrir que le pouvoir et la renommée que vous tenez de vos richesses. Si c’est à moi que vous donnez celles-ci directement, pour que je les redistribue moi-même aux pauvres, je vous ouvrirai le ciel. Et je serai moi-même puissante aux yeux de toute la société, qui s’inclinera devant mon institution et mon dogme. Il en ira encore ainsi, plus tard, avec les indulgences : donnez-moi des espèces sonnantes et trébuchantes, des âmes monteront au ciel, et nous construirons Saint-Pierre de Rome. Nous sommes loin du prophète qui disait que les riches ne pouvaient pas entrer dans son royaume. Il n’y a pas d’amour dans tout cela, seulement de la gloire.

De quoi sera faite l’histoire sous cette nouvelle version de D1 ? De chamailleries entre hauteurs associées, le pape et l’empereur, l’abbé et le châtelain : qui est au-dessus de l’autre, dans quels domaines et dans quelles circonstances ? Les figures sont multiples et changeantes, mais la combinaison demeure et c’est d’elle qu’on parle (le théologico-politique). On n’y mentionne pas ceux d’en bas, puisqu’ils n’ont rien qui valorise. Sauf quand ils se révoltent et entrent en dissidence, à la fois contre les puissances qui les exploitent et humilient et une Eglise qui, par ses liens avec elles, ne correspond pas à ce qui vit en eux de l’homme de Nazareth. La réaction de l’alliance du haut sera le plus souvent terrible : accusés d’hérésie, ces mouvements et leurs membres seront physiquement anéantis.
C’est le cas, par exemple, de ces très nombreuses femmes qui s’opposaient à la désintégration de leurs communautés rurales, donc au pouvoir politique et au capitalisme naissant, alliés pour privatiser les communs (terres, pacages, bois, étangs). Solidaire de ses compagnons de sommet, l’Eglise traite ces femmes de sorcières et elles seront brûlées vives. Il arrive que les dissidents adhérent au dogme et à l’institution ecclésiastique (on ne peut donc les traiter d’hérétiques), mais refusent d’être dominés par les marchands et leurs complices gouvernementaux : ils s’organisent entre eux, à l’écart. C’est le cas des « réductions » d’Indiens guaranis, formées à l’initiative de jésuites. Les Etats concernés et la finance demandent alors à l’Eglise de ne plus couvrir ces sociétés communisantes qui leur échappent. Ce qu’elle fait, les livrant à la destruction.
Par ce genre de comportements, l’Eglise catholique romaine se déconsidère et fait chanceler sa glorieuse et unie Chrétienté. Celle-ci, à vrai dire, ne se portait pas aussi bien qu’on le prétend. Côté peuple d’en bas, on n’a jamais trop aimé l’institution : elle vit financièrement à son crochet, et elle se mêle trop de son intime, notamment de sa sexualité (police des mœurs pour la santé de l’âme). On ne comprend pas grand-chose au dogme qu’il faut apprendre par cœur et réciter. Ce qui intéresse et attire, ce sont les fêtes, les cérémonies, occasions de faire corps ensemble avec chaleur. Et ces histoires qu’on y raconte et met en scène, qui enchantent la dure et morne vie quotidienne. Comme elle est émouvante et proche la vie de cet enfant et de sa mère, à la fois joyeuse, grave et si triste. Et ces angelots qui volètent heureux ! Il s’agit d’une culture populaire qui certes imprègne, mais qui, sans prétention, ne donne de pouvoir à personne.
Quant à l’élite, son rapport à l’Eglise relève aussi de la culture, mais de la grande. Elle est sensible aux magnifiques œuvres musicales, picturales et architecturales que l’institution et le dogme lui offrent à la manière des anciens évergètes. Mais elle n’est pas très convaincue par ce mixte de cosmique archaïque et d’intellect athénien qui lui est proposé. Elle est trop bien placée – elle est du haut – pour ne pas soupçonner qu’il s’agit d’un montage que les prêtres ont élaboré pour eux-mêmes, pour le maintien au pouvoir de leur caste. Il suffira, pour que leur construction s’effondre, qu’on aille au ciel et qu’on y trouve autre chose que ce qu’ils y avaient mis.
C’est ce qui arriva avec Galileo Galilei, Galilée en français. S’ouvre alors un nouvel épisode des aventures du ciel et de la terre. Le ciel descend et s’empare de la terre, la détruit et la vie avec elle. Ou, si l’on préfère, la terre monte au ciel pour s’y dissoudre avec la vie.
Quittes à être Grecs, soyons-le vraiment. Pour leurs savants, tout en haut de l’échelle de l’être, le ciel (le divin) est fait de pures idéalités mathématiques et de leurs relations. Aristote parlait bien des vivants, mais il cantonnait les corps animés, capables de se mouvoir, dans les degrés inférieurs de l’être, dans le monde sublunaire. Pour l’au-dessus, il se ralliait à Platon. Or, voici qu’avec sa lunette améliorée, l’astronome toscan constate qu’il va haut et loin, en un parcours continu, sans avoir à franchir de cercles étagés. Il en déduit que l’univers est un, infini et homogène, sans qualités différenciantes, et donc d’essence mathématique. Et qu’on n’en peut traiter que mathématiquement. Telle est la science moderne que Descartes met en œuvre en distinguant la pensée et l’étendue. Son ego est un cogito, une substance pensante qui pose en face d’elle des corps étendus, objets inanimés qui ne peuvent se mouvoir par eux-mêmes, mais par une pensée qui leur est extérieure. Donc en étant machines.
La suite de l’histoire est donc celle d’une mise en machine de tout, d’une artificialisation générale. Successivement mécanique, énergétique, puis numérique, le plus récent reprenant l’ancien en le recomposant, ce machinisme invente une nouvelle façon de faire société, de faire économie et de penser qui détruit la nature et l’humain. Il érige de nouvelles divinités : l’Etat moderne, le Capital et, ces temps derniers, l’Intelligence Artificielle. Composée d’ingénieurs-administrateurs, la puissance politique homogénéise les territoires, normalise les esprits et les comportements, leur enlevant ainsi leurs qualités particulières. Elle livre ces espaces et ces gens aplatis, corps sans intériorité, à la machine industrielle qu’elle crée en alliance avec la finance : les matières vivantes en sont transformées en artefacts, sols et sous-sols ravagés, atmosphère polluée, l’humain réduit à n’être qu’un travailleur-producteur puis un consommateur de ce qui est ainsi fabriqué, tout cela dans le but de faire de l’argent. Pour contribuer au développement d’un tel projet, l’intelligence change aussi : le management s’équipe de cybernétique et procède par algorithmisation de tout. A quoi aboutit-on ? Quelque chose fonctionne, et nous sommes dedans, simples données informatiques. Quelle est, et où, la « substance pensante » ? Elle n’est en tout cas pas de la Terre, ni de nous. Ainsi la planète s’éteint et l’humain disparaît. C’est aujourd’hui.
Que faire alors pour enrayer cette course à la mort ? Et ce qu’on appelle christianisme peut-il contribuer à cette résistance ? Ce ne peut être le cas de l’Eglise romaine (celle des prêtres), de son institution et de son dogme. Trop étrangère à la modernité, elle ne peut y agir pour la rectifier de l’intérieur. Elle la rejette purement et simplement, et veut en tous domaines revenir en arrière (traditionalisme). Notamment en matière de sexe, une obsession. Il ne peut s’exercer, dit-elle, que conformément à la nature. Or celle-ci n’est pas pour elle une nature vivante, mais quelque chose de fixe, d’intangible dans la hiérarchie de l’être (elle est comme ça). Ses lois sont par conséquent immuables, on ne peut que s’y conformer. Penser ainsi rend incapable d’imaginer que science et technique pourraient être mises au service de la vie, c’est-à-dire d’un entre autres de rencontres et de découvertes, au lieu de la mettre en machine. Une autre partie de l’Eglise et de son sommet s’accommode de la situation, à la condition qu’on lui reconnaisse une place irremplaçable dans des activités, domaines et populations qu’ignorent les nouveaux maîtres, ou qui résultent des dégâts qu’ils provoquent : tout un champ d’aide, en particulier à ceux d’en bas, en matière de santé (hôpitaux), d’éducation (écoles), de loisirs (patronages), tout simplement de nourriture et de logement. Elle y trouve justification, autorité et honorabilité sociales en se réclamant de la charité. Mais elle y sera progressivement remplacée par l’Etat et le Capital, agissant en raison de leurs soucis propres, celui de la paix sociale dans l’ordre pour l’un, celui d’y trouver une rentabilité pour l’autre. Ainsi sort de l’histoire la Chrétienté.
Qui peut alors porter le nom de chrétien dans ce nouveau monde aux nouvelles divinités ? Un nouveau christianisme est apparu, qui remplace l’ancien à grande vitesse et se répand partout, jusqu’aux régions les plus écartées de la planète. Ses adeptes se nomment « pentecôtistes » ou « évangéliques ». Notre nouvelle réalité est faite de flux de toutes sortes, techniques (les NTIC), financiers, d’images et de sons (le médiatique) par lesquels les nouvelles puissances s’emparent de notre cerveau pour le remplir de leurs valeurs. Décervelage et manipulation, nous voici zombifiés, en transe. Mais ce transport peut être plus ou moins triste ou gai, froid ou chaud, aplatissant ou euphorisant. Pour y introduire davantage d’enthousiasme, d’émotion, on peut faire appel à Jésus. Mais un Jésus dansant et chantant, flottant lui aussi dans les flux, hors organisation et pensée structurées. Qui aide à vivre par conséquent, et sans rien subvertir. Les Baruya sont une tribu qui vit dans les hautes montagnes et les forêts de l’intérieur de la Nouvelle-Guinée, et qui n’a été découverte par les Blancs qu’en 1951. Certains d’entre eux ont récemment souhaité et reçu le baptême. À un anthropologue français qui les fréquente depuis longtemps et qui leur demandait pourquoi, ils répondirent qu’ils voulaient être des hommes nouveaux, d’aujourd’hui. Et qu’être homme nouveau, c’était suivre Jésus et faire du business. Trump et Bolsonaro.

C’est en mai 1968 que se manifesta l’opposition, radicale et frontale, au processus mortel. Ce ne fut pas quelque chose d’attendu, mais un évènement. Il n’y avait plus de machines dans les rues et dans les lieux intimes, mais des corps, de la parole, de l’imagination qui se désemmuraient de la société programmée et de consommation. Les sorcières alors se mirent à danser, contre Phallus-Etat et Phallus-Capital. L’entreprise de déconstruction des nouveaux dieux, en leur ensemble, commença. Des chrétiens, jeunes et vieux, ont pris leur part à ce qui se passait, heureux et créatifs. Ils ne sortaient pas du néant mais s’inscrivaient dans la filiation de mouvements antérieurs, tels le socialisme chrétien de 1848, ou les associations de jeunes ouvriers et paysans, regroupées sous le nom d’Action Catholique au 20ème siècle. Ces mouvements qui se réclamaient du prophète de Nazareth avaient bien sûr eu maille à partir avec la hiérarchie ecclésiastique qui ne les trouvait pas assez à son service, trop occupés à changer la société en se joignant à d’autres qui s’affirmaient publiquement contre l’Église, contre la foi chrétienne. Mais mai 68 débordait ce phylum historique, allait plus large et plus profond. Comme il débordait tout ce qui, jusque-là, s’opposait, ou pensait le faire aux puissances néfastes. Il obligeait donc ces chrétiens à aller également plus large et plus profond dans leur foi. Où ?
Dans la cour de la Sorbonne que dominait alors le structuralisme, Sartre réapparut sur scène, pas pour longtemps : son sujet était encore trop cartésien et, pour lui, les autres étaient l’enfer. L’existentialisme qui prit, ou reprit place était plutôt de type kierkegaardien : il n’y a d’existence qu’en relation, et l’on est d’autant plus soi-même que l’on est altéré par de l’autre. Les jeunes en mouvement voulaient que la société et eux-mêmes échappent à la machine. Je veux pouvoir aimer sans me faire avaler par quelque chose qui me fasse oublier que j’existe. Je veux faire des études, mais qui ne fassent pas de moi un serviteur du management techno-capitaliste. Je veux travailler, mais dans un collectif où l’on dialogue, favorisant ainsi la créativité, pas dans une atmosphère productiviste, à la hiérarchie contraignante, qui tue en moi et en chacun l’artiste et le poète. Je veux faire de la science, mais pas d’une façon scientiste et techniciste qui prétend tout soumettre à un progrès qu’elle seule définit. Une autre intelligence prenait forme et se répandait, qui affirmait que solidarité et différences vont ensemble, et opposait ainsi la démocratie dialoguante aux flux machiniques. Elle reprenait la vieille opposition de l’essence et de l’existence sous les traits de l’identité (une mêmeté close et fixe) et de l’ipséité (être soi- même, un en-dedans ouvert en aventure). Ou sous ceux de l’objet inerte qu’un extérieur produit, utilise et détruit, et d’un mouvement à partir de son intérieur même : la vie.
La vie. Elle est aujourd’hui la grande préoccupation, le principal motif d’inquiétude. La vie ne se trouve que dans une mince couche de sol, d’air et d’eau qui cercle notre planète. C’est un milieu qu’elle a elle-même composé, étendu et élargi au cours des temps. La vie est donc de la Terre, elle ne vient pas du ciel. Et c’est précisément en la pensant et en la commandant depuis le ciel (mathématique et machinisme au service d’une abstraction financière), qu’on détruit aujourd’hui son milieu dont nous faisons partie : pollution du sol, de l’air et de l’eau, dérèglement climatique, extinction de la biodiversité. Pour l’écologie, la vie n’est pas vécue, elle se vit. Elle n’est pas quelque chose d’objectif à traiter du dehors, mais une sorte de subjectivité en acte qui engendre continûment du nouveau par des mises en relation, des agencements, des alliances variées et variables entre éléments, formes et façons d’être. Par exemple, entre humains et non-humains, végétaux et animaux, entre espèces. Elle est un entrelacement générateur de différences : entrelacement de différences, qui en génère d’autres. Il n’est pas étonnant que tous les mouvements qui s’opposent aux dégâts produits dans leurs domaines respectifs d’intérêt et d’action par la modernité occidentale, et qui cherchent à les réparer, se joignent au mouvement écologique et s’équipent de sa pensée. Ainsi parle-t-on maintenant d’éco-féminisme, d’éco-socialisme, d’éco-anarchisme, etc. D’éco-christianisme ?
En quoi ce qu’on appelle christianisme peut-il contribuer à la vie et à sa défense ? Par des hommes et des femmes de foi. S’ouvrir en ek-sistence, altérée-assoiffée, c’est être habité d’une force intérieure qui ne capitule pas, ne cède pas au désespoir : une confiance en soi et dans l’avenir. Courage, debout, et marche ! Cette foi-confiance irradie : quand elle regarde ceux qui stagnent aux alentours, ceux-ci, se sentant reconnus, se redressent à leur tour et rejoignent ceux qui sont déjà en route. Et les voici ensemble, confiants dans l’advenue d’un monde autre, de partage, où l’on serait vivant parce qu’entre autres. Comment y parvenir, par quels moyens ? C’est affaire de raison critique et constructive, de discussion libre et argumentée. La foi-confiance lance en aventure, elle ne propose pas de programme. Mais ne stimule-t-elle pas la raison à travailler dans ce sens ?
Parmi les « Dieu », lesquels sont compatibles avec cette foi-là ? Bien sûr, pour moi, celui de Kierkegaard dont l’Autre est tellement absolu, délié, que sa rencontre altère radicalement, au plus profond de soi : il était présent dans le paragraphe précédent. Aux différentes histoires que l’on raconte sur « Dieu » (le fictum) correspondent des réalités historiques (le factum) différentes. Pascal énumérait trois de ces récits : le biblique d’Abraham, le philosophique des Grecs, le scientiste des savants modernes. Il aurait pu ajouter, entre les deux premiers, celui des prêtres indo-européens. Le « Dieu » des philosophes et des savants exige la soumission, comme celui des prêtres. Non la confiance, mais la croyance, degré inférieur de la connaissance soumis à celui, supérieur, de ceux qui savent (on croit que, on croit à). Il ne s’agit donc pas de relation vivante, mais d’adhésion à des vérités indiscutables qui vous tombent d’en haut. Il n’en va pas de même avec le « Dieu » d’Abraham, qui marche à vos côtés, en rencontres et découvertes. Si l’on veut actualiser la foi, la rendre aujourd’hui active, c’est donc très simple. Il ne s’agit pas de changer de vocabulaire pour parler de la même chose, de ripoliner les amalgames, mixtes et embrouilles des théologiens, mais de débarrasser D2 de D1 et de ses avatars.
P.S. J’ai 87 ans, je vais bientôt mourir. À mon enterrement, je ne veux pas de prêtres, ils parleraient du ciel. J’espère mourir vivant, c’est-à-dire ek-sistant, ouvert et accueillant à tout ce qui m’entoure et m’arrive. Et vivre mort, mêlé à la vie de la terre, en compost et en bon humus pour la vie de demain. Dans la vie de la Terre, les âges s’entremêlent, ils sont contemporains. Peut-être que certains me projetteront en étoile dans le ciel, poétiquement, pour signifier que je suis toujours là dans leur marche, à leur dire par mon clignotement : partagez.
Notes
- Note de la rédaction : la fondation Un monde par tous soutient la revue Terrestres depuis 2021.[↩]
- Pour une biographie détaillée de Paul Blanquart, voir la notice du Maitron qui lui est consacré : https://maitron.fr/spip.php?article252296[↩]
- Ce texte a été publié, sans son post-scriptum, dans l’ouvrage collectif La foi et ses raisons, Karthala, mars 2022.[↩]
- La racine grecque ἐκ, signifie « hors de » et renvoie à l’origine étymologique d’exister, elle signifie « se manifester », presque « sortir de soi » si l’on veut.[↩]