À propos de Mathias Bonneau, Bûcheron, Éditions du Seuil, collection « Cadre rouge », 2025, 272 p.
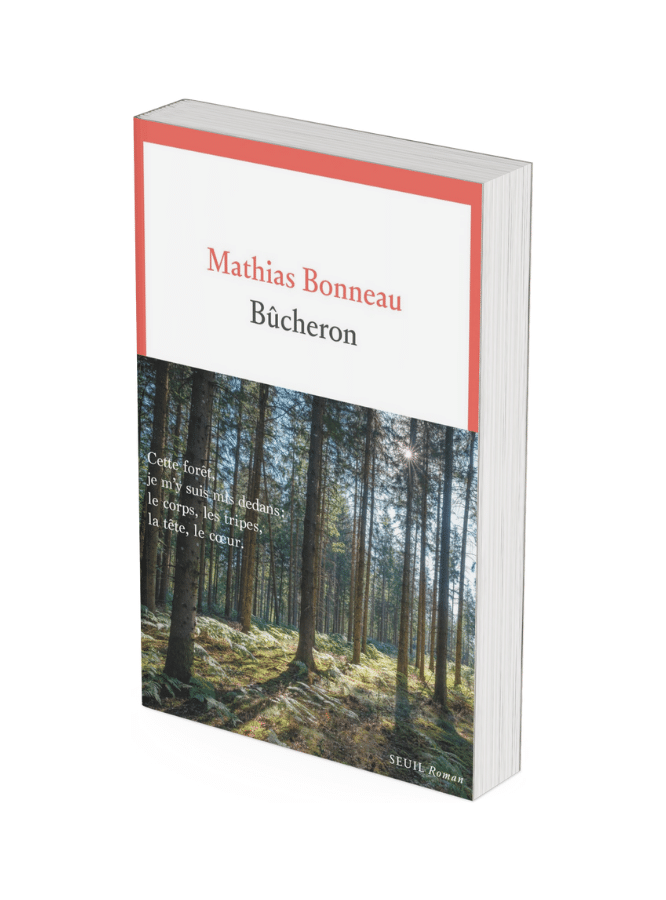
La forêt est un matériau attrayant pour qui aime écrire, tant l’imaginaire qui l’accompagne est sans fin (Harrison, 2010) et se prête à des réappropriations critiques (Cyprine et Layé, 2022). Toutefois, songeant aux contes et légendes, aux cabanes dans les arbres et aux refuges enfouis sous la mousse, aux chemins sinueux tracés par les chevreuils ou encore au dense réseau mycorhizien qui égaye le sol, on oublierait presque que des hommes, et de plus en plus de femmes, travaillent dans les bois à grand renfort de cartes, d’outils et de machines. Que des arbres sont choisis pour être mis à terre, ébranchés, façonnés, débardés, transportés puis enfin transformés, c’est-à-dire sciés ou réduits à l’état de granulés ou de pâte à papier. Parmi les milliers de livres, documentaires ou de fiction, à propos de la forêt, ceux qui portent sur le travail qu’elle suscite, de la sélection d’un arbre à abattre jusqu’à sa transformation, en représentent une part infime.
On en trouve cependant quelques-uns. Parmi ceux appartenant à la littérature, citons deux romans époustouflants qui racontent les grèves de bûcherons survenues dans le nord-ouest des États-Unis avant et après la Seconde Guerre mondiale (Karl Marlantes, Faire bientôt éclater la terre ; Ken Kesey, Et quelques fois j’ai comme une grande idée), de courts récits relatant une coupe de bois en Suisse et en Italie (Oscar Peer, Coupe sombre ; Carlo Cassola, La Coupe de bois), un texte jubilatoire sur le travail en scierie (Anonyme, La Scierie) ainsi que, plus récemment, les « carnets d’une apprentie bûcheronne », dont les vers libres offrent une respiration bienvenue dans toute cette littérature laborieuse jusqu’alors essentiellement masculine (Anouk Lejczyk, Copeaux de bois).
Un récit paru tout récemment vient s’ajouter à cette liste : Bûcheron, de Mathias Bonneau.
On notera d’emblée que, comme la plupart de ses prédécesseurs, l’auteur a fait le choix d’un titre des plus directs. Simple et borné. Il faut dire que le mot, comme la profession qu’il indique, sont évocateurs. Le seraient-ils à tort ? C’est ce que rétorqueraient sans doute certains représentants de la filière forêt-bois, qui aiment à rappeler que la figure usuelle du bûcheron a fait son temps1. Ajoutons à cela que des évolutions administratives ont concouru, à partir des années 1970, à l’adoption progressive de la catégorie d’entrepreneurs de travaux forestiers (ETF), désormais largement employée (Schepens, 2005a). Le brouillage des catégories est accentué par la persistance, dans l’espace rural, d’habitants « faisant leur bois » sur des parcelles familiales ou usant de leur droit d’affouage pour couper les arbres qu’on leur a attribué dans une parcelle communale. Si des amateurs abattent, ébranchent, débardent, y-a-t-il vraiment des professionnels qui peuvent revendiquer ces tâches comme étant l’objet de leur métier ? Face à ces évolutions sémantiques, à cette indistinction entre différentes pratiques, le titre de ce livre, un simple mot bien campé sur un fond blanc encadré de rouge, a tout d’une affirmation. Le métier de bûcheron n’est pas mort.
Enfin, si les textes littéraires portant sur le travail forestier sont peu nombreux, disons aussi que ceux écrits par les travailleurs eux-mêmes sont quasiment inexistants. Après Copeaux de bois, dans lequel Anouk Lejczyk raconte son année de formation à la « conduite de travaux forestiers », Mathias Bonneau offre une plongée inédite, en ce qu’elle est autobiographique, dans le quotidien d’une profession bouleversée par les évolutions socio-économiques de la filière forêt-bois et par les changements environnementaux qui affectent les écosystèmes forestiers. Qu’ajoute donc ce livre-ci à notre connaissance de cette « profession d’hommes des bois » que décrivait il y a plus de vingt ans le sociologue Florent Schepens (Schepens, 2003) ?

Héritage et transmission
L’enfance, la lignée, la filiation : peut-être faut-il toujours commencer par-là. C’est en tout cas ce qu’a choisi de faire Mathias Bonneau. « Mon père coupe du bois depuis bien avant ma naissance, dans une forêt plantée par son père à lui, pendant que ma mère s’occupe du troupeau de leur ferme. » Cette forêt, c’est celle du Passet, située dans « un coin du Massif central », sur un plateau où « il pleut beaucoup ». Sa perpétuation depuis les premiers plants, mis en terre dans les années 1960, est une responsabilité qui se transmet. « Mon grand-père a planté une majorité d’épicéas, aussi un peu de pins et de douglas. […] Ma grand-mère a assuré la fin de la mise en place de ces plantations. À son décès, mon père s’en est occupé, en rendant des comptes à ses frères et sœur qui lui font confiance. »
Tandis que les résineux poussent et que le père s’occupe de leur avenir, le fils trouve dans les jeunes forêts familiales autant de support pour les histoires qu’il compose. « Au milieu de mes grands jeux, il y a des arbres qui tombent, des tas de bois propres et la vision d’un guide de tronçonneuse. » À chaque évocation des forêts de son enfance, le père est présent avec sa machine, ses bidons et son tournebille. « Cette colline est le lieu de son labeur autant que le terrain de mes rêveries. Son travail et mes jeux se mélangent. » Les premières pages de Bûcheron montrent une évidente imprégnation, qui supplée, dans un premier temps, à une transmission formelle et assumée. L’enfant regarde, ressent et apprend sans qu’on ait besoin de le lui demander. Aussi n’est-il pas anodin que l’un de ses jeux l’amène à mourir sous les arbres, comme c’est le cas pour plusieurs bûcherons chaque année2, sur les quelque 21 000 travailleurs employés par des entreprises de travaux forestiers (Moineau et Nicolas, 2021).
« Au bûcheron aussi, nous jouons » poursuit l’auteur. Très vite, l’enfant apprend toutefois que dégager des semis ou éclaircir une plantation s’apparente bien plus à « un combat » auquel il n’a pas encore accès. Écrasé par un arbre que l’on vient d’abattre, on ne se relève pas comme on le fait dans les histoires de chevalier et de soldat qu’on se raconte enfant – différence de taille que rend moins souhaitable pour le père la transmission d’une profession dangereuse. À mesure que les années passent, l’enfant grandit, les outils changent, jusqu’au jour où celui qui est devenu un solide adolescent suit son père pour travailler au bois. L’imprégnation est alors augmentée d’une initiation, qui s’étale sur plusieurs jours, jusqu’à l’abattage tant attendu, dont nous ne saurons rien ou si peu : « La chute de ce premier tronc qui est tombé ne restera pas dans ma mémoire. Mes sens saturés n’impriment rien du fracas des branches qui fend l’air et qui n’est plus. »
« Bûcheron, non. C’est le paradoxe des passionnés de ces métiers difficiles qui, tout en adorant transmettre ce qui les anime, refusent que leurs enfants prennent cette voie-là. »
Mathias Bonneau
Dès lors, l’auteur consacre une part de plus en plus importante de son temps libre à ébrancher, planter, abattre aux côtés de son père. Peu à peu, écrit-il, et sans s’en rendre compte, « les gestes entrent en moi ». Les éléments du récit s’enchâssent à merveille. Tout concourt à l’avènement d’une vocation : l’omniprésence du bois et du travail, matrice de l’enfance ; le goût qui s’acquiert sans heurt en pratiquant ; la figure paternelle et tutélaire… De là à en faire son métier, il n’y aurait qu’un pas, qu’il n’est pas permis de faire. « J’ai le droit d’y jouer, mais ce n’est pas possible d’en vivre. » La machine s’enraye. « Cela aurait été mieux accepté que je reprenne la ferme de mes parents. Parce que c’est leur métier principal, et qu’une ferme se transmet dans une famille. Bûcheron, non. » Et l’auteur d’ajouter : « C’est le paradoxe des passionnés de ces métiers difficiles qui, tout en adorant transmettre ce qui les anime, refusent que leurs enfants prennent cette voie-là. »
Aussi, après des études d’architecture, Mathias Bonneau a-t-il dû insister et persévérer pour obtenir le droit de faire une première saison complète dans les forêts familiales – saison qu’il raconte dans une bande dessinée parue voilà plus de dix ans, L’hiver au bois. « Ma première coupe ne m’a pas établi comme bûcheron, elle dit juste que je veux l’être. » Ce souhait affirmé d’hériter malgré tout d’un métier qui ne transmet pas vient nuancer les analyses de Florent Schepens sur la trajectoire biographique des ETF – les entrepreneurs de travaux forestiers. Le sociologue est pourtant catégorique :
[D]evenir ETF est réservé à une population particulière caractérisée par trois dimensions. La première est une socialisation à l’indépendance professionnelle. Les ETF ont été familialement socialisés à une idéologie patronale […]. Cependant, et c’est la deuxième dimension, un imprévu leur interdit la reprise de l’entreprise familiale : faillite, reprise par un tiers […]. La troisième dimension est une absence des différents capitaux (formation, économique) nécessaires à la création d’une nouvelle entreprise.
(Schepens, 2013)

Pour lui, les ETF sont donc des « déshéritiers », c’est-à-dire « héritiers d’un status d’indépendant mais « déshérités » des conditions de sa réalisation. C’est à eux qu’est réservée la souffrance de ne pas être indépendant. La soulager passe par la réalisation de l’assignation familiale. » À suivre Florent Schepens, le cas de Mathias Bonneau serait donc exceptionnel : les « conditions de réalisation » de son métier, en effet, ne correspondent pas complètement à celles avec lesquelles ses collègues doivent composer. Son activité est diversifiée – gestion, sylviculture, abattage – et se déroule en grande partie dans une forêt de 80 hectares qui appartient à son père et à ses oncles. « Que je coupe un arbre, les copeaux que crache ma tronçonneuse racontent l’envie de mon grand-père, de mon père et la mienne. » Il a ainsi la possibilité de continuer un « chantier immense », qu’il n’a pas entamé, mais qu’on lui a transmis, ce à quoi n’accèdent que rarement les bûcherons et les débardeurs.
Ce récit devrait-il être dévalué parce qu’il ne serait pas tout à fait représentatif de la profession qu’il entend aborder ? Non, en rien, tant ce cas limite présente une plongée existentielle dans le travail forestier et témoigne des évolutions de ce dernier comme des transformations des forêts elles-mêmes.
Perturber et transformer la forêt
En creux de l’histoire familiale dépeinte par Mathias Bonneau, se déplie celle de la forêt française depuis le milieu du XIXe siècle. Au cours de cette période, les contreforts méridionaux du Massif central où se situe le récit de Bûcheron ont été largement reboisés, sous l’impulsion, notamment, des lois de restauration des terrains de montagne (RTM) puis du Fonds forestier national (Marty, 1998). Ils font ainsi partis de ces « nouveaux territoires forestiers » décrits par le géographe Clément Dodane (Dodane 2009). Leur spécificité se perçoit dans les descriptions de l’auteur : « Mon grand-père a fait sortir du sol des blocs monolithiques d’épicéas au milieu d’horizons dégagés. Ses plantations se sont arrêtées aux limites cadastrales, suivant strictement une ligne droite fictive. Lorsqu’il a rencontré des tourbières ou des sommets trop pauvres, il les a contournés, dessinant toujours les mêmes ruptures franches dans le paysage. Soixante ans plus tard, les lisières sont toujours aussi abruptes. » Si le contour des parcelles est resté inchangé, ce qu’elles renferment, par contre, a été dûment aménagé. En parlant de son père, Mathias Bonneau commente, admiratif : « Il a transformé une forêt. »
À charge pour l’auteur de poursuivre, de s’approprier les gestes de ses prédécesseurs pour y ajouter les siens. À mesure qu’il intervient dans les bois, le bûcheron prend de plus en plus conscience de l’incidence que la moindre de ses actions a sur les peuplements dans lesquels il travaille : « Je suis indéniablement une perturbation. » Ce constat, dès lors, ne cesse de l’accompagner, avec son lot de doutes et de réflexions. Dans l’exploitation forestière telle qu’entend la conduire Mathias Bonneau, tout est toujours « paradoxe » et « contradiction ». Il aime intensément cet écosystème, s’est familiarisé avec l’uniformité des plantations, cherche à les diversifier, quitte à agir avec violence pour contraindre la trajectoire empruntée par la forêt du Passet dans le sens qui lui semble le meilleur. Difficile de mieux dire ce contraste saisissant et permanent qui consiste à perpétuer le milieu forestier tout en y intervenant violemment. D’ailleurs, l’accepter est l’une des conditions pour continuer : « Si j’ai survécu au bûcheronnage, c’est que j’aime quand ça tabasse. »
En creux de l’histoire familiale de Mathias Bonneau se déplie celle de la forêt française depuis le milieu du XIXe siècle.
L’auteur se place dans les pas de son père, qui a commencé à s’intéresser à la sylviculture irrégulière préconisée par l’association Pro Silva. « Cette forêt ne sera plus jamais la même. Parce que c’est son évolution naturelle, aussi parce que nous la souhaitons différentes, plus mélangée. » Et d’ajouter : « Je choisis par petits gestes le mélange de la forêt de demain. » Il prolonge sa démarche en intégrant les réflexions sociales qui animent le Réseau pour les alternatives forestières (RAF). Autant de rencontres qui imprègnent jusqu’aux plus petits gestes effectués dans les bois. La perturbation, inévitable, reste aussi discrète que possible : « Le sol est plat, nous le parsemons des restes de notre prélèvement : cimes vertes éclatées et branches brunes étalées comme les silhouettes imprimées au sol des arbres disparus de la forêt. Ne reste des troncs qu’une griffe sur la mousse. »
À force d’interventions, lentement la forêt change. « J’avais appris à aimer la monotonie immaculée de cette forêt homogène, il faudra que j’apprécie sa métamorphose fracassée. » Le fracas n’est pas que l’apanage de la tronçonneuse. Les agents qui perturbent les évolutions de l’écosystème se multiplient sous les coups du changement climatique. La chaleur, d’abord, se fait de plus en plus insistante et entraîne son lot de cauchemars embrasés, de cimes rougies, de troncs desséchés. « Il y a un virage sur la route qui me mène à la forêt du Passet […]. Je suis content de la voir, mais elle réveille mes inquiétudes ; aussitôt que j’aperçois son vert, j’en guette les infléchissements, quand les feuillages virent au rouge. » Au plus fort de l’été, la souffrance des arbres est difficile à supporter, mais ça n’est qu’à l’ombre de leur houppier qu’un peu de fraîcheur est accessible : « Les arbres sont mon naufrage et ma bouée. »

Après la chaleur viennent les scolytes, dont ceux répondant au joli nom de typographe, pour les galeries que les larves creusent sous l’écorce des épicéas. Face aux dépérissements de plus en plus nombreux qu’il constate, affolé par la recrudescence de larves, l’auteur choisit de rompre le répit qu’impose la saison estivale. « Je ne peux pas rester sans rien faire. Il me faut un outil pour éliminer l’insecte sur le tronc. » Tandis que dans les régions les plus touchées par l’insecte, dans les Ardennes et le nord-est de la France, les « coupes sanitaires » mettent à bas des centaines d’hectares de plantation d’épicéas, Mathias Bonneau cherche à trouver une solution pied à pied, arbre par arbre. Avec un stagiaire-poète prénommé Charly, les deux bûcherons cherchent la moindre trace de présence de l’insecte pour abattre les arbres tout juste attaqués avant qu’il ne soit trop tard.
Nous cherchons dans les replis des branches ou dans les boursouflures de mousses les boulettes rousses qu’éjectent les femelles en train de creuser des galeries de ponte, en haut des troncs. Elles sont minuscules, quasiment invisibles, nous piétinons au pied des arbres comme des maniaques.
Mathias Bonneau
Une fois les arbres identifiés, encore faut-il les mettre à terre et enlever leur écorce pour réduire en bouillie les larves de scolytes qui se trouvent dessous. « Vivre avec le typographe ? D’accord, mais à grands coups d’écorceuse. » À force de chercher des insectes, de traquer les traces de sa présence, de déplorer ses attaques ou de constater, soulagé, qu’il n’est pas encore partout, une certaine proximité s’établit entre son action et celle du bûcheron. « Je l’ai détesté, ce destructeur d’arbre, ce rival qui fait des perturbations plus fortes que les miennes ! »
Les évolutions climatiques et parasitaires ne sont pas sans conséquences sur la conduite du travail forestier. Un rapport paru en 2022 le rappelait : l’accroissement des branches mortes dans les houppiers entraîne des risques élevés d’accident au moment de l’abattage (FCBA, 2022). Une contrainte de plus pour un métier parmi les plus accidentogènes qui soient. Comment écrire le risque, l’accident, l’usure ?
Un métier qui use
Simple idée d’abord, vite une obsession : l’usage du corps n’est pas séparable de son usure. Ce dernier terme, d’ailleurs, revient à plusieurs reprises dans Bûcheron. C’est un constat qui s’impose dès les premières observations du père : « J’ai en tête l’image de la silhouette voûtée de mon père, et son boitement permanent. Il ne souffre pas de blessure particulière, juste d’une grande usure généralisée. » L’appréhension de la fatigue est transmise en même temps que les gestes et les postures à acquérir pour abattre un arbre efficacement et en sécurité. Lorsque son père lui montre comment faire une entaille directionnelle, il explique : « Soit tu plies les genoux, soit tu te penches, comme tu préfères. Ça dépend si tu veux avoir mal au dos ou mal aux genoux quand tu seras vieux » – comme si, étrangement, il était affaire de choix quant à la douleur professionnelle la plus adéquate.
Dans la forêt, l’usage du corps n’est pas séparable de son usure. Mais c’est lors d’une partie de football qu’intervient la cassure : « Crac-croc comme un bruit de ma vie qui s’écroule. Mon corps, mon emploi du temps, ma tête. »
Et s’il faut choisir, le jeune bûcheron préfère une troisième voix, qui implique de rejeter des douleurs qui seraient inévitables. « Ce métier qui a usé mon père, je le ferai différemment. » Les écorchures, torsions et coups qui ne manquent pas d’arriver dans les bois ne finissent pas épinglées sur un tableau comme des médailles. Ses blessures, l’auteur ne les arbore pas sur son plastron. D’ailleurs, il semble qu’il se blesse peu. Il commente : « Je veux un corps solide, pas un corps abîmé. » Néanmoins, les années passant et malgré les précautions, la fatigue s’installe, au point de paraître inévitable. « En repassant les saisons écoulées, je ne sens pas de cassure nette dans ma vie au bois, mais plutôt une progressive abrasion. C’est le bois : une usure lente et irrémédiable. »
Une « cassure » intervient toutefois, loin des bois, sur un terrain vague, lors d’une partie de football.
« Crac-croc comme un bruit de ma vie qui s’écroule. Mon corps, mon emploi du temps, ma tête. » Des ligaments habitués à supporter les charges et les torsions n’ont pas tenu un dribble. « Dans le fond, je suis content de ne pas m’être fait mal en forêt, pour dire qu’il n’y a pas que le bois qui détruit. » Avec cette blessure, l’auteur sent s’imposer une nouvelle appréhension de l’usure : son acceptation stoïque et sereine. « Mes muscles ne serviront plus qu’à porter ma tronçonneuse et ma carcasse sous les rameaux. Ce ne sera pas un corps esthétique […] il sera dur comme un corps des bois, même usé, même fracassé. […] Ce squelette bancal ne sera plus bon qu’au bois, ça me va. »

Les réflexions que ne manquent pas de susciter ce retour sur soi ne doivent pour autant pas recouvrir les réalités socio-économiques qui pèsent au moins autant que les risques dans le devenir des corps forestiers. À propos des ETF, Florent Schepens (2013) avance que « l’activité professionnelle les oblige à considérer leur corps comme un élément exogène, comme une mécanique dont on attend un rendement immédiat. Il ne « sont » pas leur corps, ils « ont » un corps, corps à soumettre pour réaliser leur statut d’indépendant. » Là encore, les mots de Mathias Bonneau viennent nuancer les affirmations par ailleurs bien étayées du sociologue. L’auteur s’est progressivement approprié ce corps usé, quand bien même son métier le façonne mieux que ne le ferait le temps. « Je me sens prêt à devenir un vieux bûcheron, tout pété, rouillé, caramélisé, ça me convient », répète-t-il. Et d’ajouter : « Vieillir bûcheron, c’est rédiger une liste de douleurs qui s’allonge, qu’il faut accepter, dompter, apprendre à faire avec. »
Les propositions du sociologue rejoignent celles de l’auteur lorsqu’il s’agit de dénoncer les conséquences de l’absence de reconnaissance pécuniaire et la dépendance au rendement sur le corps des forestiers au travail. L’indépendance a pour contrepartie de se résigner à être payé au volume et de dépendre des fluctuations de ses commanditaires : « On est tous fiers d’avoir notre propre entreprise, de générer un salaire, lit-on dans Bûcheron. Et ce petit empire récemment conquis ne dépend que d’un corps et de sa capacité à encaisser l’usure. » Il arrive souvent que le corps ne tienne plus, que la fatigue devienne trop envahissante ou que les conditions de travail ne soient plus supportables. Les ETF sont bien plus sujets à des accidents que le reste du secteur agricole auquel ils sont rattachés (FCBA, 2014).
« Je me sens prêt à devenir un vieux bûcheron, tout pété, rouillé, caramélisé, ça me convient »
Mathias Bonneau
(Au cours d’un entretien que j’ai réalisé dans le cadre d’une recherche doctorale sur l’espace alternatif forestier, un bûcheron songeant à arrêter ses interventions en forêt pour se concentrer sur de l’élagage et de petits travaux de maçonnerie justifiait son choix ainsi : « Comme on est dans cette espèce de contrainte où plus tu coupes plus tu gagnes, plus tu vieillis moins tu gagnes. Normalement, quand t’es dans d’autres métiers, plus t’es âgé plus tu gagnes. Là c’est le contraire3. » Aussi, chaque imprévu contraint une rémunération qui ne souffre pas d’interruption. Mathias Bonneau écrit : « Ce temps qui s’arrête se compte directement en grumes qui ne seront pas sur la place de dépôt à la fin de la journée. » Et d’ajouter : « Le travail qui ne paie pas ronge les motivations, de l’intérieur, lentement. »)
Fort d’un statut plus avantageux que beaucoup, Mathias Bonneau peut comparer ses conditions de travail, difficiles à l’évidence, avec celles de collègues qui n’ont pas d’accès garanti à une forêt ou, au contraire, sont salariés pour s’occuper d’un vaste domaine. Malgré tout, l’auteur ne parvient toujours pas à obtenir l’équivalent du salaire minimum et sa rémunération ne commence à se stabiliser qu’au bout de dix ans d’activité. La nécessité d’une forme de viabilité économique, qui n’est garantie que par des volumes de bois toujours plus importants, le pousse à se demander quel serait le critère validant le travail effectué. « En dehors de quelques êtres extraordinaires, il semble que seuls ceux qui travaillent vite et fort, dans des forêts malmenées, peuvent arriver à un semblant d’équilibre économique. Ils seraient, eux, des bons bûcherons ? » Sans doute le sont-ils, oui, pour les tenants d’une exploitation industrielle des forêts, majoritaire dans ces régions. Néanmoins, le critère économique n’est pas suffisant pour attester de la viabilité d’une activité.
Écrire ce que l’on ressent, décrire ce que l’on fait
Bûcheron nous plonge, « en vrac et sans retenue », dans le quotidien d’un travailleur forestier passionné par les peuplements qu’il concourt à façonner. Passionné n’est pas assez fort – habité serait sans doute plus juste tant l’auteur se livre tout entier. « Le bois, le bois, le bois. Je ne fais que ça, je ne pense à rien d’autre. […] Je me sens à ma place, pas que ce soit confortable, mais, de la même manière que les arbres écrasent leurs racines contre la roche sous eux, je suis calé dans cette vie de fatigue. » Plusieurs fois, Mathias Bonneau l’écrit : c’est en forêt, dans les bois, avec une tronçonneuse en main que « j’existe vraiment ». Oui, ajoute-t-il : « Je dois couper du bois sinon je n’existe pas. »
Exister est une chose, mais à l’évidence, ça n’est pas suffisant pour publier un livre. Encore faut-il savoir dire, décrire, transmettre ce que recoupe cette existence. Dès lors, comment écrire sur ce que l’on fait ? Dans un texte commentant sa façon d’écrire, Georges Navel explique l’attitude qu’il a adoptée pour rendre possible la description des nombreux travaux qu’il a effectués durant sa jeunesse. « Je me suis dit que j’allais devenir attentif à ce que je faisais. Je voulais trouver un accord dans le réel. Le maniement de l’attention intérieure retournée sur l’outil, sur la pelle, sur la pioche, m’ont permis de découvrir un merveilleux moyen d’illumination. » (Navel, 1982)

C’est une même illumination qui frappe régulièrement à la lecture de Bûcheron. Une sorte de lucidité dans la description, qui ne peut toutefois être autre chose qu’une reconstitution. Car dès son premier abattage, l’auteur prévient : « La sensation de voir un arbre tomber est enivrante, mais elle ne se décrit pas, je n’ai trouvé d’autre moyen pour la garder en moi que de la revivre sans fin, et continuer de couper du bois. » La mobilisation de tous les sens et la saturation de certains ne permet pas la parfaite retranscription de l’effort impliqué dans l’abattage. « Ce mélange intime et profond entre la violence du fracas et la douceur de la précision fabrique une émotion incompréhensible et indomptable. »
C’est donc après coup, par le souvenir immédiat de l’action achevée, que l’élucidation de ce qui vient de se passer intervient. Ainsi, par exemple, lorsqu’il tranche pour la première fois une charnière au moment où l’arbre entame sa chute pour mieux guider la direction qu’il va prendre. Surpris par son geste, il note après l’avoir effectué : « J’existe désormais pendant la chute d’un arbre. » Et ça n’est qu’en l’écrivant que cet état de fait devient permanent – oui, à partir de maintenant, il existera toujours potentiellement pendant qu’un arbre s’effondre.
Enfin, l’observation des autres a joué un rôle déterminant dans l’objectivation des propres gestes de l’auteur. « Je regarde souvent mon père pendant qu’il travaille » écrit-il dans les premières pages. En forêt, commente-t-il à la fin de son ouvrage, « je n’ai jamais été seul ». Collègues, amis, famille, stagiaire, de nombreuses personnes sont venues l’aider ou apprendre auprès de lui dans la forêt du Passet. Leur montrer quoi faire, les regarder travailler, c’est aussi se voir, par contraste ou en miroir. Aussi Bûcheron nous rend-il familiers tous ces « copains de bois », parmi lesquels Benjamin, François, Charly, Jean et tant d’autres. Le titre du livre aurait d’ailleurs pu se décliner au pluriel – Bûcherons – tant ils sont nombreux à peupler les pages et à inspirer l’auteur dans son quotidien.
Nota bene
Il faut sans doute ajouter une dernière chose : ce bûcheron, je le connais. Rien d’exceptionnel à ça. Nous sommes plusieurs, journalistes et chercheurs, à l’avoir contacté après la lecture de L’Hiver au bois ou d’Une fois l’arbre à terre, souhaitant voir dans son travail4 l’auteur des planches dessinées. Mais tout de même. C’est dans la forêt du Passet, celle où se déroule la plupart des scènes décrites dans ce livre, que j’ai appris à manier une tronçonneuse en même temps que commencé une enquête sur l’espace alternatif forestier. Ça n’est pas rien. Cette recension n’aurait donc pas su être neutre, si tant est que ce soit possible, car un peu d’amitié l’innerve.
Bibliographie
- Anonyme, 2003, La scierie, Héros-Limite.
- Bonneau, Mathias, 2013, L’hiver au bois, réédition La Cabane éditions (2023).
- Cassola, Carlo, 2017, La coupe de bois, Sillage.
- Cyprine et Layé, 2022, « Les forêts, du fantasme occidental à l’émancipation décoloniale », Z – Revue itinérante d’enquête et de critique sociale, n° 15.
- Dodane, Clément, 2009, Les nouvelles forêts du Massif Central : enjeux sociétaux et territoriaux. Ces hommes qui plantaient des résineux pour éviter la friche, thèse de doctorat, géographie, École normale supérieure de Lyon – Lettres et sciences humaines.
- FCBA, 2014, « Les accidents du travail en exploitation forestière sur la période 2000-2012 », FCBA INFO, 7 p.
- FCBA, 2022, « La sécurité des opérateurs forestiers : conséquences de la fragilisation des arbres liée notamment au changement climatique et à ses impacts », FCBA INFO, 24 p.
- Harrison, Robert, 2010, Forêts : essai sur l’imaginaire occidental, Flammarion.
- Kesey, Ken, 2013, Et quelques fois j’ai comme une grande idée, Monsieur Toussaint Louverture.
- Lejczyk, Anouk, 2023, Copeaux de bois, éditions du Panseur.
- Marlantes, Karl, 2022, Faire bientôt éclater la terre, Calmann-Lévy.
- Marty, Pascal, 1998, « Propriété privée et politique de reboisement. Le cas des groupements forestiers », Économie rurale, n° 244, p. 41-48.
- Moineau, Bertrand et Nicolas, Laurène, « Entreprises de travaux forestiers quels profils à l’avenir ? », étude réalisée par 1630 Conseil, financée par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, l’Office national des forêts et la Fédération nationale entrepreneurs des territoires, 2021.
- Navel, Georges, 1982, « Le travail d’écrire », dans l’ouvrage collectif Georges Navel ou la seconde vue, Le Temps qu’il fait.
- Peer, Oscar, 1999, Coupe sombre, Zoé.
- Schepens, Florent, 2003, « Bûcheron : une profession d’homme des bois ? », ethnographiques.org, n° 4.
- Schepens, Florent, 2005a, « Du bûcheron à l’entrepreneur de travaux forestiers : approche compréhensive de la constitution d’un groupe professionnel », Ruralia. Sciences sociales et mondes ruraux contemporains, n° 16-17.
- Schepens, Florent, 2005b, « L’erreur est humaine mais non professionnelle : le bûcheron et l’accident », Sociologie du travail, vol. 47, n° 1.
- Schepens, Florent, 2013, « Se réaliser au mépris du corps : les entrepreneurs de travaux forestiers », Sociologies pratiques, vol. 26, n° 1, p. 57-69.
Image d’accueil : photographie de Mathias Bonneau par Roméo Bondon.
Retrouvez un entretien de Roméo Bondon avec Mathias Bonneau et l’écrivaine Anouk Lejczyk dans Ballast : « Forêt, travail, littérature – poursuivre le dialogue » (13 mai 2025).

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- « C’est vrai que l’exploitation forestière, il y a encore beaucoup de gens qui voient ça comme un bûcheron avec une hache sur l’épaule. Je pense que c’est de ce côté-là qu’il faut lutter contre cette vision […]. » Intervention enregistrée par l’auteur de l’article lors des Assises de la forêt et du bois en Limousin, octobre 2024.[↩]
- Alexandra Chaignon, « Les bûcherons, premières victimes de la forêt », L’Humanité, 10 décembre 2019.[↩]
- Creuse, octobre 2024.[↩]
- En référence à la trilogie de John Berger, Dans leur travail, Héros-Limite, 2024.[↩]







