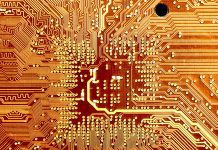Jean Hegland, Dans la forêt, éditions Gallmeister, Paris, 2017
« J’ai vécu dans une forêt de chênes toute ma vie, et il ne m’est jamais venu à l’idée que je pouvais manger un gland. »
De l’extérieur, il ne reste rien : plus rien ne fonctionne, plus rien ne vient. Le monde moderne s’est effondré sous le poids de ses excès. Nell et Eva, deux jeunes sœurs de 17 et 18 ans, se retrouvent brutalement livrées à elles-mêmes. Seules dans leur maison dans la forêt, elles vont devoir faire leur deuil du monde d’avant, apprendre à se nourrir et à se soigner, à survivre sans perdre leur humanité. Écrit il y a 20 ans, Dans la Forêt de Jean Hegland est un premier roman dont la traduction française vient de ressortir en poche. S’il peut être considéré comme une fiction de l’effondrement, on est loin de la fresque post-apocalyptique : dans la Forêt il n’y a pas d’émeutes, de kalash ni de grandes scènes d’affrontements, mais une unité de lieu et de personnages qui fonctionne comme le puzzle d’un écosystème à recréer. Dans la Forêt est avant tout le récit initiatique d’un dessillement.
C’est toujours une chose curieuse que de lire ces dystopies qui décrivent une société à feu et à sang, privée d’électricité et d’eau potable, de vivre par procuration l’effondrement d’une société. C’est toujours une chose curieuse que de lire l’anticipation de ce que l‘on redoute et combat toute l’année. Emballement climatique, pénurie des biens essentiels à la vie, rupture des liens sociaux, guerre pour l’accès aux ressources mais aussi, parfois, redécouverte d’une autre humanité : les romans ont ceci de précieux par rapport aux essais qu’ils ne parlent pas qu’à l’esprit mais aussi au cœur. Aux tripes parfois. Ils s’ancrent dans des trajectoires de vie, s’incarnent dans des personnages sensibles, doués d’émotion tout autant que de raison, en osant faire appel aux sens, voire à la sensualité. Et cela permet parfois de dépasser le stade de l’intuition cérébrale, de l’information pour rentrer dans le champ de la connaissance intime, celle que l’on éprouve et qui percute. C’est le cas à la lecture de Dans la Forêt qui vous projette littéralement dans le récit en distillant des sensations visuelles mais aussi olfactives ou tactiles, tenaces comme un parfum de résineux dans les veines. Ce n’est pas un hasard si Dans la forêt agit comme une communion, et si celles et ceux qui l’ont reçu éprouvent l’envie de l’offrir à leur tour.
« Quand je pense à la façon dont nous vivions, à la désinvolture avec laquelle nous usions les choses, je suis à la fois atterrée et pleine de nostalgie. »
Dans la Forêt nous emmène dans la vie bouleversée de deux femmes qui n’ont rien de guerrières-soldats, rien de survivalistes entraînées. Face à un contexte entièrement chamboulé, d’une soudaineté imprévue et d’une ampleur angoissante, Nell et Eva ne sont pas préparées. Le récit de Jean Hegland alterne flash-backs de la vie d’avant, futile et facile, et scènes quotidiennes faites de la somme de grands et petits problèmes inédits que font surgir isolement et pénurie. Ainsi après avoir fait l’inventaire et le tri de leurs possessions, raclé les fonds de tiroirs et vidé chaque armoire, Nell et Eva réévaluent, à l’aune de l’usage, l’inutilité d’un ordinateur privé d’électricité autrefois adoré, et la richesse a contrario d’un guide botanique, d’une graine à semer, toutes ces petites choses qui, insignifiantes et délaissées en période d’abondance, deviennent trésors à l’heure de la carence. Un cahier, un stylo pour écrire deviennent le plus précieux des cadeaux, des chaussons de danse élimés rafistolés font office de renaissance. Les deux sœurs doivent apprendre à vivre avec le spectre de l’épuisement, qu’il consiste à faire sans ou à économiser ce qui s’amenuise petit à petit : danser sans musique, lire chaque entrée de l’encyclopédie, improviser Noël autour de fins de bougies consumées. Dernières gouttes de pétrole, dernières conserves, dernières chandelles, dernières réserves font éprouver aux deux jeunes femmes l’oscillation entre une sage restriction et l’envie irrépressible de tout cramer dans une ultime explosion de joie, éphémère mais sublime. Quand les vestiges de l’ancien temps finissent par s’épuiser, il leur faudra choisir entre élan et prudence. « Je voulais vraiment que tu te serves de cette essence pour danser », dira Nell à Eva à la fin du roman.
« Et comment des buissons ou des fleurs ou des mauvaises herbes peuvent-ils nous nourrir, nous vêtir, nous guérir ?
Comment ai-je pu vivre ici toute ma vie et en savoir si peu ? »
Et puis, au fur et à mesure de la nécessité et du dénuement, les deux sœurs se tourneront vers la forêt, cette étrangère mystérieuse et redoutée : et si la plus grande source d’approvisionnement, loin des placards et des maigres restes de l’anthropocène, se situait là ? Mais faire confiance à la forêt, oser s’en approcher et s’y laisser glisser, est un apprentissage qui ne va pas de soi. Aller chercher en forêt de quoi continuer à vivre revient à hésiter devant des plantes qui peuvent guérir ou tuer, nourrir ou empoisonner. Il leur faudra apprivoiser les peurs ancestrales tout en écoutant leur cerveau reptilien, redécouvrir leur corps et ses besoins, ses limites et ses capacités réelles. Se dépasser sans s’abîmer. Nell et Eva vont devoir apprendre à retrouver en elles-mêmes leur part d’animalité, sans pour autant jamais renoncer à l’écriture, à la danse. Réconcilier charnel et cérébral, redevenir Une, singulière et universelle. Et alors oui, la Forêt…
« Petit à petit, la forêt que je parcours devient mienne, non parce que je la possède, mais parce que je finis par la connaître. Je la vois différemment maintenant. Je commence à saisir sa diversité – dans la forme des feuilles, l’organisation des pétales, le million de nuances de vert.
Je commence à comprendre sa logique et à percevoir son mystère. »
Dans la Forêt est un récit de sororité, d’une puissante sensualité. C’est aussi le conte d’une humanité retrouvée et augmentée – non d’appendices électroniques géolocalisés, ou de dispositifs transhumanistes, mais du lien symbiotique qui nous lie au monde vivant dans son entièreté. Un roman qui nous relie à la gratitude du présent et nous invite à envisager la biodiversité non plus comme un puits mais comme une source. D’une puissance sourde, organique et poétique, Dans la Forêt brouille les frontières que nous avons nous-mêmes tracées entre l’Homme et son environnement, sans pour autant verser dans l’angélisme – l’expérience est dure – ni dans l’antispécisme : les deux héroïnes conservent entière leur part d’humanité, leur soif de culture et d’intellect, leurs fêlures humaines. Il est d’ailleurs remarquable que la danse, expression par excellence du corps et de l’esprit mêlés, soit au cœur de ce récit. Simplement, tout en conservant leur humanité, Nell et Eva devront également renouer avec leur part animale, telles des louves domestiquées qu’on aurait relâchées en forêt et qui ne sauraient plus quoi faire de leur liberté.
« Avant j’étais Nell, et la forêt n’était qu’arbres et et fleurs et buissons.
Maintenant, la forêt se sont des toyons, des manzanitas, des arbres à suif, des érables à grandes feuilles, des baies, des groseilles à maquereau, des groseilliers en fleurs, des rhododendrons, des asarets, des roses à fruits nus, des chardons rouges, et je suis juste un humain, une autre créature au milieu d’elle. »
On oublie trop souvent que la libido, transformée un peu rapidement par les Freudiens en synonyme de pulsions sexuelles, est avant tout l’énergie qui sous-tend les instincts de vie. Dans la Forêt est un texte vivide et charnel, empreint de cette farouche envie, entre rage et désir. On n’y trouvera pas de programme politique, de solutions institutionnelles ni de collectif organisé, mais un appel à interroger notre capacité intime à développer des facultés d’adaptation et de résilience en nous ouvrant au monde qui nous entoure. Il ne s’agit ni de glorifier un retour aux sources, ni d’apposer quelque morale à la nature : mousses humides, souches qui pourrissent, arbre refuge et racines, la forêt de Jean Hegland n’est ni hostile ni accueillante, elle est. Aux filles d’y trouver leur place, d’en tirer ce dont elles ont besoin et, à tâtons, de bâtir leur nouvelle humanité.
On n’est pas obligé d’attendre la fin du monde pour commencer.