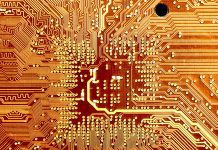Cet entretien de Marin Schaffner avec Jade Lindgaard est extrait du recueil de textes Un sol commun, qui paraîtra le 10 mai 2019 pour les dix ans des éditions Wilproject.
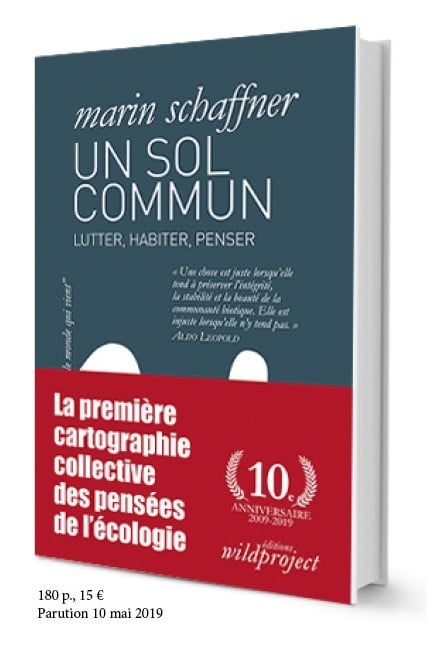
Il y a dix ans, quelle était la couverture médiatique de l’écologie ?
En 2008, on était un an après le rapport du GIEC qui a vraiment popularisé la question du climat, qui l’a sorti de sa niche – et aussi dans la foulée du film d’Al Gore de 2006. Mais 2009, c’est aussi le livre climato-sceptique de Claude Allègre, qui, je m’en souviens, avait à l’époque complètement recouvert médiatiquement le Sommet du climat de Copenhague. Depuis, la remise en cause du rôle des humains dans le dérèglement du climat a pris du plomb dans l’aile, heureusement, mais c’était il n’y a pas si longtemps, il faut donc rester méfiant. D’ailleurs, ce qui me frappe, c’est qu’en 2008, 2009, 2010, les discours écologistes qui étaient présents dans les médias français étaient des discours plutôt technocratiques, et que le grand impensé de tous ces gens, y compris les ONG, c’était déjà la question sociale et la question des inégalités.
À côté de ça, j’ai le sentiment qu’en dix, douze ans, dans les quartiers populaires et les banlieues, plein d’alternatives se sont développées par le bas. Ce sont des choses souvent disparates et isolées, mais il y a eu une indéniable massification de plein d’expériences de récupération de vêtements, de récupération de livres, d’amap, la pratique du vélo, du compostage, des groupes climats, etc., dans plein de villes et dans les banlieues des grandes agglomérations. En revanche, ce qui n’est toujours pas présent et qui est très problématique, c’est un discours politique écologique en lien avec ce qui se vit dans les quartiers populaires et les banlieues.
Pour donner un exemple très modeste, avec un petit groupe de personnes de Seine-Saint-Denis, on avait organisé en 2014- 2015, dans les quartiers proches du Bourget où devait se dérouler la cop21, des toxic tours qui alertaient sur cette question des inégalités face au dérèglement climatique et à la pollution. C’était donc des visites guidées de lieux d’émission de gaz à effet de serre et de toxicité de l’atmosphère. Il y avait l’aéroport du Bourget, les data-centers de La Courneuve, l’autoroute A1 à Saint-Denis, etc. Et ce qui était très frappant, c’est l’écho que ces événements très modestes avaient rencontré auprès des gens. Et aussi le fait que les élus du territoire l’avaient très mal pris, alors que c’était de simples visites guidées sur de l’existant. Mais aujourd’hui, plus de trois ans après, alors que j’imaginais que plein de gens allaient s’engouffrer là-dedans, personne n’a investi cet espace.
Donc cette distance entre les ONG écologistes et les habitants des quartiers populaires, elle existe toujours. Pourtant les chantiers sont énormes : rendre obligatoire la rénovation des bâtiments pour améliorer les conditions de vie des précaires, mettre en place des services publics de mobilité pour les ménages trop pauvres pour vivre près des grands axes de transport, etc. De ce point de vue, la justice environnementale me semble être un des manques les plus criants à combler en termes de recherche, de réflexion intellectuelle et d’interpellation politique.
Et du point de vue des idées ?
Sur les dix ans qui viennent de s’écouler, je crois que plein d’idées ont émergé, se sont répandues et articulées. Et en premier lieu, la question écoféministe, parce qu’il y a dix ans, l’écologie comme le féminisme semblaient être des préoccupations secondaires, et qu’elles ont toutes deux été réarmées et réintroduites dans le débat, ce qui me paraît être vraiment important car ce sont des questions fondamentales. Sinon, je pense pêle- mêle au climat comme registre de critique du capitalisme, à toutes les discussions critiques autour de l’anthropocène (qui recoupent cette question des inégalités, car ceux qui polluent vraiment ce ne sont pas tous les humains mais bien les plus riches des riches, d’où l’idée de capitalocène), ou encore à cette thématique de l’effondrement (qui, elle aussi, doit être mise en critique car elle est anxiogène et ne conduit donc pas, selon moi, à des usages politiques émancipateurs).
Donc plein de nouvelles idées, mais je reste méfiante vis- à-vis de toutes ces catégories qui continuent à maintenir des séparations dans les imaginaires entre « eux » et « nous », entre les Blancs et les autres, entre les riches et les pauvres, bref toutes ces séparations qui sont exactement à l’origine des injustices climatiques. Finalement, on a vraiment progressé en France ces dix dernières années autour de la déconstruction des idées dualistes – notamment nature/culture, humain/non-humain – ; mais en revanche, ce qui n’a pas du tout été déconstruit, c’est la ligne de partage Nord-Sud, qui traverse aussi notre société en profondeur. Donc, la dimension intersectionnelle des effets du changement climatique et du système qui a causé ce changement climatique reste largement ignorée. Et ça, c’est un vrai travail à prolonger au sein des sociétés occidentales.
Pour moi, en France, un des vrais chantiers à ouvrir, c’est celui du racisme environnemental. Parce qu’on n’en parle quasiment pas, on fait comme si ça n’existait pas – avec cette espèce d’indifférence traditionnelle très française de la dimension raciale des inégalités –, mais c’est un des sujets sur lesquels j’ai vraiment envie de travailler et d’interpeller dans les années qui viennent. Et il faut le faire pour pouvoir amener ces questions écologiques dans les banlieues parce que c’est un enjeu majeur tant d’un point de vue social qu’environnemental.
Selon vous, qu’est-ce que l’écologie fait au journalisme ?
J’ai récemment fait une enquête sur la précarité énergétique en Seine-Saint-Denis auprès de familles, en allant à leur rencontre. Et face à un sujet comme celui-là, tu vois clairement que l’écologie aujourd’hui est intrinsèquement une question d’inégalités sociales, mais aussi une question d’inégalités territoriales et d’urbanisme. Et c’est donc une vraie question de territoire, au sens le plus plein, le plus social, le plus humain du terme.
Ces questions d’écologie me font donc me déplacer dans ma manière de travailler en tant que journaliste. À titre personnel, ces questions depuis dix ans ont changé plein de choses dans ma vie, dans ma compréhension du monde, dans les pensées que j’ai rencontrées. Mais ça a aussi changé ma manière de travailler parce que l’écologie oblige le journaliste – au sens presque moral du terme – à s’engager dans les sujets, dans ce qu’il en dit et dans les conclusions qu’il en tire. L’habitude journalistique est plutôt de décrire des phénomènes à une échelle macro – et ça il ne faut pas arrêter car on en a besoin pour comprendre les évolutions du monde –, mais ce qui manque, c’est aussi de quitter un discours qui est encore majoritairement trop un discours d’expertise, un discours technocratique. Il faut allier les données et la compréhension des problèmes avec des récits incarnés, humanisés mais qui ne soient pas dépolitisés.
Ce que je défends, c’est un journalisme activiste – ce qui est une position vraiment minoritaire dans le monde médiatique. Mais je la défends parce que je ne veux pas accepter le main- tien du cadre dominant d’interprétation. Un des murs à faire tomber, à mes yeux, c’est la séparation mortifère entre analyse et action.
Pensez-vous que l’écologie permet de reterritorialiser les luttes sociales ?
Ça me paraît juste, oui. Parce que les ennemis aujourd’hui sont énormes. Or, ces multinationales et ces États, ce n’est pas une manifestation en France qui va les faire vaciller. Par contre, en relocalisant les problèmes, en les resituant, en s’opposant à telle activité précise, tel lieu, telle usine, tel projet, on peut les bloquer, on peut les arrêter.
Une des choses les plus marquantes et les plus importantes ces dix dernières années, de ce point de vue-là, c’est bien entendu ce qui s’est passé à Notre-Dame-des-Landes. Cette expérience de la zad, je crois que c’est une contribution majeure à la dimension politique de l’écologie en France. Ça a été la preuve que ça peut fonctionner, qu’il est possible de mettre en place des alternatives radicales au modèle capitaliste, à la puissance de l’État qui le défend et aux logiques de marché. Et c’est dommage car cette zad a été très caricaturée par le monde médiatico-politique, ce qui a contribué à invisibiliser l’importance pour une société d’une expérience comme celle-là – même quand tu n’es pas zadiste. Parce que, sur la zad, ce qui a été fascinant, c’est cette volonté d’habiter autrement, de décider autrement, de cultiver autrement, de produire autrement. Par conséquent, un des enseignements de ça, c’est la pertinence et la légitimité – et peut-être même la nécessité – de ces espaces territorialisés de lutte, d’alternative et de réflexion.
Tout ça ne va peut-être pas empêcher les catastrophes, mais ça permet de commencer à défaire certaines dominations et certains modes d’exploitation. L’écologie est féconde aujourd’hui parce qu’elle permet d’articuler de façon concrète la critique de dominations qui sont intrinsèquement liées à cette destruction de la planète. À ce titre, ce qui est terrible dans notre présent, c’est la difficulté à concilier le temps des expériences, des tentatives et des échecs – avec une forme d’urgence à agir. Face à cela, il n’y a pas de solutions, il n’y a que des luttes et des rapports de force. Certes, ce n’est pas rassurant, mais ça nous pousse à l’engagement.