Vos deux ouvrages abordent la pratique naturaliste et, par-là, l’ontologie naturaliste1 telle qu’elle a été définie par Philippe Descola. Alors qu’on cherche souvent dans un ailleurs lointain les manières d’élucider les écueils de ce rapport au monde, vous le faites depuis ses espaces propres. Les Veilleurs du vivant se conclut ainsi : « le régime de savoir naturaliste est à la fois l’enfant premier-né et l’antidote de notre rapport au monde ». Gardons ce dernier mot, antidote : est-ce ce que vous l’aviez en tête au moment de commencer vos enquêtes respectives ?
Vanessa Manceron : Quand j’ai commencé mon enquête sur les pratiques naturalistes amateurs en Angleterre, Par-delà nature et culture, était déjà paru. Je lisais dans le même temps les philosophes et les anthropologues qui tiraient les conséquences de l’ontologie naturaliste pour en faire la critique, considérant que cette vision du monde conduit à considérer la nature comme un simple entourage dont les modernes, du fait de leur exceptionnalité et de leur position supérieure dans l’échelle du vivant, se sont extraits par la culture. De sorte, ils ont pu exercer librement leur volonté de puissance et d’assujettissement, qu’il s’agisse d’en faire un stock de ressources dans lequel puiser sans restriction ou qu’il s’agisse de la protéger et, ce faisant, de lui assigner une position subalterne.
Tandis que j’observais le rapport à la nature qu’expérimentent les observateurs de la faune et de la flore que je suivais sur le terrain un certain nombre de dissonances ont surgi. J’ai en effet découvert des hommes et des femmes qui se relient intensément et pour la vie à certaines catégories d’êtres vivants, qui pour les connaître s’immergent dans leur monde et tentent d’approcher ce que cela veut dire d’être une plante ou un oiseau. Ce sont des gens que les manières d’exister des vivants émerveillent, parce qu’elles sont autres, intrigantes et éminemment variables. Ils aiment et étudient les plantes et les animaux pour ce qu’ils sont et font en situation, sans finalisme, sans désir de transformation ou d’appropriation, ni même d’interaction, car ils cherchent des alignements avec des êtres autonomes et libres, considérant qu’ils font partie du même tissu symbiotique.
Les naturalistes amateurs échappent donc à la critique du dualisme mortifère parce que celui-ci n’est pas étanche. Mais surtout, et c’est sans doute ce qu’il y a de plus intéressant, ils ne rompent pas pour autant avec l’ontologie naturaliste telle que la définit Descola, ni ne témoignent par leurs pratiques d’un quelconque désir d’animisme. Ils incarnent selon moi une potentialité relationnelle de l’ontologie naturaliste mal connue et impensée, qu’il m’importait de décrire. On a à faire avec un régime de connaissance héritée des débuts de la modernité qui produit des schèmes relationnels symétriques et d’une grande intensité, bien étrangers aux jugements réducteurs sur l’incapacité des modernes à se relier et à considérer avec respect et équité les autres vivants. C’est pour cela que je trouve très important de toujours situer nos connaissances et ne jamais céder à la tentation de cesser de rendre compte des variations et de la singularité des situations.

Romain Bertrand : Ce qui me frappe, tout d’abord, c’est la polysémie du mot « naturalisme ». Chez Descola, le terme qualifie une ontologie constitutive de ce que serait un régime de modernité essentiellement européen. Mais le mot désigne aussi le domaine des sciences naturelles tel qu’il s’institutionnalise aux XVIIIe et XIXe siècles et, enfin, un mouvement littéraire. D’une certaine façon, une part conséquente de l’argument du Détail du monde se déploie dans la tension entre l’acception littéraire et l’acception scientifique du mot. Le naturalisme littéraire porte en lui l’idée qu’il est possible de produire la transcription immédiate d’un monde qui nous serait d’emblée donné pour ce qu’il est. Au XIXe siècle, il y a un nœud étonnant : la pratique scientifique de l’histoire naturelle et certains modes de mise en récit littéraire convergent vers une appréhension du réel par la description de ses singularités, par le biais d’écrits ou de croquis. Le littéraire et le scientifique sont alors entrelacés dans une même quête des mots justes pour dire le monde tel qu’il se présente à nous, avant que nous ne nous mettions à le travestir au moyen de nos émotions. On cherche des lois, bien sûr, des régularités, mais jamais aux dépens des phénomènes, qui sont toujours décrits de façon circonstanciée. Goethe, qui était tout à la fois un remarquable poète et un excellent naturaliste, disait : « ne cherchons rien derrière les phénomènes ; ils sont la théorie elle-même ».
Ensuite, ce qui m’a le plus marqué, à l’époque de la parution de Par-delà nature et culture, n’a pas été le chapitre consacré au naturalisme, ni ceux dédiés à l’animisme ou au totémisme, mais celui portant sur l’analogisme. A priori, l’analogisme est très éloigné de notre rapport au monde : il trace des réseaux de ressemblances labyrinthiques à la surface du réel ; il fragmente le monde en une myriade de propriétés et d’entités, puis les relie les unes aux autres en d’étranges patchworks. C’est une sorte de tableau général des correspondances, mais un tableau en mouvement perpétuel, dans lequel tout fait toujours signe vers quelque chose, puis vers autre chose : une fleur vers un minéral, vers une couleur, vers une direction cardinale.
Les exemples analogistes de Philippe Descola sont majoritairement tirés d’un ailleurs aux allures exotiques : la Chine impériale, les sociétés nahuas du Mexique central juste après la conquête espagnole. Mais, dans ce chapitre, il y a aussi de l’autrefois, c’est-à-dire du « nous », puisque la Renaissance est mentionnée. L’analogisme n’est donc pas seulement l’ontologie des autres, mais aussi la nôtre. Je suis ressorti de cette lecture avec une simple, mais redoutable question historique : quand et comment passe-t-on, en Europe, de l’analogisme au naturalisme ? Dès lors que l’on y prête attention, on trouve, dans des textes de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, des échos ou des rémanences de ces savoirs analogistes. Par exemple, la « théologie naturelle » de William Swainson ou du révérend Kirby trace des liens qui nous semblent aujourd’hui parfaitement incongrus entre les êtres parce qu’ils ont un seul trait morphologique commun ou le même mode de locomotion. Le toucan et le rhinocéros en viennent ainsi à figurer dans la même catégorie, tout simplement parce qu’ils ont une corne. Il y a là tout un ensemble de systèmes de classification qui n’obéissent pas aux principes de Linné : des inventaires rebelles du monde. Plus tard, bien plus tard, on peut lire dans la poésie de Francis Ponge une espèce de révolte similaire contre le naturalisme, la volonté d’en revenir à une description en surface des choses.
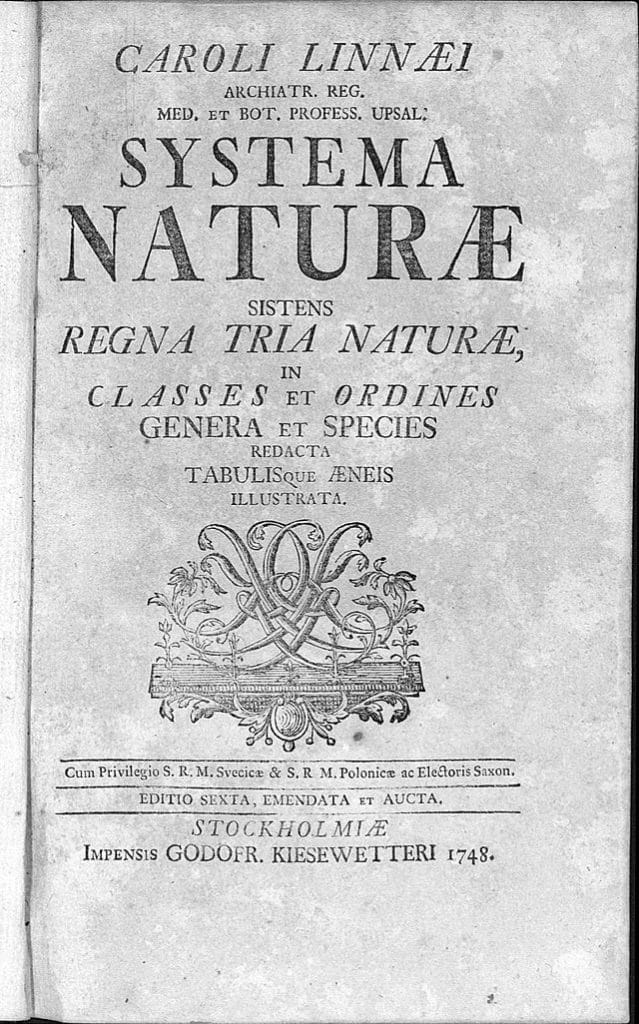
La lecture de Philippe Descola m’a donc placé dans un embarras d’historien, et, depuis ce moment-là, des questions m’habitent : est-ce qu’il y a vraiment eu une transition de l’analogisme au naturalisme ? Est-ce que nous avons adopté une manière d’être au monde qui nous a irrémédiablement mis à part d’autres régimes de connaissance ? Le naturalisme ne garde-t-il pas plutôt le souvenir ou la cicatrice de l’analogisme ? Ne possède-t-il pas toujours un revers analogiste ?
Dans Le Détail du monde, vous écrivez en guise de conclusion : « le pluriel est de retour et l’infinie variété du vivant, à nouveau, se donne à voir ». Les Veilleurs du vivant vient nuancer : la société britannique qui y est dépeinte n’a jamais cessé de décrire et, surtout, d’inscrire, de prendre note de ce qui est, dans sa pluralité.
V.M. : L’époque étudiée par Romain était celle où s’élaboraient les classifications. Les personnes que j’ai rencontrées dans le Somerset, dans le sud de l’Angleterre, sont les usagers de ces classifications quand bien même il leur arrive de découvrir de nouveaux hybrides – et cela change tout. L’effort descriptif est moins là pour établir les critères morphologiques permettant de discriminer et de classer les espèces, que pour apprendre à les distinguer et à les identifier dans leurs milieux. Et ce qui m’a beaucoup intéressé, c’est que les naturalistes usent à la fois d’un régime de la compilation à travers les inventaires et les listes d’espèces mais aussi d’un régime descriptif pour documenter par exemple les modes d’organisation d’une colonie d’oiseaux ou d’une communauté de plantes, en réalisant des croquis, des cartes, des relevés et en noircissant leurs carnets de terrain. Les listes d’espèces d’ailleurs, ne sont pas un classement froid de noms que l’on mettrait en boîte. Identifier et nommer exigent une telle attention aux détails, aux jeux des concordances entre les représentations d’après nature et ce qui est vu in situ, et aux milieux dans lesquels les êtres évoluent. Comme le montre bien Romain, les savoirs naturalistes peuplent le monde, font exister un plurivers, par l’immense attention portée aux détails, aux variations, à ce qui est visible à la surface des choses. Et c’est pour cela que l’on peut parler d’un régime d’attention qui est aussi une épistémologie, dont les naturalistes amateurs contemporains sont les héritiers. A la différence de ce qui s’est passé en France quand la biologie et l’écologie ont supplanté l’histoire naturelle à la fin du XIXe, en Angleterre l’histoire naturelle n’a pas été rabattue à une forme de survivance désuète. La tradition naturaliste y est très active et concerne un grand nombre d’individus respectés pour l’étendue de leurs savoirs, pour leurs écrits, pour leur contribution à la connaissance sur l’état de la biodiversité. On peut même parler à cet égard d’une science populaire qui compte un grand nombre d’experts mais aussi un grand nombre d’admirateurs. Aussi, même si l’histoire naturelle n’est plus l’épistémologie dominante comme au XIXe siècle, elle n’en demeure pas moins aujourd’hui une réalité importante bien vivante qui va même se déployant.
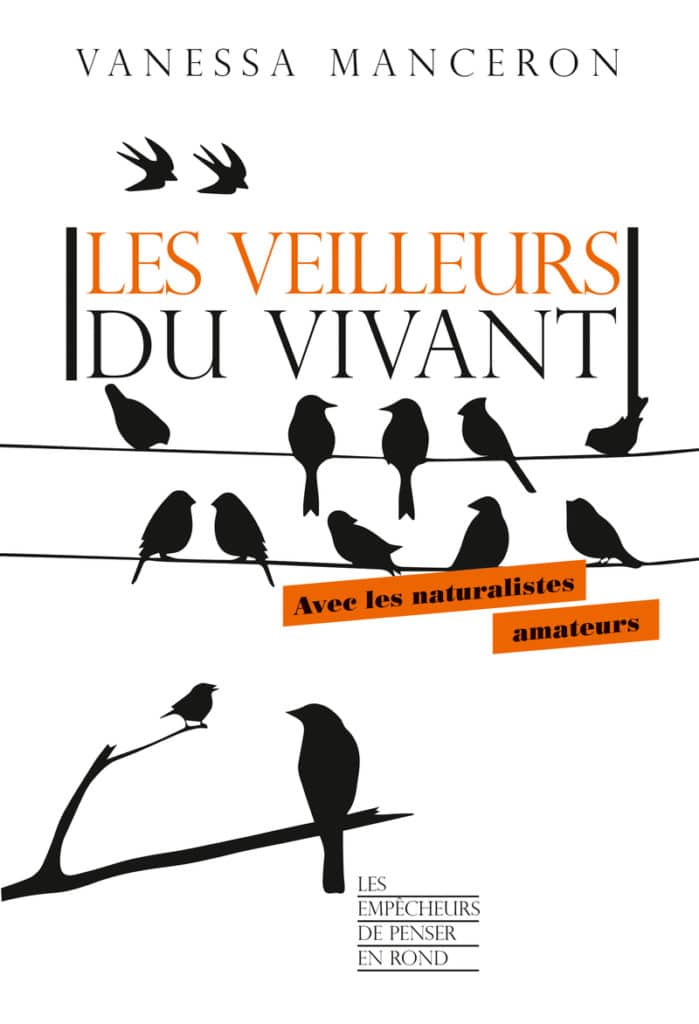
C’est une chose qui, semble-t-il, a évolué. Le Détail du monde montre des interactions très fortes dans la genèse de la pratique naturaliste entre description et collecte, chasse et collection. Les pratiques contemporaines décrites dans Les Veilleurs du vivant semblent se faire sans prédation aucune.
R.B. : Ce qui joue beaucoup, c’est que les naturalistes du XVIIIe et du XIXe siècle font commerce de leurs collectes. L’institutionnalisation et la fragmentation des savoirs naturalistes – la séparation de la botanique, de la minéralogie, de la biologie animale – s’est aussi traduite par la création d’emplois scientifiques spécialisés et rémunérés. Alfred Russel Wallace, contemporain de Darwin, n’est pas né, à la différence de ce dernier, avec une cuillère en argent dans la bouche. Il doit gagner sa vie. Il est d’abord arpenteur, puis répétiteur. Et lorsqu’il devient naturaliste, il doit en vivre. L’étendue colossale de sa collecte – plus de 120 000 items recueillis lors de son séjour en Insulinde, de 1854 à 1862 ! – est liée à leur commercialisation : la majorité de ces spécimens sont destinés à être vendus. Wallace possède même à cette fin un agent à Londres, Samuel Stevens, qui démarche les musées et les grands collectionneurs privés pour leur proposer des coléoptères rares, des dépouilles d’oiseaux de Paradis ou des peaux d’orang-outang. L’institutionnalisation des savoirs naturalistes a eu pour conséquence, assurément dommageable, de segmenter le champ des savoirs et donc d’interdire, ou du moins de délégitimer, les descriptions totalisantes qui incluaient dans un même récit une pluralité d’êtres et leurs entrelacements, comme chez Humboldt, où tout est décrit à même hauteur de casse, avec un même luxe de détails, de l’épiphyte à l’Indien Caribe. Mais ce processus a eu aussi pour résultat positif annexe de dissocier le revenu des naturalistes de leur capacité de collecte.

Par ailleurs, il y a eu, en Grande-Bretagne, un mouvement très précoce et très puissant de protection de la nature, et notamment des oiseaux. Ça a d’abord été un mouvement de dames patronnesses, qui a pris ensuite son essor dans les années 1920, où s’épanouit un premier protectionnisme. Une loi s’oppose à l’importation de plumes d’oiseaux exotiques dès 1885, et les débats sont nombreux au Parlement sur la réglementation des droits de chasse, notamment dans les domaines aristocratiques. Donc il y a eu, d’une part, une institutionnalisation des pratiques naturalistes, et, de l’autre, l’affirmation d’un souci de conservation. Mais les discussions sur le caractère létal de la collecte scientifique restent toujours très vives : je pense à un débat récent chez les biologistes marins. Dans leur discipline, collecter des spécimens veut parfois dire chaluter. Pour récupérer quelques individus des espèces que l’on étudie, on en met à mort beaucoup d’autres. Il y a des chartes d’éthique, portées plutôt par de jeunes chercheurs, qui sont en train d’être rédigées, pour mettre fin à ces pratiques.

On serait pourtant tenté de lier, jusqu’à aujourd’hui, collecte et collection. On peut penser, par exemple, aux « cocheurs » d’oiseaux, qui font le tableau de leurs observations. Pourtant, Les Veilleurs du vivant montre que c’est là une idée reçue.
V.M. : Au XIXe siècle, la forme collection était très présente : les spécimens allaient dans les musées, il y avait des « peaux » qui s’échangeaient… Les représentations d’après nature impliquaient une forme de boucle : elles se faisaient à partir d’un individu mort afin d’extraire un modèle générique avant de revenir à l’individu vivant. Avec les inventaires, cette forme disparaît, sauf parmi les lépidoptéristes ou les collectionneurs de papillons qui, en Angleterre, sont extrêmement mal vus et font leur collecte en douce. Il y a eu des débats houleux en Angleterre dans les années 1930 autour de la question du « naming without gun ». On se demandait alors si on pouvait faire science sans avoir le spécimen en main sous l’effet de nouvelles injonctions morales à protéger les oiseaux. Et ces débats ont pu également avoir lieu parce que se sont alors mises en place des techniques de reconnaissance visuelle des oiseaux à distance à l’aide des jumelles grossissantes et des guides d’identification. Ce tournant a fait entrer l’histoire naturelle dans la forme inventaire qui s’est substituée à la forme collection.
Les inventaires de choses vues dont on enregistre la présence ne sont pas analogues aux collections de spécimens parce que les données qui circulent entre les naturalistes n’ont pas de valeur d’échange. On peut contribuer, on peut apposer son nom à une découverte et en faire un enjeu de prestige, mais il n’y a pas un donneur et un receveur. C’est la contribution à une histoire de la nature, écrite collectivement et assortie d’une circulation intense d’informations qui est aujourd’hui en vigueur. Les naturalistes contribuent à la connaissance de la biodiversité et des milieux, chacun apporte une pierre à l’édifice, ce qui contredit l’idée selon laquelle les naturalistes ne seraient que des accumulateurs compulsifs de listes d’espèces et de trophées visuels. Les inventaires s’écrivent à plusieurs mains. Il s’agit de savoirs cumulatifs qui instituent le collectif comme sujet connaissant et qui ne sauraient trouver leur raison d’être dans la seule thésaurisation personnelle.

R.B. : De la fin du XVIe siècle jusqu’au début du XIXe, la collecte participe aussi, pour le naturaliste, de l’établissement de son cabinet personnel de curiosités. Les cabinets de curiosités ont au départ une fonction religieuse autant que scientifique : c’est l’ordre de la Création à demeure ; le contempler est une forme de piété. Mais, aussi, quand on recrute un professeur d’université, à Leyde par exemple, dans les années 1600, on lui demande d’amener ses collections comme preuve de son prestige et de sa crédibilité scientifiques. On retrouve ça jusqu’à Wallace, qui avait un cabinet somptueux, fait sur mesure, pour ranger ses coléoptères. On est donc passé d’un régime où le naturaliste, à travers son cabinet de curiosités, vend la qualité de son savoir, à un régime où des structures institutionnelles très fortes prennent en charge les frais d’inventaire, certifient et étalonnent la compétence scientifique selon le nombre de publications, de diplômes, d’années de service académique, etc.
Concernant le passage de la forme « collection » à la forme « inventaire », il faut peut-être moins penser un basculement de l’une à l’autre qu’une juxtaposition, et parfois une hybridation de leurs logiques : montrer, dénombrer, classifier. Si l’on sort de l’idée du caractère exclusif des grandes catégories ontologiques, et au premier chef de l’antinomie entre naturalisme et analogisme, alors on s’aperçoit qu’il existe, dans la pratique même des sciences naturelles, des régimes de savoir et de visibilité mixtes, qui entremêlent inextricablement des éléments des deux ontologies – c’est d’ailleurs pour cette raison que je parle de rémanences analogistes.
Reprenons la phrase citée tout à l’heure : « avec Ponge, le pluriel du monde est de retour ». Ce que j’ai voulu dire, c’est qu’« avec Ponge, le pluriel du monde est de retour dans les années 1930 ». Si j’ai arrêté mon enquête au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c’est avant tout pour laisser au lecteur le soin et la liberté de peupler la suite de cette histoire avec ses propres références contemporaines. Car les expériences de remariage entre arts et sciences, avec pour finalité la production de ce que Goethe appelait un « empirisme tendre », une description enamourée de son objet, sont nombreuses au XXe siècle, et on pourrait même dire qu’elles prolifèrent depuis une dizaine d’années. Mais c’est aussi parce que les années 1930 sont une période charnière. Comme le dit Ponge, on est alors saturé de savoirs qui « ne parlent que de l’homme » : philosophie, psychologie, sociologie, histoire… Toutes ces disciplines, dans ces années-là, sont des anthropocentrismes forcenés. Et si Ponge passe son temps à décrire des crevettes et des éponges, c’est, dit-il, pour « ne plus parler de l’homme ». C’est aussi à cette époque qu’on trouve la première biographie animale, avec Flush, de Virginia Woolf, l’autobiographie d’un chien. Ce projet littéraire va très loin : il s’agit de décrire le monde tel que le ressent un chien, un monde dont l’appréhension passe moins par la vision que par l’odorat : toute la biographie de Flush est une sorte de chemin d’odeurs. Dans ces mêmes années, il y a aussi de profondes crises en anthropologie : on voit apparaître les premières anthropologies inversées, symétriques. Dans The Savage hits back, publié en 1937, Julius Lips, qui vient de fuir la barbarie nazie, se demande comment les colonisés voient le colonisateur. Et la même année, dans une tribune publiée dans la presse britannique, Tom Harrisson – qui est tout à la fois birdwatcher et ethnographe – plaide pour « une anthropologie de nous-mêmes ». L’Europe sombre dans la violence la plus abjecte, et, du coup, le mur du grand partage entre « eux », les « sauvages », et « nous », les « modernes », les civilisés, se fendille.
Il y a donc tout un ensemble de craquements qui laissent place au doute, après ce grand moment de certitude scientiste qui a couru des années 1880 aux années 1920. C’est peut-être ce faisceau de doutes qui constitue la vraie crise intellectuelle de l’Europe de l’Entre-deux-guerres. Et de ce faisceau de doutes, une question émerge, étonnamment contemporaine : que serait une compréhension du monde qui ne mettrait pas l’homme – ou du moins une idée démesurée de l’homme – au point de départ et au centre de tout ? Nous avons oublié tous ces instants où le champ de nos savoirs s’est fissuré, et où nous avons pensé contre nous-mêmes. Le Détail du monde n’est pas du tout prescriptif : je ne tire pas de leçon péremptoire de mon enquête ; je dresse simplement l’inventaire de tout ce que nous avons essayé d’être. Quand on nous explique que nous sommes ceci, c’est immanquablement spécieux. Nous n’avons jamais été ceci et nous ne le serons jamais. Nous sommes toujours ceci, cela, et beaucoup d’autres choses. Tout propos généalogique tiré au cordeau, continuiste et essentialiste, est un discours de réassurance identitaire qui, historiquement, sonne faux.
V.M. : L’Angleterre offre des décalages très intéressants à penser. Selon l’historienne des sciences Lorraine Daston, les représentations d’après nature naissent au XVIIe siècle. L’histoire naturelle précède ce qu’elle appelle l’objectivité mécanique, quand il s’est agi de mettre le monde à distance sans inférence humaine, pour dévoiler les lois universelles de fonctionnement de la nature. Les naturalistes amateurs, héritiers d’une tradition de recherche des débuts de la modernité, ne considèrent pas que les émotions esthétiques, les affects et l’engagement personnel de l’observateur soient un obstacle à l’objectivation et à une bonne observation. C’est même tout l’inverse. Les savoirs sont justes et précis parce qu’ils ne sont pas exempts de doutes, d’interprétations, voire même dans certains cas d’une certaine dose d’anthropomorphisme. Et c’est sans doute ce que Romain appelle les rémanences de l’analogisme. De la même manière que les illustrations d’après nature n’excluent pas l’artiste de la représentation, les savoirs naturalistes n’excluent pas les observateurs du monde qu’ils étudient. Il s’agit d’une science avec des chercheurs dedans. Cette épistémologie qui assouplit et trouble la coupure entre sujet connaissant et chose à connaître, me semble particulièrement marquée en Angleterre. Et sans doute faut-il y voir l’influence historique de la tradition empirique qui fait de l’expérience sensible l’origine de toute connaissance. Le monde ne se connaît qu’en en faisant l’expérience sensible. C’est là un motif extrêmement fort qui explique sans doute aussi le succès outre-Manche de l’histoire naturelle mais aussi des pratiques amateurs.

Là-bas, les enfants sont incités en famille mais aussi à l’école et dans la littérature à apprendre le monde qui les entoure par les mots en nommant les espèces, mais aussi les noms de voitures, de locomotives… Cette attention à la diversité des choses et des êtres dans leur environnement le plus proche est un motif très présent qu’on ne retrouve pas de manière aussi évidente en France. L’Angleterre offre de ce point de vue un terreau très fertile à la prise empirique de la nature dans les campagnes, mais aussi dans les villes. Et certains individus finissent par en faire une part conséquente de leur existence en cultivant la part naturaliste d’eux-mêmes dans les à-côtés amateurs. Ils racontent que cette activité participe à la construction de leur individualité pour devenir des personnes accomplies, ce qui n’est pas sans lien avec l’influence protestante qui passe par la réalisation de soi dans les activités temporelles. Les naturalistes lient leur intériorité à une portion du monde extérieur pour former des compagnonnages qui peuvent durer toute une vie. Tout ceci explique le succès des sciences de terrain et l’extrême attention au milieu que j’ai observé en Angleterre. Sans doute la césure nature/culture n’aurait-elle pas été pensée comme l’a fait Descola par les anthropologues anglais, certains d’entre eux ayant même montré une certaine défiance vis-à-vis de la notion de culture. Selon eux, on ne peut faire l’étude que de ce qu’on peut observer empiriquement : les rapports sociaux, les interactions, c’est-à-dire les sociétés plus que les cultures, qui relèvent plus des symboles et de la signification que les individus donnent à ce qu’ils font. Tous ces éléments convergent pour penser que, depuis ses débuts, le naturalisme à l’anglaise est fissuré sous l’influence de la tradition empirique.
L’un comme l’autre, vous expliquez que tout romantisme est évincé par ces pratiques de description, que ce serait même le cheminement inverse : transformer le paysage environnant avec ses émotions internes.
V.M. : Absolument. Les naturalistes amateurs ne sont pas dans un mode projectif pour accroître leurs états intérieurs. En se reliant à la nature comme ils le font, ils ne construisent pas un paysage admiré à distance, ils plongent dans les détails, ils s’immergent, ils ont le sentiment qu’ils sont membres d’une espèce parmi les autres et que les êtres qu’ils admirent sont une part d’eux-mêmes. Il ne s’agit donc pas d’un système d’identification à la nature, mais d’un système qui crée la possibilité d’expérimenter une nouvelle version de la réalité, en étant avec et parmi. Ils ne voient pas non plus le sauvage comme un espace des confins où s’ensauvager. Le sauvage est ce qui est libre et autonome, mais qui peut évoluer dans les espaces habités et transformés par les hommes. Ils ne sont pas des romantiques s’extasiant devant un monde sans homme, ils se préoccupent des intrications entre les existants, dans des milieux où les êtres cohabitent avec les humains. Les naturalistes amateurs ont des prises très concrètes sur le monde et une volonté de comprendre comment les vivants habitent le territoire. La nature pour eux est un monde qui a ses propres logiques merveilleuses à observer, et qui transforme la perception qu’ils ont de leur environnement proche, non pas comme un entour et un espace, mais comme un milieu et un lieu auquel s’attacher et dans lequel s’immerger.
R.B. : La différence est frappante avec la France, mais aussi avec le naturalisme continental dans son ensemble, car j’étendrais ce contraste à l’Allemagne. En termes de généalogie, il y a deux mystères, ou deux points aveugles. Le premier, qui est d’ordre général, c’est qu’on nous a peint pendant longtemps le XVIIe siècle comme celui de l’entrée triomphale dans toutes les modernités (rationalisme philosophique, peinture réaliste flamande, individualisme religieux, théories du contrat politique, etc.). Mais on s’est aperçu que ça n’était pas si homogène. Bodin a certes écrit Les Six livres de la République, mais il a aussi écrit un traité de démonologie où il raconte comment une présence diabolique vient le tourmenter. Et Campanella croit autant en l’astrologie prophétique qu’en une Utopie à angles droits. Dans les sciences elles-mêmes, on voit perdurer des traditions hermétistes qui vont jouer un rôle dans la construction des sciences dites « modernes », tout comme les sentiments et les affects – le souci de la bonne réputation par exemple – ont une part dans l’essor des sciences expérimentales.
Le second point aveugle, plus spécifique, c’est que dans les années 1930, il y a certes un empirisme qui déferle sur la philosophie et les sciences naturelles britanniques, mais en France, ce qui débarque, c’est la phénoménologie allemande. Arrive une philosophie qui veut connaître « les choses mêmes », mais qui nous parle de tout sauf du réel concret : le Dasein qui ne se coupe pas les ongles, comme le dira de manière ironique Paul Veyne. Il faudra attendre Merleau-Ponty pour qu’une voix dissidente apparaisse dans cette tradition, une voix qui repart du principe que le monde existe en-dehors de nous, et que tout se joue dans l’attention qu’on lui porte ou qu’on ne lui porte pas. Il y a donc un écart vertigineux entre cette tradition franco-allemande et les philosophies britanniques de la même période, qui partent toujours de ce qui est, puis s’interrogent sur la façon dont ce donné nous devient intelligible. C’est une divergence historique assez coupable, dans le sens où elle nous a fait porter beaucoup d’inattention au monde, tout particulièrement à la question écologique. Catastrophe oblige, on assiste d’ailleurs, depuis une vingtaine d’années, à un effort, en France, pour sortir de cette tradition et renverser la tendance : on revient à Merleau-Ponty, on convoque Peirce et Dewey, on se tourne vers les empiristes de toutes obédiences… C’est le grand « retour au réel » invoqué par la littérature, mais malheureusement de façon bien trop tardive.
À l’inverse, vous écrivez par deux fois Vanessa Manceron que la pratique des naturalistes serait une manière de « politiser l’attention ». Pourriez-vous revenir sur cette expression ?
V.M. : L’expression fait de la figure du naturaliste amateur un sujet politique. Avec l’institutionnalisation de la biologie et de l’écologie à la fin du XIXe siècle, cette science des marges qu’est l’histoire naturelle a bénéficié d’une certaine liberté pour s’émanciper des formes d’objectivité rigides. En Angleterre, la médiation entre les laboratoires d’écologues et les naturalistes amateurs est assurée par des trusts. Ce sont des formes de gouvernance citoyenne, par le bas, selon lesquelles le bien commun revient aux individus et que ces derniers en sont responsables. Ce mélange d’éthique communautaire et de responsabilité individuelle est un credo anglais très fort. Très précocement, grâce aux trusts, cette éthique s’est portée sur la nature. Toutes sortes de taxons sont pris en charge par des collectifs. Il y a donc une dimension politique dans cette observation de la nature qui travaille la société anglaise depuis le début du XXe, avec des programmes participatifs mis en œuvre très tôt par rapport à la France où il a fallu attendre les années 1990. Aujourd’hui, les naturalistes amateurs continuent d’être des observateurs passionnés du vivant, mais, confrontés à une conscience aiguë de l’extinction des espèces, ce sont aussi des citoyens engagés. Je parle de « politisation de l’attention », car il ne s’agit pas d’une forme de militance classique. Ce ne sont pas des gens qui prennent la parole pour les plantes et les animaux mais qui agissent pour rendre visible la situation actuelle de ces plantes et de ces animaux. En Angleterre, des groupes se créent pour dire ce qu’il en est et relier les informations à l’échelle locale, régionale, nationale. Rendre les choses visibles est une véritable contribution citoyenne. C’est une manière de célébrer les vivants et leur droit à la vie. Par leur mode d’attention qui implique reconnaissance, respect, considération, ces personnes sont dans une forme très singulière d’engagement politique. À bas bruit, certes, de manière relativement silencieuse, que l’on n’entend pas dans les arènes de l’écologie politique, mais qui me semble extrêmement importante à considérer.

Cette politisation discrète paraît en décalage avec la recherche actuelle, dans les milieux écologistes, de pratiques qui pourraient offrir des prises efficaces dans les luttes en cours, pour contrer ou contenir l’érosion de la biodiversité.
V.M. : Les naturalistes parlent moins qu’ils n’agissent. Ils font de la politique en acte. Il s’agit, par la connaissance, de faire savoir, de témoigner, de veiller, de prendre soin. Les Naturalistes en lutte à Notre-Dame-des-Landes ont inventorié le site pour opposer des arguments forts à la destruction du territoire. Ils ont fait reconnaître l’existence des vivants et l’importance de considérer et respecter leur existence et leurs manières d’exister. Cette action qui s’appuie sur une citoyenneté éclairée est une contribution très importante à la prise en compte du vivant.
R.B. : Aussi, il n’y a pas eu en Grande-Bretagne l’immense échec de l’écologie politique comme en France. Dans les nouvelles générations du militantisme environnemental, on voit la mise à distance de cet échec. C’est un repoussoir : tout sauf le modèle Lalonde, tout sauf l’écologie comme un parti ordinaire, pris dans les jeux parlementaires.
V.M. : Je m’attendais à trouver un parti écologiste très fort en Grande-Bretagne, mais il n’en est rien, il n’y a pas de représentation politique instituée de l’écologie.
Pourtant un mouvement comme Extinction Rebellion est né en Angleterre. On aurait pu imaginer, peut-être naïvement, que des liens puissent facilement se tisser.
V.M. : Il n’y a pas de couleur politique aux pratiques naturalistes. Ça peut être saisi par l’écologie portée par des mouvements alternatifs : on le voit en France à Notre-Dame-des-Landes, mais aussi sur le Plateau de Millevaches, les pratiques naturalistes font partie des moyens à disposition pour repenser le lien au territoire, pour s’y ancrer et développer un mode relationnel au vivant à la fois sensible et politique. De plus en plus, les habitants de ces lieux d’expérimentation font venir des naturalistes amateurs ou le deviennent eux-mêmes. On peut dire que c’est une forme de militance incarnée : mais c’est sous forme d’inscription concrète dans les territoires pour transformer tous les modes de vie, les relations au vivant, les relations entre hommes et femmes… Tout y passe. Les pratiques naturalistes offrent de ce point de vue des prises extrêmement intéressantes. Mais à l’inverse, ces pratiques peuvent être saisies par des naturalistes anglais respectables qui ne vont certainement pas militer dans les rangs d’Extinction Rebellion. Pour autant, ils sont profondément affectés par l’érosion du vivant et sont animés d’une foi intense pour inverser le cours des choses. Ils ont dans l’idée qu’il faut protéger, non pas en béquillant la nature, mais en la laissant suivre ses propres logiques de survie. Ils sont de ceux qui pensent qu’il faut revitaliser les villes et les campagnes, les espaces artificialisés, et laisser le vivant se déployer et ceci de manière radicale. Si on laissait les villes et les campagnes se revégétaliser d’eux-mêmes, on obtiendrait des milieux beaucoup plus denses et diversifiés que ce que l’on imagine. C’est ce qui me plaît avec les pratiques naturalistes : beaucoup de gens différents peuvent s’en saisir. Ces savoirs et ces manières de se relier au vivant existent au sein de nos sociétés et pas seulement dans les sociétés des ailleurs ou dans les confins du sauvage, ils sont à portée de main.
R.B. : Là où je me retrouve dans la démarche de Vanessa, comme dans celle d’autres anthropologues qui réinvestissent une ethnologie de l’Europe, c’est qu’elle essaye de cerner des régimes de pratiques qui montrent qu’on fait de la politique autrement – à bas bruit, comme tu dis –, laquelle permet des tas de liaisons nouvelles entre les êtres, entre les causes. Ces situations ne sont pas réductibles à des catégorisations idéologiques faciles et rapides. Dès qu’on descend dans l’ordre du quotidien et de la pratique, on est dans la multiplicité, et c’est cette multiplicité qui permet ces prises. Ce que l’histoire peut ajouter, c’est l’écriture d’une histoire de l’Europe qui ne soit plus celle d’une identité enracinée dans une provenance. J’aime bien dire que ça a toujours été un peu flou. Ce que Vanessa documente dans le contemporain, on peut aussi le documenter dans le passé, y déceler une altérité interne à nous-mêmes. C’est très important aujourd’hui, parce que tous les discours conservateurs, ceux qui refusent de penser la sortie du modèle capitaliste, la crise écosystémique, le font toujours au nom d’un même argument : si on faisait les choses autrement, ça ne serait plus nous. Or ce « nous », seule raison refuge qui s’oppose aux changements que la catastrophe impose, est porté par un discours complètement faux. Nous avons aussi été autres : nous avons été analogistes, empiristes, mystiques, etc. La petite contribution des sciences humaines, c’est de le montrer en sapant l’illusion d’une identité au nom de laquelle on refuserait de changer. Il faut qu’on change, oui, et ça n’est pas grave : l’histoire montre que nous n’avons jamais cessé de changer, et l’ethnographie que nous avons des milliers d’alternatives à notre disposition.

V.M. : Je reviens sur la proposition de Descola : elle nous a tous mis au travail. C’est l’usage du naturalisme par un certain nombre de penseurs qui s’expriment sur la crise du vivant qui, selon moi, tend à invisibiliser les potentialités relationnelles qui existent au sein même de nos sociétés par le recours aux généralisations et aux catégories dualistes qui tendent à essentialiser les visions du monde et à en stigmatiser certaines tandis que d’autres enchantent. Que les anthropologues travaillent à révéler d’autres manières d’être au monde, cela fait partie de la contribution essentielle de notre discipline, mais il y a aussi une tendance contemporaine à penser qu’on ne pourrait sortir de la crise du vivant qu’en devenant nous-mêmes animistes ou allant chercher chez nous des survivances à revitaliser. Cette voie embrase l’imagination et ouvre des horizons intéressants, mais si cela se fait sur le dos du naturalisme devenu d’un bloc, la bête à abattre, c’est à mon avis passer à côté du fait que les visions du monde ne suffisent pas à faire obstacle aux logiques contemporaines du capitalisme. C’est aussi passer à côté du fait que les pratiques et les relations ne sont pas réductibles à des ontologies et peuvent même les contredire dans certains cas.
R.B. : On peut penser aussi au travail récent de Charles Stépanoff, qui, dans L’Animal et la mort, documente, au cœur de pratiques de chasse françaises contemporaines qui pourraient paraître la synecdoque d’une relation froide et destructrice au vivant, des comportements de ritualisation du rapport au monde animal. Certes, la ritualisation du rapport du chasseur au gibier n’est pas le tout de sa pratique, mais c’est là quand même. Il y a des choses qui ne rentrent pas dans les cases, et qui offrent des prises.
V.M. : Oui, même dans la prédation. Tous les ethnologues qui ont travaillé en Europe sur les pratiques de chasse l’ont observé depuis très longtemps. C’est cette complexité qui est intéressante. C’est dans ces interstices-là qu’il faut travailler. On a besoin de redescendre dans les pratiques pour voir toutes les potentialités relationnelles qu’on a à disposition. Le fait de voir la nature à distance, en dehors de soi, produit aussi des effets : ça permet de considérer le vivant pour ce qu’il a en propre, ce qui est beau et puissant. Au cœur de l’ontologie naturaliste, on rencontre des animalistes qui cherchent du même dans l’autre. On peut observer des conceptions analogistes comme dans la biodynamie, comme il peut y avoir des naturalistes amateurs qui, à l’inverse, vont le plus loin possible vers les altérités animales et végétales, pour essayer de les comprendre, sur la base d’un continuum du vivant très darwinien, qui n’exclut d’ailleurs pas, au moins pour les animaux, qu’il soit aussi question de comprendre leurs intentions et leurs émotions. Coexistent donc des schèmes relationnels très divers. Le naturalisme tel que le décrit Descola permet toutes ces choses-là.
Outre le partage d’un même objet, vos deux démarches présentent des échos très forts dans leur volonté de symétrie. Vanessa Manceron, vous parlez de « symétrie bancale » dans votre manière d’étudier les naturalistes amateurs et vous, Romain Bertrand, la symétrie est recherchée de façon plus générale dans votre travail d’historien.
R.B. : Ce qui m’a fait prendre conscience de la possible extension à l’histoire coloniale du principe de symétrie, que la sociologie des controverses scientifiques mobilisait beaucoup, ce sont les travaux de Bruno Latour. C’est de conversations avec lui qu’est issue, dans sa forme finale, L’Histoire à parts égales. C’est un ouvrage qui essaye de penser les premiers contacts entre Hollandais et Javanais, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, en suivant deux principes. Il s’agit d’une part d’accorder une égale dignité documentaire à l’ensemble des énoncés en présence, européens aussi bien que malais ou javanais, autrement dit de ne pas doter d’entrée de jeu la version européenne des faits d’un plus fort coefficient de vérité. Il s’agit d’autre part de redistribuer les effets d’étrangeté entre l’ensemble des acteurs en présence, de façon à montrer que, du point de vue qui est le nôtre aujourd’hui, un marchand hollandais n’est à l’époque pas moins bizarre qu’un aristocrate javanais. Les malentendus et les conflits entre Européens et Asiatiques ne sont pas d’abord « culturels » mais sociaux. Ce n’est pas un « clash de civilisations » mais un clash d’ethos : une rixe de styles d’existence entre des agents de contact appartenant à des groupes sociaux distincts, régis par des codes de conduite différents. Les marchands et les nobles ne se comprennent pas mieux à Bruxelles qu’à Banten (à Java). Ce qui, au fond, est étrange, ce n’est pas un lieu quel qu’il soit, mais un moment commun à tous les acteurs : cette surprenante fin du XVIe siècle où beaucoup de choses peinent à naître et plus encore à mourir. C’est un moment dont l’étude permet, pour citer Foucault, de « mettre en morceaux le jeu consolant des reconnaissances ». Quand on regarde cette époque, on ne s’y reconnaît pas – et pourtant, c’est bien « nous ».

Ces conversations avec Bruno Latour étaient du reste vives, et souvent critiques : il me reprochait de beaucoup oublier les « choses » – c’est pour ça que dans le livre, il y a un chapitre entier qui leur est consacré – et je lui rétorquais que dans sa symétrie, tout le monde parlait français. À l’époque, à part Sophie Houdart qui se projetait vers le Japon, cette sociologie restait très centrée sur l’Europe. En tout cas, pour moi, le principe de symétrie est essentiel ; il ordonne l’ensemble de mes travaux. Mais c’est pour une bonne raison : qu’il s’agisse des êtres naturels ou des humanités distantes, le nœud du problème est le même. Entre le début du XVIe et la fin du XVIIe siècle, il se passe quelque chose en Europe : une grande, une profonde transformation de notre rapport, non seulement au monde, mais aussi à nous-mêmes. Foucault le décrit à sa façon dans Les Mots et les choses, Michel de Certeau à la sienne dans La Fable mystique. Si l’Europe savante, l’Europe lettrée des clercs et des pouvoirs, construit, pour les mettre à distance, des altérités lointaines, elle ne peut écrire sa propre légende, celle de son entrée en « modernité », qu’à partir du moment où elle nie ses altérités intimes, où elle occulte sa part mystique et analogiste : elle est obligée d’oublier ce qu’elle a été, ou du moins de le dissimuler, pour instituer puis pour préserver sa grandeur, qui est une condescendance – un peu comme on cache dans les familles l’existence d’un aïeul excentrique pour « sauver les apparences ». Or, c’est l’opération inverse qui m’intéresse : restaurer le savoir de ce que l’Europe a aussi été, son étrangeté, tout ce que la légende dorée de la « modernité » européenne s’efforce de passer sous silence. Certeau disait que le propre du métier d’historien, c’est de « parler dans une parole venue d’ailleurs ». Et il n’était pas spécialiste des Andes ou de la Chine, mais des Jésuites français du XVIIe siècle : cet « ailleurs » est donc bien un « avant » dont il faut entreprendre l’exhumation.
V.M. : De la même manière, on peut dire que les naturalistes ont été marginalisés dans le parc amateur, qui délégitime ce type de savoirs. Quand on observe les naturalistes observer, on se rend rapidement compte qu’ils se situent dans ce que Bruno Latour appelle la voie moyenne. Ils obligent à penser qu’on n’a pas d’un côté un objet – une nature inerte – et de l’autre un sujet maître de toutes ses actions. Ils déplacent l’attention vers le « faire faire », vers ce qui fait agir. Les animaux et les végétaux ne sont pas des objets de connaissance passifs, leur mode d’existence et leur agentivité a des effets sur les pratiques d’observation et sur les observateurs eux-mêmes. De ce point de vue, on est dans une logique de symétrisation dont j’ai essayé de rendre compte. L’idée est aussi de sortir de la dépréciation de certains savoirs, les savoirs amateurs, de sortir de l’opposition entre experts et dilettantes, entre véritables scientifiques et scientifiques autodidactes du dimanche. Avec l’histoire naturelle, on a à faire à un véritable régime de connaissance que l’on peut reconnaître grâce à la symétrisation (même si celle-ci est bancale, c’est-à-dire pas parfaitement équitable et à part égale pour les autres vivants).
R.B. : On ne peut pas annihiler cette part de nous-mêmes. Si ça fait vraiment partie de nous, alors ça ressurgit inéluctablement. Mais par contre, on peut la parquer, la disqualifier, la reléguer aux marges du savoir au moyen de puissants dispositifs cognitifs, comme la distinction entre savoirs amateurs et savoirs professionnels, vernaculaires et scientifiques, profanes et académiques…
Vous avez étudié ces pratiques au passé et au présent. Quel est leur avenir ?
V.M. : Difficile de dire ce qu’il en sera dans l’avenir. Mais j’ai bon espoir dans la prise de conscience de l’importance de ces pratiques et savoirs qui apprennent à voir et à voir autrement, ainsi que dans la mobilisation citoyenne de nouveaux collectifs ou de collectifs qui se reconfigurent. Du moins je l’espère.
R. B.: Nous sommes un peu dans la situation de la Renaissance, quand on s’est dit que « l’avenir, c’est le passé », autrement dit le retour à l’Antiquité. Notre avenir, ça peut être le meilleur de notre passé : tous ses possibles oubliés, tout ce qui aurait pu nous maintenir à l’écoute du monde. Il n’est jamais trop tard pour se rappeler. Walter Benjamin écrivait : « faire œuvre d’historien ne signifie pas savoir “comment les choses se sont réellement passées” ; cela signifie s’emparer d’un souvenir tel qu’il surgit à l’instant du danger». Nous sommes en danger, à nous de bien choisir nos souvenirs.
Notes
- D’après l’anthropologue Philippe Descola, le « naturalisme » serait une manière de se relier au monde, propre à l’Europe occidentale moderne, reposant sur la séparation nette entre deux domaines de l’existence : l’Homme, défini par son intériorité psychique et ses différentes cultures, et la Nature, définie comme l’univers matériel (incluant un ensemble disparate de phénomènes tels que les lois de la physique, les animaux, les plantes, etc.).[↩]








