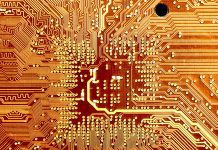Extraits choisis par Geneviève Azam à partir du livre d’Ariel Salleh, Pour une politique écoféministe. Comment réussir la révolution écologique, trad. July Robert, Marseille/Lorient, Wildproject/le passager clandestin, 2024.

Toutes les images sont extraites des archives du projet Greenham Women Everywhere, qui vise à « rassembler et préserver les récits de ces manifestations, en créant des archives, afin de maintenir en vie » l’expérience et la mémoire de la lutte des femmes de Greenham.
Ariel Salleh, chercheuse et activiste australienne a ajouté ses travaux à la riche lignée de celles qui ont éclairé les origines de la dévalorisation conjointe des femmes et de la nature. Presque trente ans après sa publication originale en 1997, nous pouvons enfin lire en français son ouvrage sur l’écoféminisme politique. À partir d’un « matérialisme incarné », au nom d’une « démocratie terrestre » et pour un éco-socialisme repensé dans une perspective féministe et décoloniale, cet ouvrage incisif est une pierre de plus dans la déconstruction du système « productif-reproductif » capitaliste et patriarcal. Vingt cinq après cette réflexion, une déconstruction à poursuivre et discuter encore1.
Parce qu’il vise un écosocialisme à la fois féministe et décolonial, ancré dans un nouveau champ bio-épistémique, ce livre est inévitablement transdisciplinaire. Son continuum de niveaux analytiques suit le flux des énergies qui passent de l’incarnation inconsciente à la subjectivité consciente, jusqu’à l’action individuelle, la structure de classe, les institutions économiques et l’hégémonie culturelle ; et il reparcourt ce flux à travers le sédiment discursif de la construction sociale. J’invite les lecteur·ices à voyager entre philosophie, économie politique, psychanalyse et biologie — chaque point de vue indiquant un ensemble de causalités actives dans la surdétermination de nos politiques. La lecture force l’accès vers de nouveaux concepts, en prévision de la disparition prématurée des concepts hégémoniques plus anciens. En basculant d’un cadre anthropocentré à un cadre écocentré, l’idée est aussi de dissoudre par là même ce vieux dualisme. L’interaction dialectique pourrait perturber les lecteur·ices qui s’attendent à une argumentation linéaire conventionnelle enfermée dans les paramètres d’une seule discipline. Mais les constructions intellectuelles sont toujours provisoires, d’autant plus lorsque l’on combine théorie et praxis.
[…]

Sortir de l’impasse dualiste
L’analyse politique écoféministe part du principe que la crise écologique est l’inéluctable conséquence d’une culture patriarcale capitaliste eurocentrée fondée sur la domination de la Nature et de la Femme « considérée comme nature ». Ou, pour inverser l’équation subliminale Homme/Femme=Nature, qu’elle est l’effet inéluctable d’une culture bâtie sur la domination des femmes et de la Nature « comme féminine ». Les féministes égalitaristes issues des traditions libérale et socialiste se méfient lorsqu’il s’agit de discuter du lien entre les femmes et la nature. Car c’est précisément ce truisme tendancieux qu’ont utilisé les hommes au fil des siècles pour maintenir les femmes à leur place, en les considérant comme « plus proches de la nature ». « Aucune différence entre les sexes », scandent ces féministes égalitaristes, guidées par Simone de Beauvoir. Elles craignent qu’attirer l’attention sur une quelconque différence de genre puisse faire le jeu des hommes et renforcer la tendance répressive habituelle. Dans ce contexte, les écologistes tels que Dobson ont bien raison de voir l’écoféminisme comme un débat au sein du féminisme.
L’écoféminisme interroge les fondements mêmes du féminisme traditionnel en pointant du doigt sa complicité avec la colonisation androcentrée occidentale du monde vivant par la raison instrumentale. Mais l’écoféminisme va bien plus loin que cela. Il s’oppose à plusieurs idéologies politiques autoproclamées radicales qui prétendent marquer « la fin de l’histoire2 ».
Parce qu’ils et elles refusent de se pencher sur la « différence » en tant que critique épistémologique, de nombreux·ses féministes, socialistes et écologistes perçoivent les femmes activistes écologistes comme enfermées dans une double contrainte dualiste sans issue. Dobson relate le dilemme ainsi : « soit les femmes se rangent du côté de la nature et risquent de renforcer leur propre subordination, soit elles cherchent la libération dans une approche déconnectée de la nature et abandonnent celle-ci à son sort de ressource3 ». Mais cette impasse souvent décrite est à coup sûr le produit d’habitudes de pensée unidimensionnelles.

Pour sortir de toute double contrainte, il faut recontextualiser ou reformuler le problème, en le considérant sérieusement de manière dialectique. C’est ce que signifie un changement de paradigme. On peut apaiser la tension contradictoire entre deux options fixes en montant en abstraction. C’est ce type de synthèse que propose l’écoféminisme. Il ne s’agit pas de dire que les femmes écoféministes doivent penser comme des philosophes. Au contraire, à voir l’histoire mondiale du mouvement, les femmes du Nord et du Sud ont tendance à parvenir assez spontanément à des intuitions écoféministes du fait des conditions dans lesquelles elles vivent et du travail physique qu’elles effectuent. Contrairement au sort réservé aux hommes, les activités laborieuses des femmes sont destinées à préserver la vie.
Les femmes ne sont en aucun cas ontologiquement « plus proches de la nature » comparées aux hommes. Les femmes comme les hommes sont « dans/avec/de la nature », mais pour accéder à l’identité masculine, les hommes doivent prendre leurs distances à l’égard de cet état de fait. Les écoféministes analysent les conséquences politiques de cette différence de genre culturellement construite. Valoriser le fait que les femmes se consacrent au soutien de la vie n’est pas un « retour à la nature » réactionnaire ; il s’agit plutôt, pour citer Hazel Henderson, de dire que « le maintien d’habitats confortables et de communautés soudées [est] le travail le plus productif de la société — et non le plus dévalué, comme le veulent les valeurs patriarcales et l’économie en vertu desquelles ces tâches ne sont pas prises en compte ni rémunérées4 ».
Lire aussi dans Terrestres : Émilie Hache, « Né·es de la Terre. Un nouveau mythe pour les terrestres », septembre 2020.
Extraire la rationalité et l’autonomie du vocabulaire de l’individualisme bourgeois pour les redéfinir dans un contexte de cultures terrestres et d’économies domestiques va dans le sens de la subsistance et du partage. Mais révéler la fragilité du développement des hautes technologies nécessite de parvenir à un équilibre entre les compétences masculines dominantes et les compétences « féminines » historiquement sous-estimées. Dans l’optique de ce changement, il est utile de se pencher sur l’explication de la puissance d’agir historique chez Marx.
« Il faut former une classe avec des chaînes radicales, une classe de la société bourgeoise qui ne soit pas une classe de la société bourgeoise, une classe qui soit la dissolution de toutes les classes, une sphère qui ait un caractère universel par ses souffrances universelles et ne revendique pas de droit particulier, parce qu’on ne lui a pas fait de tort particulier, mais un tort en soi, […] une sphère enfin qui ne puisse s’émanciper sans s’émanciper de toutes les autres sphères de la société5. »
Karl Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, 1844
Les femmes sont bel et bien radicalement enchaînées : le fait qu’elles soient exclues et malmenées par les institutions contrôlées par les hommes renforce leur confinement social dans une sphère reproductive sexualisée. Les femmes sont en fait une classe dans la société civile, et non pas de la société civile. Il a fallu attendre les années 1990 pour que toutes les femmes suisses aient enfin accès au droit de vote. Les activités et les connaissances réparatrices des femmes traversent toutes les classes — moyenne, ouvrière, paysanne — et pourraient de ce fait justifier la dissolution des vieux concepts industriels de classe. La souffrance des femmes est universelle parce que les torts qui leur sont causés et leur dénégation incessante alimentent la maltraitance psychosexuelle des Autres — personnes racisées, enfants, animaux, plantes, pierres, eau et air. Les écoféministes ne revendiquent rien pour elles-mêmes en particulier, mais ont une revendication globale. Lorsque les femmes pourront exprimer librement leur sensibilité relationnelle et que les hommes la réhabiliteront, les énergies de la Terre s’en trouveront libérées.
[…]

La puissance révolutionnaire de l’écoféminisme
Le mode de pensée unidimensionnel de certaines féministes de la première vague les a détournées de l’écoféminisme, qu’elles voyaient comme une simple prolongation du rôle de femme au foyer dans la sphère publique. Mais l’écoféminisme en tant que nouvelle politique était plus profond que ça. Si les femmes ont attiré l’attention sur la pollution, c’est aussi parce que nombre d’entre elles, humiliées par les aspirations patriarcales capitalistes, ont ressenti le besoin de purifier et reconstruire leur conscience d’elles-mêmes. La mise en relation constante du personnel et du politique, de l’intérieur et de l’extérieur, est une des caractéristiques du travail écologique des écoféministes. L’activité politique de ces femmes allait souvent de pair avec une attention portée à l’épanouissement psychologique, généralement au travers de séances de conscientisation au sein de groupes de soutien de re/sisters. Ce genre de stratégie révolutionnaire implique un profond engagement existentiel.
Il est évident qu’on ne peut faire le récit de l’engagement exceptionnel des femmes sans mentionner leur implication générale au sein des mouvements écologistes et pacifistes. Plus de la moitié des personnes qui prennent part à ces mouvements à travers le monde sont des femmes ; elles y jouent un rôle clé sur le plan organisationnel, si ce n’est en tant que leaders politiques. Ce qui est impressionnant, c’est que ces re/sisters aient été si nombreuses à estimer que cela ne suffisait pas. La mise sur pied d’associations séparatistes sous le nom de Women for Peace en Australie, en Suisse, en Allemagne de l’Ouest, en Italie, en France, en Norvège et, en 1980, en Grande-Bretagne en témoigne. Cette année-là, le collectif Women Opposed to Nuclear Technology (WONT) a organisé une conférence sur les femmes et la lutte antinucléaire à Nottingham, et deux organisations anglaises modérées, la National Assembly of Women et la Co-operative Women’s Guild, ont elles aussi rapidement commencé à se préoccuper de la question de la paix. En Argentine, les Mères de la place de Mai, dont les enfants ont « disparu » entre 1976 et 1983, se sont aussi illustrées autour de cet axe femme/paix6.
Aux États-Unis, les Women in Solar Energy (WISE) ont commencé à se réunir à Amherst, dans le Massachusetts, et en mars 1980, Ynestra King y a organisé la première conférence du mouvement Women and Life on Earth. En novembre 1980 s’est tenue une mobilisation contre la conscription à Washington : une foule forte de 2 000 femmes a marché sur la capitale états-unienne, encerclant symboliquement le Pentagone. Au même moment, Helen Caldicott, présidente des Physicians for Social Responsibility, a lancé le Women’s Party for Survival aux États-Unis, doté d’une cinquantaine de sections locales et nationales. Celui-ci s’est par la suite élargi pour devenir le Women’s Action for Nuclear Disarmament. Dans le même temps, de plus en plus de périodiques s’intéressaient à l’écologie — Valley Women’s Voice et Sojourner aux États-Unis, Women en Grande-Bretagne, l’hebdomadaire Des femmes en mouvements et un numéro spécial de la revue Sorcières sorti en 1980 en France. En Inde, le collectif Manushi publiait son influent article « Drought: “God-Sent” or “Man-Made” Disaster? » [Sécheresse : un désastre « envoyé par Dieu » ou « produit par l’homme7 » ?].
[…]

C’est cette année-là qu’a été fondé le nouveau réseau tiers-mondiste Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) à Bangalore, en Inde, et qu’un cours sur l’écoféminisme a été proposé à l’université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Au Botswana, les femmes ont créé une ONG connue sous le nom de Thusano Lefatsheng et ont bâti une ferme expérimentale dédiée à la culture de plantes de la savane considérées comme inférieures — telles que le fruit du marula, les tubercules et haricots marama, et la griffe du diable du Kalahari, aux vertus thérapeutiques. Ce travail alimente aujourd’hui un marché florissant. Pendant ce temps-là, les femmes namibiennes se sont opposées à la vente au rabais, par les entreprises, de médicaments périmés dans leurs communautés, ainsi qu’à l’usage subreptice du Depo Provera par le gouvernement sud-africain pour contrôler leur fertilité. En juillet 1985, la Conférence mondiale chargée d’examiner et d’évaluer les résultats de la Décennie des Nations unies pour la femme a suscité l’effervescence à Nairobi, au Kenya. C’est là que la Finlandaise Hilkka Pietilä a présenté son atelier révolutionnaire sur l’économie écoféministe, dont la thèse a été diffusée sous la forme d’une brochure intitulée « Tomorrow Begins Today » [Demain commence aujourd’hui]. Un manifeste des femmes philippines, émanant de la coalition GABRIELA, allait soutenir quelques mois plus tard que « les femmes savent tout de l’exploitation », parce qu’elles sont victimes des monopoles et de la publicité mensongère.
Tout au long des années 1980, les mères hispaniques de Los Angeles, rejointes par des mères noires et quelques mères blanches, se sont opposées sans relâche à un projet d’incinérateur à proximité de leurs maisons8. En 1986, l’accident du réacteur de Tchernobyl, en URSS, a alerté les femmes sur l’absence de responsabilisation tant au sein du capitalisme que du socialisme. En Allemagne et en Europe de l’Est, l’indignation s’est exprimée au travers d’une « grève des naissances », alors que les gouvernements, de la Turquie à la France, dissimulaient des données essentielles concernant les niveaux de radiation dans l’environnement, de crainte de nuire à leurs économies nationales. Au nord de la Scandinavie, le peuple sami a répondu aux mensonges officiels par sa ferme détermination en faveur des droits fonciers. De l’autre côté de la Terre, Joan Wingfield, de la tribu kokatha, a quitté le site de Maralinga, en Australie-Méridionale, où avaient été menés des essais nucléaires britanniques dans les années 1950, pour prendre la parole lors de la conférence de l’Agence internationale de l’énergie atomique à Vienne.
[…]

Contre la raison instrumentale
Ma propre perception écoféministe de la raison instrumentale s’est cristallisée lors de ma lecture de l’analyse néomarxiste de l’École de Francfort9. Max Horkheimer, Theodor Adorno et Herbert Marcuse étaient préoccupés par la « conquête intérieure perpétuelle des facultés inférieures » qui avait marqué la culture eurocentrée depuis la Grèce antique. Pour eux, l’image de la science des Lumières était celle d’une maîtrise de la nature désenchantée ouvrant la voie à une manipulation détachée et rationnelle de la matière. La révolution industrielle, en fournissant la machinerie sophistiquée destinée à exploiter les ressources naturelles et humaines, a rapidement propulsé ce rêve de domination effrontée sous la bannière du « développement ». Un ancien sociologue, Auguste Comte, traduisait l’hégémonie positiviste en « ingénierie sociale » ou « politique ». L’intellectuel non occidental Tariq Banuri allait la nommer « postulat d’impersonnalité du modernisme10 ».
Mais, comme l’a observé Marcuse, la rationalité fonctionnelle auto-aliénée de la science ne permettrait que de connaître un « monde mort », appréhendé comme un ensemble d’unités atomiques interchangeables à réduire et à réassembler selon la volonté humaine11. La forme idéale pour présenter cette connaissance était la formule algébrique neutre, étant donné qu’il s’agit d’une science pauvre, d’une illusion, de mensonges pour introduire des considérations de valeur dans la production de connaissances positives pures. Pour les physicien·nes, la matière se dissipait dans des rapports mathématiques et topographiques : elles et ils ont introduit un vocabulaire d’événements, de projections et de possibilités abstraites. Cette tendance méthodologique a impliqué une suspension de l’étude de la nature de la réalité, ou de « la réalité de la nature », pour la remplacer par une mise en valeur des opérations spécifiques à utiliser dans sa transformation. Ainsi, « l’homme techno-logique [devient] une mesure universelle de la valeur des classes, des cultures et des genres. Les modes de perception dominants qui reposent sur le réductionnisme, la dualité et la linéarité sont incompatibles avec l’égalité dans la diversité12 ». Difficile d’imaginer quelque chose de plus éloigné d’une sensibilité écologique.

On allait gérer les ressources genrées comme le reste de la nature physique — l’air, les cours d’eau, les minéraux et les forêts étant assimilés à des biens gratuits. C’est au 17e siècle que les discours européens sur les richesses produites, la nature et le travail ont commencé à distinctement prendre leur forme moderne. Le monde entier était offert en partage aux hommes, comme un don de la divine Providence13. Mais c’étaient les humains qui fabriquaient les richesses. Chaque homme, écrit Locke, « est propriétaire de sa propre personne », et donc « le travail physique de son corps et le travail de ses mains, pouvons-nous dire, lui appartiennent en propre ». Si, au sens providentiel du terme, la Nature est « la mère commune de tout », inversement, c’est au travers du travail qu’un individu s’approprie les fruits de la Nature ; « par-là, elle relève désormais de son droit privé14 ». Le travail était un monde d’hommes ; les labeurs reproductifs et domestiques des femmes étaient fournis gracieusement – 1/0. Malheureusement, Marx allait hériter de ces préjugés.
Du point de vue de Ruether, c’est au moment de l’avènement de la civilisation industrielle que la Sublimation eurocentrée du Principe maternel s’est accomplie.
« Le concept de “progrès” du 19e siècle a matérialisé le concept du Dieu judéo-chrétien. Les hommes, identifiant leurs egos à l’“esprit” transcendant, ont fait de la technologie le projet de l’incarnation progressive de l’“esprit” transcendant en “nature”. Le Dieu eschatologique est devenu un projet historique. Aujourd’hui, on tente de répondre à une demande infinie au travers d’un “progrès” matériel infini, en poussant la nature à aller de l’avant vers une expansion infinie de la puissance productrice15. »
Rosemary Ruether, New Woman, New Earth, 1975
Dans son texte, le terme « infini » réitère l’aveugle linéarité de l’instrumentalisme spéculaire. Cette sublimation a eu pour conséquence sociale l’accroissement de la marginalisation économique des femmes, au travers de la délocalisation de la production depuis l’industrie familiale vers des ateliers de production. Ce changement a aussi fait perdre aux femmes leur compagnonnage d’épouses au travail et leur autonomie en tant que copropriétaires de leurs moyens de production. Les hommes et les femmes ont été contraint·es de s’engager dans l’esclavage salarié au service d’un entrepreneur capitaliste. Dans la compétition autour des salaires qui s’en est suivie, la nouvelle confrérie des syndicats a repoussé les femmes vers leurs foyers. Au 20e siècle, on a fini par penser l’arène domestique « féminine » comme un simple lieu de consommation économique.
[…]

L’éthique de la précaution
Si la puissance d’agir masculine produit du savoir en séparant le·la sujet·te de l’objet, alors diviser l’objet en unités distinctes afin de le reconstituer – ce que l’on pourrait appeler une approche féminine ou communionnelle de la connaissance – exprime une sensibilité qui n’est pas étrangère à elle-même ou à son environnement. Reflétant le caractère fluide, dialectique, autonome et polyvalent des choses dans le monde, cette attitude porte en elle une épistémologie qui correspond bien à l’étude des écosystèmes. Susan Griffin nous le rappelle :
« Nous déclarons que l’on ne peut dévier la rivière de son lit. Nous affirmons que toute chose est mouvante et que nous faisons partie de ce mouvement. […] Nous disons que chaque acte finit par vous revenir. Il y a des conséquences. Il n’est pas possible d’abattre les arbres du flanc de la montagne sans qu’il y ait une inondation16. »
Susan Griffin, La Femme et la Nature, : le rugissement en son sein, 1978
La politique écoféministe s’enracine dans les compétences et la marginalisation économique des femmes, ainsi que dans la prise de conscience douloureuse de la non-identité que leur confère leur place dans le maillage nature-femme-travail17. Formulé sous la forme d’un matérialisme incarné, l’écoféminisme atteint le plus petit dénominateur commun de toutes les oppressions. À ce titre, il ouvre de nouvelles possibilités de dialogue entre les classes et les mouvements sociaux qui résistent au capital.
En raisonnant de manière dialectique, les écoféministes introduisent ainsi une autre ontologie dans le discours politique, qui met fin aux dualismes effarouchés de la subjectivité transcendante. Au mépris du canon eurocentré, les écoféministes avancent que :
- la nature et l’histoire forment une unité matérielle ;
- la nature, les femmes et les hommes sont à la fois des sujet·tes actif·ves et des objets passifs ;
- le métabolisme femme-nature détient la clé de la jouissance historique ;
- le travail reproductif modèle la soutenabilité.
En liant la perception et la motivation politiques à l’endurance, la phénoménologie de la déconstruction dont les femmes font l’expérience débouche sur une épistémologie matériellement ancrée. Préoccupé par l’égalité entre toutes les formes de vie, l’écoféminisme est un socialisme dans le sens le plus profond du terme. Mais nous pouvons noter que l’écoféminisme « spirituel » reflète les mêmes hypothèses ontologiques. Cette voix féminine devient encore plus pertinente pour l’écologie, dans la mesure où les hommes se mettent à respecter la nature elle-même comme une sujette ayant ses propres besoins. À la fois dominées et empuissantées, les femmes et les autres sujet·tes colonisé·es sont bien équipé·es, à ce stade, pour s’emparer de la défense de la vie. Une fois encore, il ne s’agit pas de soutenir, d’une façon essentialiste et naïve, que les femmes ou les personnes autochtones sont d’une manière ou d’une autre « plus proches de la nature ». Il s’agit plutôt de reconnaître une différence socialement construite et complexe, ainsi que sa puissance d’agir.

Car la tâche politique la plus urgente et la plus fondamentale est de démanteler les attitudes idéologiques qui ont détaché l’être humain de son sentiment d’appartenance à la nature ; et ceci ne peut se produire que si la nature n’est plus réifiée, réduite à un objet extérieur et indépendant. Les réifications de ce type sont endémiques au discours patriarcal capitaliste, à commencer par le·la sujet·te même de la droite bourgeoise qui est censé·e prendre part au processus démocratique avec une identité et un statut fixés. Le socialisme aussi a traditionnellement fait du prolétariat un agent historique en lui attribuant un caractère permanent. Mais les universaux ou les essences telles que l’Humanité, la Classe, la Femme, la Nature, sont des abstractions qui violentent celles et ceux qui vivent dans un régime de la contradiction. La conception écoféministe contre-culturelle de la subjectivité en tant que signification en devenir, se formant et se reformant de façon permanente en entrant en collision avec l’ensemble social, se fonde sur un matérialisme qui défie les limites de l’épistémologie bourgeoise. Face à ces notions théoriquement abrégées du sens commun patriarcal capitaliste, la conscience écoféministe est réflexivement décentrée. Contrairement au régime 1/0 qui est adapté aux profits à court terme, les vies des femmes au cœur du lien nature-femme-travail s’incarnent dans un contexte de préservation. Transcendant les limites du capital, mais aussi des idéologies socialistes, les expériences de travail des femmes abritent tant les « bases » d’une critique écopolitique que de véritables « modèles » de pratique soutenable :
« si l’expérience vécue des femmes […] était légitimée dans notre culture, cela pourrait apporter une base sociale “vivante” immédiate pour la conscience contre-culturelle que [les hommes radicaux] tentent de formuler sous la forme d’une construction éthique abstraite18 ».
[…]

La notion de « main-d’œuvre méta-industrielle » est un autre outil stratégique, pour aider à décloisonner des notions de classe jusqu’ici fermées. Les gens qui entretiennent le métabolisme humanité-nature ne constituent certainement pas une nouvelle classe, mais elles et ils n’ont jamais été honoré·es par les sociologues en tant que classe sociale jusqu’ici. Il existe évidemment des différences culturelles entre les travailleur·euses méta-industriel·les, mais d’un point de vue matériel, ces différences sont moins structurantes que la phénoménologie du travail incarné qu’elles et ils effectuent toutes et tous. Le travail non monétisé des méta-industriel·les tel·les que les femmes ou les paysan·nes ne permet pas seulement de répondre aux besoins de la vie quotidienne ; dans de nombreuses régions « en voie de développement », il soutient aussi l’infrastructure des marchés mondiaux. Je pense ici à la façon dont les paysan·nes contribuent à la protection de la biodiversité et à la qualité des sols, ainsi qu’à la gestion autochtone des bassins-versants.
Lire aussi dans Terrestres, Héloïse Prévost « Résister au Brésil : pas d’agroécologie sans féminisme », décembre 2023.
Le travail méta-industriel, qu’il s’agisse des tâches ménagères et de soin ou de l’agriculture biologique, fait appel à des principes appris sur le tas dans le monde matériel. Il génère une épistémologie vernaculaire qui transpose et reproduit les circuits thermodynamiques de la nature. Ce travail est axé sur les flux et évite l’entropie ; il est intergénérationnel et préventif ; sa seule rationalité se traduit par une capacité d’approvisionnement économique de façon à préserver la « valeur métabolique » ou l’intégrité écologique. Contrairement au mode de production capitaliste extractiviste qui sacrifie la valeur métabolique à la fabrication de marchandises rentables, les économies localement autosuffisantes répondent aux besoins humains sans externaliser les coûts sous la forme d’une dette écologique ou d’une dette incarnée19. L’apparente contradiction que vous relevez à propos des méta-industriel·les, qui sont à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du capitalisme, exprime simplement l’idéologie du dualisme humanité/nature. C’est-à-dire que ces travailleur·euses sont intégré·es au capitalisme en tant que ressources ouvrières et énergie naturelle, mais en sont exclu·es lorsqu’il s’agit de reconnaître leur humanité en leur accordant un salaire ou des droits citoyens. Le projet le plus urgent de la politique du 21e siècle est de réunir les mouvements sociaux pour proposer une voie soutenable en ce qui concerne la mondialisation, et à cet égard, il est essentiel que les voix de cette classe invisible soient entendues.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- C’est à un tel approfondissement que nous invitent d’ailleurs d’autres publications, celle d’Émilie Hache notamment, dans son dernier ouvrage, De la Génération. Enquête sur sa disparition et son remplacement par la production, La Découverte, 2024.[↩]
- Francis Fukuyama, La Fin de l’histoire et le dernier homme, Paris : Flammarion, 2018.[↩]
- Andrew Dobson, Green Political Thought, Londres: Unwin Hyman, 1990, p. 203.[↩]
- Hazel Henderson, « The Warp and the Weft: The Coming Synthesis of Eco-philosophy and Eco-feminism », dans L. Caldecott et S. Leland (dir.), Reclaim the Earth: Women Speak Out for Life on Earth, Londres : Women’s Press, 1983, p. 207.[↩]
- Karl Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, trad. J. Molitor, Paris : Allia, 2018, p. 35. Ce texte, paru pour la première fois en 1844 dans l’unique numéro des Annales franco-allemandes, est l’introduction d’une œuvre inachevée de Karl Marx. (NdT) [↩]
- Ariel K. Salleh, « The Big One in Britain », Chain Reaction, 1981, no 26 ; Jane Jaquette (dir.), The Women’s Movement in Latin America: Feminism and the Transition to Democracy, Londres : Unwin Hyman, 1989.[↩]
- Correspondance avec Helen Caldicott, 1982 ; Manushi Collective, « Drought: “God-Sent” or “Man-Made” Disaster? », Manushi, 1980, no 6.[↩]
- Hilkka Pietilä, « Tomorrow Begins Today », Nairobi : ICDA/ISIS Workshop Forum 85, 1986 ; Troth Wells et Foo Gaik Sim, Till They Have Faces: Women as Consumers, Rome : ISIS International, 1987 ; Mary Pardo, « Mexican American Women Grassroots Community Activists: “Mothers of East Los Angeles” », Frontiers : A Journal of Women Studies, 1990, vol. 11, no 1, p. 1-7.[↩]
- Voir K. (Ariel) Salleh, « Of Portnoy’s Complaint and Feminist Problematics », The Australian and New Zealand Journal of Sociology, art. cité, pour une lecture écoféministe de Max Horheimer et Theodor Adorno, Dialectique de la Raison, Paris : Gallimard, 1 989 (1944).[↩]
- Tariq Banuri, « Modernisation and Its Discontents », dans F. Apffel-Marglin et S. Marglin (dir.), Dominating Knowledge, Oxford : Clarendon, 1990.[↩]
- Herbert Marcuse, L’Homme unidimensionnel, trad. Monique Wittig, Paris : Seuil, 1970, p. 177. Cet aspect de la culture masculine porte sur ce que la théoriste de la différence Luce Irigaray appelle la « spécularité » : Luce Irigaray, Speculum, Paris : Éditions de Minuit, 1974.[↩]
- Vandana Shiva, Restons vivantes : femmes, écologie et lutte pour la survie, trad. Agnès El Kaïm, Paris : Rue de l’Échiquier, 2 022 (1998), p. 61 (ePub).[↩]
- Edgar Augustus Jerome Johnson, Predecessors of Adam Smith: The Growth of British Economic Thought, New York : Prentice-Hall, 1937, p. 139-140.[↩]
- John Locke, « An Essay Concerning the True Original Extent and End of Civil Government », dans Sir E. Barker (dir.), The Social Contract : Essays by Locke, Hume, Rousseau, New York : Oxford University Press, 1971. Voir particulièrement Partie V, paragraphes 25-51, p. 16-30. Les citations sont issues respectivement des p. 17 et 18 ; italique dans le texte original. Merci à Martin O’Connor d’avoir attiré mon attention sur ces textes.[↩]
- Rosemary Ruether, New Woman, New Earth, New York : Seabury Press, 1975, p. 194.[↩]
- Susan Griffin, La Femme et la Nature, : le rugissement en son sein, trad. Margot Lauwers, Paris : Le Pommier, 2021 (1978), p. 291-292.[↩]
- La thèse en faveur d’un matérialisme incarné est esquissée dans A. Salleh, « On the Dialectics of Signifying Practice », Thesis Eleven, art. cité. Cette approche présente des similarités et des différences avec l’épistémologie proposée par Sandra Harding : voir The Science Question in Feminism, Ithaca : Cornell University Press, 1986.[↩]
- Ariel Salleh, « Deeper than Deep Ecology », Environmental Ethic 1984, vol. 6, no 4, p. 339-345.[↩]
- Sur l’épistémologie du travail méta-industriel : Ariel Salleh, « Is Our Sustainability Science Racist? », programme Ockham’s Razor, ABC Radio National, 4 octobre 2009, www.abc.net.au[↩]