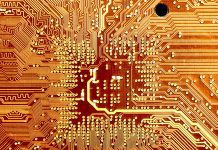1
C’est une nuit blanche, couleur brume et lune pleine, une nuit d’écume aux pieds des herbes.
De sous les ruines gisant dans la clairière, une créature s’extrait. Ses gestes sont lents. Elle s’éloigne, courbée, vers la rivière, pénètre les pluies d’arbres et entre dans l’eau. Du ciel, les dernières grues accompagnent ses contractions. Les eaux de la montagne courent jusqu’à sa taille. La fraîcheur réveille l’entre-vivant.
De sous les ruines sortent d’autres créatures que les crapauds nomment. Certaines ont déjà le rhombe prêt à chevaucher l’air. Une violente contraction expulse la nouvelle-née, un cri s’évade, effraie des frondaisons.
Subitement, l’obscurité domine : Grue, Crapauds, Effraie, Lune, Hulotte, Brume… tous se souviennent de l’avertissement du petit Hérisson :
« brûlures et hurlements
plaies et mondes agonisants
dès les premières tombes »
La peur règne dans les ventres, les mâles la chantent et la pleurent, tandis que les esprits se présentent devant les flammes du foyer. L’entre-vivant est ouvert. Quel ancêtre alimente la nuit ? Quels souvenirs nourrissent la nouvelle-née ? Les nuages sifflent sur les pierres des ruines et la matière gronde.
La femelle porte l’enfant contre sa poitrine. Les noix, nouées aux tailles et aux chevilles, s’entrechoquent. Des fémurs de juments peints de brou frappent les lithophones. Tous gueulent pour effrayer les démons de la démesure. Avant de traverser à nouveau la forêt, la femelle noue au cou de l’enfant une rondelle perforée sur laquelle elle a gravé le profil d’une génisse, bouche ouverte et tête levée vers le ciel d’un coté, et de l’autre bouche fermée et tête baissée. À naître une nuit de brume, la mère craint que sa nouvelle-née grandisse sous les signes de la boue et de l’orage, que son langage soit rêve et cauchemar, et son foyer forêt.
Quand la mère pose de nouveau son pied dans la prairie, une des anciennes s’approche et lui retire l’enfant. « Une enfant de la brume », le meuglement d’une génisse le confirme.
Les rhombes se taisent. Les danses cessent. Une mésange solitaire cri depuis sa branche, à rythme régulier, et son cri résonne entre les ruines tandis que le vent même s’est couché.
Sarya, la créature des gouffres, fait entendre ses pas, le tambour en main.
Les enfants se réfugient dans les caves mais, trop curieux, ils attendent et observent, excités et frissonnants de peur, à travers l’espace qui sépare la dalle de la terre. Les adultes sont accroupis en cercle, les mâles en son centre ; leurs talons ne doivent pas toucher le sol en cette nuit de naissance et ils ne doivent pas regarder Sarya, mais tous écartent discrètement les doigts posés sur leurs yeux. Quelque chose bouge dans les fougères, et entre le jeu incessant de la clarté lunaire et des ronces, un visage caché sous le bucrane d’une bisonne, une jambe, un bras couvert d’argile et strié de charbon. L’ancienne porte l’enfant jusqu’à Sarya et la nouvelle-née disparaît sous la gueule qui murmure son nom pour que les esprits ne l’entende pas avant qu’elle ne revienne nommer publiquement l’enfant, au moment où sa mère n’aura plus de lait. Des sons étranges sortent de sa bouche, elle cogne son tambour, le vent se lève et les femelles. Les mâles doivent être protégés des esprits qui rôdent et subvertissent les désirs. Les femelles ferment les yeux, tournent la tête, leurs cheveux mugissent, les yeux clos elles tapent des pieds, tournent autour des mâles, seule l’ancienne s’approche du foyer, l’enfant dans les bras. Les flammes s’activent, rugissent, grondent, flamboient sur la peau de l’enfant. La chaleur déverse la parole des ancêtres.
La créature des gouffres s’éloigne, jambes et bras écorchés par les ronces où son sang goutte et attire les esprits de la démesure. Elle court à présent sans cesser de cogner la peau de chèvre qui charme et emprisonne les ombres qui copulent. L’entre-vivant se referme, de nouveau apparaît la brume, les femelles cessent leur danse et posent leur main sur la tête des mâles, l’angoisse quitte le monde, un souffle d’émerveillement se répand. L’enfant cri, la faim exige sa tétée, la peau la chaleur de la chair.
2
C’est la saison du grand soleil. Les enfants jouent dans la rivière, peignent les galets, gravent les pierres des anciennes demeures.
C’est la saison du grand-soleil. Le ciel est limpide et les enfants pêchent les truites à la main sous l’ombre protectrice des chênes et noisetiers.
C’est la saison du grand soleil, mâles et femelles s’épouillent parmi les hautes herbes.
Sarya, vêtue des mêmes vieux tissus que les autres, est seule, sur l’autre rive, seule et silencieuse. Elle sourit aux jeux des enfants puis se lève et s’enfonce dans les ronces pour rejoindre le lieu de la paresse où écouter, regarder, somnoler, dormir transforme le corps en nappe phréatique ; à la fois léger et boueux, enraciné et ailé, il est alors pris dans les rets des picotements et vertiges. Il lui a suffit de déposer un matin une pierre rouge aux pieds de ses parents, pour quitter la vie du village, perdre son nom, grandir près des grottes et s’enrichir à l’enseignement de l’ancienne Sarya qu’elle remplace depuis peu à chaque naissance et à chaque mort.
Malgré l’ombre des sous-bois, la chaleur l’assomme jusqu’à l’emporter dans les tourbillons d’une mémoire enfouie sous l’écorce des vieux arbres, dans le cœur des roches et des avens. Ce que répètent souvent ces vieux témoins de la démesure c’est qu’il fut un temps où la saison du grand-soleil régnait toute l’année sur la terre et qu’elle manqua détruire toute vie. Des mâles, possédés par la peur, effrayés par le cycle des naissances et des morts voulurent y mettre fin et, pour y parvenir, ils n’hésitèrent pas, en usant de force et de duplicité à soumettre une majorité de ceux qu’ils nommèrent « animal », en premier lieu les petits et les femelles, puis s’emparèrent du corps du monde pour l’exploiter, le dépecer et le dévorer. La première stèle fut la première attaque contre le monde du vivant, et l’obsession du souvenir et de la permanence individuelle engendrèrent la réification de la planète, c’est pour se prévenir contre cette folie qu’il est dit à chaque décès : « Mieux vaut manger ses morts que les veilles, les sanglots et les stèles ».
La peur de ces créatures est très vite devenue haine, et la haine ne tue pas seulement l’amour, elle le remplace par un désir d’écrasement et de possession, et c’est ainsi que ce qu’ils ne pouvaient dresser ils l’empalaient. Ils tentèrent de changer la réalité matérielle du monde, prêt à vivre dans un bocal, mais vivre malgré tout, disaient-ils, comme si vivre était simplement manger, baiser et chier : ils mangeaient à outrance, baisaient violemment sans jamais s’arrêter et leurs excréments étaient aussi toxiques que leurs idées. Ils n’étaient plus apte à écouter, sentir, ou éprouver de la tendresse. Ils battirent leur puissance sur un culte de la lumière, enflèrent d’orgueil et d’arrogance jusqu’à imposer l’incandescence au jour et à la nuit, élevèrent des monuments à leur gloire, à coups de trique imposèrent une natalité outrancière, étouffèrent les saisons, brûlèrent la forêt, rasèrent les montagnes, asséchèrent les rivières, creusèrent des charniers. Tous les existants furent enchaînés, exploités, exterminés ; les astres et l’obscurité furent emportés dans la lumière assourdissante des machines. Les aliénés révèrent un univers sans limite, sans secrets, sans mystères, sans chair et s’unirent à la silice jusqu’à disparaître dans un cauchemar d’orgasmes électriques. Dans certains lieux, pourtant, et malgré les nombreuses attaques infligées par les aliénés, se défendirent, fusils et arcs à la main, des peuples qui comprenaient encore le langage des sources et des gouffres. Contre les invasions perpétuelles de ceux qui ne voulaient pas laisser vivre, ils parvinrent, à force de courage, de loyauté et de détermination, à sauver des lieux arrachés aux aliénés et à mettre fin à leur règne. Petits, faibles et meurtris, ces lieux retrouvèrent peu à peu leur force.
La buveuse d’ombres, celle qui enseigne que toute gloire, toute grandeur est ennemie de la liberté et de la vie, celle qu’ils nommaient « la mort » mais qui n’était autre que la « liberté » ou la « sauvagerie », la buveuse d’ombres, grande ennemie des aliénés, alliée indispensable pour défendre et multiplier les niches de résistance, s’épanouissait de nouveau dans chaque brin d’herbe et rien n’était plus fascinant et émouvant que ce palimpseste d’êtres. Comme le rappelle souvent les nouveaux peuples : « La préservation de l’obscur est essentielle pour entendre la vie qui bat dans et par-delà notre chair ».
La jeune Sarya s’éveille, la passion de son âme la mène vers l’obscur et ses créatures, ni mâles ni femelles, et la solitude est sa compagne la plus amère. Elle était pourtant une enfant comme les autres avant de le rencontrer. Ce jour-là, impatiente de revoir son amie, elle s’était éloignée du village pour aller jusqu’au campement des nomades et s’était perdue. Elle marcha longtemps, empruntant le chemin des sangliers, espérant qu’il la conduirait jusqu’à un point d’eau connu. Après plusieurs heures de marche et de peur elle s’assit sur un amas chaotique de pierres couvertes de mousse, entre les troncs hauts et puissants de chênes dont le feuillage murmurait des secrets. Elle posa sa tête sur ses genoux repliés, posa ses mains sur ses oreilles pour ne pas entendre le bruissement du vent, le chant de la grive musicienne, et lutter contre la vague d’ombres et de froid qui coulait en elle. Elle ouvrit les yeux au croassement d’un corbeau posée à quelques centimètres d’elle et qui l’observait, à la fois curieux et bienveillant. Une tendresse s’établit, instant fugace mais inoubliable, entre elle et lui et lorsqu’il prit son envol l’œil du corbeau resta gravé dans son cœur et sa pupille. La solitude ne fut jamais aussi puissante et insurmontable qu’à cet instant où l’oiseau s’éloigna sans se retourner, en croassant joyeusement, indifférent à celle qu’il laissait derrière lui. Elle entendit au loin son nom d’alors, c’était sa tante qui s’inquiétait et la cherchait. Il y avait peu de danger dans la forêt, mais il était possible de s’y perdre et de ne jamais retrouver le chemin du retour. Elle hésita à répondre, les yeux cherchant avidement l’oiseau noir, quand sa tante la trouva et la conduisit au village. Aucun ne remarqua le changement qui s’était opéré dans son cœur, aucun ne devina ce secret lourd et douloureux qu’il lui était impossible de partager sous peine de perdre toute mesure et raison. Elle luttait pour enfouir ces sentiments qui la fouettaient, la battaient, la projetaient au bord d’un précipice, elle luttait contre le vide immense qui tourbillonnait dans son corps, luttait pour se concentrer sur la moindre tâche, suivre une conversation, résister au désir de fuite, de silence et de solitude.
Elle ne parvenait plus à trouver sa place, ses proches lui étaient devenus étrangers, elle rêvait gouffres et ténèbres et c’est pour cela qu’elle décida un matin de rejoindre l’enseignement de Sarya. Elle devait apprendre à maîtriser l’amour qui la hantait et seul l’affrontement avec les forces de l’entre-vivant pouvait calmer ses embrasements.

3
Le jour de la danse des escargots est enfin arrivé. La pluie a emporté les derniers pas des morts de l’année. L’ancienne Caïa, morte dans son sommeil, qui aimait danser en imitant le cerf, fumer les feuilles de noisetiers et interrompre Beyi quand il rapportait les récits d’Airelle et Musaraigne entendu pendant ses collectes de noix ; le jeune Saline, si têtu et curieux, tombé dans un aven malgré les sages recommandations de son amie Volp ; l’ancien Aslan qui participa au maintien de la zone, borgne et boiteux et dont seul le rire des Lamiak calmait les rumeurs de la guerre qui l’obsédaient. À ces morts succéderaient des naissances, mais contrairement aux enfants des aliénés, les enfants des peuples nouveaux n’appartenaient à personne, ils bénéficiaient de l’affection de tous et partageaient les activités des adultes, au fur et à mesure que leur agilité et attention augmentaient.
C’est le jour où les escargots mangent la pierre, y sculptent un palimpseste de visages connus puis disparus, et leur grignotement est chant de gorge. Les « mangeurs de morts », comme les appelle les peuples voisins, s’apprêtent à oublier les noms, à les offrir à la buveuse d’ombres. Sarya est prête pour la cérémonie, elle récolte le cresson, revêt son costume, et rejoint les endeuillés à la clairière des ours. Ils chantent et dansent, les enfants courent et crient, tout un charivari pour encourager l’esprit des morts à quitter la clairière et entrer dans la forêt. Des nuages épais et sombres s’approchent, le vent se lève et la grêle tombe soudain mettant fin à la cérémonie dans les rires. À la grêle succède la pluie, temps idéal pour une danse des escargots et chacun de choisir entre le chant, la danse ou les peintures. Cette fois-ci Sarya danse.
C’est la nuit suivant le jour des geais qu’a lieu la grande fête des peuples où se rencontrent femelles et mâles. Ce jour-là est arrivé au village un être aux yeux noirs que Sarya ne connaissait pas. Sarya, silencieuse et cachée dans les ramures du chêne le regardait bouger, parler, sourire. Tous ses gestes déversaient l’ombre chaude des corbeaux. Il la vit sur sa branche et lui sourit, elle détourna les yeux, troublée et honteuse. Maladroit et timide, mais toujours fanfaron, il s’approcha de l’arbre où elle était « Pourquoi restes-tu là-haut ? », lui demanda-t-il. « Pour que tu puisses monter », osa-t-elle lui répondre. Il grimpa jusqu’à elle et ils se virent, comme il est parfois possible de voir l’âme du monde dans les trous souffleurs. Aucune communication n’est nécessaire, dans le désir ou la tendresse, mais ce qui se passait entre eux était bien plus lancinant qu’un désir des corps. Sarya savait qu’il partirait le lendemain rejoindre les siens et que tout serait vite oublié, elle n’était pas de celles qui marquaient les cœurs et comme souvent, lors de ces fêtes annuelles, beaucoup ont appris à éteindre le baiser trop intempestif du flambeau. Elle était de ceux qui gardent longtemps et profondément ancrée la brûlure des sentiments, et elle sentait qu’il s’accommoderait de la séparation comme le corbeau de son enfance s’en était accommodé. Existe-t-il vraiment une émotion plus forte que celle de marcher côte à côte sans rien dire de particulier, submergés par l’attraction des cœurs qui usent de la parole pour lutter contre les baïnes qui se forment à chaque frôlement des peaux ? Il partit le lendemain, sans se retourner, creusant un nouveau trou béant dans l’âme de Sarya.
Lamuel partit peu de temps après la fête pour vivre chez les Syrial, pasteurs nomades à l’autre bout des grandes plaines, il a tout quitté pour rejoindre Igbo. On raconte que là-bas, ils mangent beaucoup de viande, pas comme chez les Yijé, les « mangeurs de morts », où la nourriture végétale est abondante. Ils ne font pas non plus sécher la viande des morts pour la partager lors des cérémonies, mais ils gardent les crânes, après le passage des vautours, dans une maison qu’ils appellent ossuaire.
4
Les aliénés vivent encore, dit-on, ils sont peu nombreux, mais ils vivent de l’autre côté de l’Océan, dans un monolithe noir qu’ils ont dressé dans un désert de béton et de déchets, lieu maudit où les peuples nouveaux refusent de se rendre, où quelques exosquelettes alimentent encore la structure, dit-on, mais depuis quelques temps des grondements font trembler la terre. Sarya écoute le récit de Volp tout en sortant des éclats d’un galet de quartzite pour tailler des lanières de cuir et réparer ses chaussures. Les aliénés auraient-ils inventé une nouvelle arme ? S’inquiète-t-on dans les villages et campements. Certains racontent que le monolithe se couvre de couleurs et qu’il s’érode, que les exosquelettes sont tous malades et meurent les uns après les autres. Personne ne sait vraiment ce qu’il se passe sur l’île des aliénés mais ils restent tous vigilants, attentifs au moindre changement.
Sarya ne parvient pas à suivre la discussion, tout en frappant le galet de quartzite elle pense à Ankve et à Lamuel, Lamuel parti pour vivre avec Igbo, Ankve voyageant de peuple en peuple… le reverra-t-elle un jour ? Elle soupire, lève les yeux sur les enfants qui jouent au bord de la rivière, prête l’oreille au rythme irrégulier des chocs de la taille sur lequel chante le polissage des roches ; elle est née dans un des rares villages qui ne voulait pas du métal, inutile pour eux puisqu’ils ont tout à portée de main : l’eau de la montagne, les fruits de la forêt, le gibier et les pierres pour vivre simplement.
Elle est née dans ces ruines que longe une rivière bruyante et où de jeunes vipères ont été aperçues au matin, filant entre les jambes des baigneurs. Sarya sourit, elle doit partir chercher l’ocre pour la cérémonie du grand Hérisson, il lui faudra deux jours de marches avant d’atteindre Naùde, une marche longue et rude dans la montagne ; le premier soir elle partagera son repas avec les Hiwis qu’elle n’aime pas, ils sont violents et méprisent les femelles, reléguées au gynécée, elle dormira dans la maison des femmes et des enfants, dans la maison des dominés, comme elle hait cette façon qu’ont les mâles de regarder par dessus les femelles comme si elles n’existaient pas, mais elle ne peut se permettre d’entrer en conflit avec eux, son peuple ne le lui pardonnerait pas, à défaut elle s’amuse la nuit à tendre des pièges sur le chemin des hommes pour qu’ils tombent, se blessent, se ridiculisent, les femmes Hiwis sont complices et en rient discrètement, mieux vaut que les hommes ne les surprennent pas. Ils dorment et se battent, ne s’activent que pour faire leurs poteaux funéraires, c’est tout ce qu’ils savent faire, et pendant ce temps-là les femmes s’occupent de la nourriture, de la lessive, des enfants, de la basse cour. Elle aimerait tant qu’une d’entre elle fomente une révolte, mais les mythes des Hiwis ont été créés pour contrôler et gérer la domination d’un sexe sur l’autre, contrairement aux récits des Yijé qui refusent le culte des morts, l’important étant qu’ils nourrissent les rêves et non le politique.
À Naùde un palimpseste d’éclats et d’ocre recouvre le sol noirci à certains endroits par des foyers. Elle s’y rend à la saison la plus froide, elle y restera une nuit et redescendra le lendemain. Les vieux contes de sa grand-mère lui reviennent parfois au son d’un crépitement de flamme, elle l’entend avancer sur la terre froide comme un rire de louve. « Tout aurait pu mourir, même les roches », lui disait-elle souvent, « mais la buveuse d’ombres, celle qui se répand en coulée de calcite et de boue, celle qui avale et digère le temps, offre à ses alliés la force de l’émerveillement ». Sarya somnole devant les flammes, la première neige tombe silencieusement sur son bivouac de peau. Elle sursaute au reniflement de la grande ourse qui s’approche d’elle, descendue sur terre pour lui apporter la nouvelle : « L’île des aliénées se meurt, le staphychrome est leur cancer, mais il vous faudra détruire les mythes des Hiwis, certains portent en eux le germe de la haine ». Sarya s’endort, ses rêves sont bercés par les yeux d’Ankve, le reverra-t-elle ? Le monolithe s’effondre, la terre tremble à nouveau, le feu s’éteint et dans le froid d’une aube blanche elle redescend pour apporter la nouvelle et fomenter avec les femmes Hiwis la prochaine révolte.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !