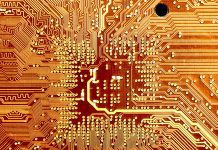A propos de Michael Löwy La révolution est le frein d’urgence. Essais sur Walter Benjamin (Éditions de l’éclat, 2019)
« Et quand il sut avec certitude que seuls les noyés pourraient le voir,
Il dit: Que tous les hommes soient des marins jusqu’à ce que la mer les libère.
Mais il fut lui-même brisé, bien avant que le ciel ne s’ouvre.
Abandonné, presque humain, il sombra comme une pierre sous votre sagesse ».
– Leonard Cohen, « Suzanne »
La révolution : passage et interruption.
Dans la préface qu’il a écrite pour son livre La révolution est le frein d’urgence. Essais sur Walter Benjamin, qui est un recueil d’articles s’échelonnant de 1995 à 2016 (et comportant un texte inédit), Michael Löwy fait de « l’idée de révolution » le « fil conducteur – au sens électrique du terme » des écrits de Walter Benjamin (p.8). Conducteur au sens « électrique », c’est-à-dire : permettant de passer – d’être conduit – d’un texte à un autre, et de communiquer à travers ces textes la même charge de pensée. La révolution, son idée tout du moins, devrait-elle être envisagée comme une forme de passage, de voie d’accès ? Explorons cette hypothèse.
Comme nous le dit Löwy, il est vrai que les textes de Benjamin – si on les compare entre eux, mais aussi bien pris un par un – sont hétéroclites. Ils sont comme soumis à des opérations littéraires de concentrations, de sédimentations soudaines et de sauts, d’aveuglantes clarifications. Le philosophe en exil, chassé par le nazisme, qui laissa en chantier un Livre des Passages (ouvrage mêlant citations et fragments d’analyse relatifs à la topologie fantasmatique, politique, économique de Paris au 19ème siècle) semble avoir écrit des textes qui à la fois nous permettent de passer – de l’histoire à la politique, de la politique à la théologie, de la théologie à littérature, de la littérature au jeu, du jeu à l’amour et au saut dans l’existence – tout en rendant ces passages escarpés, difficile d’accès, énigmatiques. Comme si Benjamin avait écrit ses textes de telle sorte que leur lecture puisse devenir une véritable expérience : non pas un « choc » (p.45) – c’est-à-dire ce qui au final toujours désensibilise, donnant lieu en contrecoup à des formes de défense psychologiques, des carapaces empêchant tout accès à une expérience nouvelle – mais la traversée de ce qui dans l’existence excède notre capacité interprétative, la rencontre avec l’extra-ordinaire. « Dans les domaines qui nous occupent », écrivait Benjamin,
« il n’y a de connaissance que fulgurante. Le texte est le tonnerre qui fait entendre son grondement longtemps après »1.

Si la révolution est passage, elle est passage fulgurant, renversant, un retournement fondamental. À ce sujet, notons que Benjamin usa de la métaphore de la révolution copernicienne pour parler de la manière dont le passé, loin d’être réductible à quelque objet saisissable, peut devenir une force de contestation faisant « irruption » au sein de notre présent2, le faisant sortir hors de ses gonds, hors des limites des demandes – sociales, financières, voire écologiques – qu’il accueille : n’est-il pas, en effet, problématique de croire que la révolution ne concerne que le présent ? Ceux qui se sont battus et ont péri, écrasés par les pouvoirs, doivent-ils être laissés pour compte, oubliés ? Notre survie organique est-elle plus importante que leur survie symbolique ? Ou bien la première doit-elle être le support de la seconde ?
En gardant ces questions à l’esprit avant d’y revenir à la fin de cet article, résumons ce que nous avons vu : la révolution est ce qui renverse, et interrompt ; mais cette interruption est une voie de passage. L’Ange de la révolution déblaye le terrain où se sont accumulés les décombres de nos révoltes inachevées. Dans le passage créé, reviennent vers nous les promesses du passé qui n’ont pas été assez bien tenues et auxquelles nous devons rendre justice.
Freiner ou accélérer ?
Essayons désormais de mieux comprendre ce qu’il en est de l’interruption révolutionnaire en tant que telle. Löwy nous dit que la « nouvelle définition » que Benjamin propose de la révolution fait de celle-ci un « frein d’urgence » (p.9). Voici le passage de Benjamin que cite Löwy pour étayer sa thèse :
« Marx avait dit que les révolutions sont la locomotive de l’histoire mondiale. Mais il se peut que les choses se présentent tout autrement. Il se peut que les révolutions soient l’acte, par l’humanité qui voyage dans ce train, de tirer les freins d’urgence » (p.53-54).
Benjamin nous demande de penser au plus loin de la mouvance contemporaine dite « accélérationniste » – ces penseuses et penseurs qui, sur la base d’une lecture amputée de Marx et Deleuze, croient qu’il faut battre le capitalisme sur son propre terrain en débridant les potentialités technologiques, qui soutiennent qu’il n’y a pas de nature, que les technologies ont par elles-mêmes des vertus émancipatrices, et qui en définitive en appellent à un Prométhéisme 2.03. Contre cette technophilie aveugle sur la technè, Benjamin nous dit qu’il ne faut pas accélérer, mais freiner en catastrophe – pour arrêter, interrompre le mouvement.
Quel mouvement ? Celui du capitalisme, auquel Löwy consacre le premier chapitre de son livre, en proposant une exégèse instruite d’un texte dense et difficile de Benjamin : « Le capitalisme comme religion ». Ce qui ne cesse pas dans le capitalisme, nous dit Benjamin via Löwy, c’est le désespoir, l’horreur, l’horreur d’un « culte » – terme central dans le texte de Benjamin – consacré à la mort incarnée sous la forme de l’argent, ou plutôt sous la forme du capital qui se reproduit au détriment de la reproduction de la vie, un culte qui conduit ceux qui sont dépourvu d’argent et de travail à se sentir « damnés » (p.20). Un « culte » rendu à ce qui nous nie : voici la religion du capitalisme, cette étrange pulsion de mort qui aurait remplacé la sublimation par la subjugation, et l’échange symbolique par l’extraction réelle.
Mais – réciproquement – la religion est devenue capitalisme, lorsque l’idée religieuse du Royaume à venir s’est transformée en celle de progrès indéfini. C’est ce mouvement du progrès qu’il s’agirait d’interrompre, le progrès que le capitalisme projette via la technologie qui a été – nous disait Marx dans Le Capital – « enrôlée » par le capitalisme et son servant étatique. Dans le second chapitre, qui est sous-titré « Walter Benjamin et Karl Marx », Löwy nous dit que Benjamin fût « le premier marxiste à avoir rompu radicalement avec l’idéologie du progrès » (p.35). Et cette rupture radicale avec l’idéologie du progrès, Löwy soutient qu’elle trouve sa source dans le romantisme de Benjamin (et pas dans son marxisme) – mais en quel sens nous faut-il entendre le terme de romantisme ?

Romantiser la vie
La critique de l’idée de progrès, écrit Löwy, caractérise l’héritage romantique de Benjamin, ce romantisme présent dans sa thèse de doctorat (p.60) et jusqu’à son étude du surréalisme publiée en 1929. Car le surréalisme doit être ompris comme reprise du romantisme. Par romantisme, Löwy écrit dans le cinquième chapitre consacré au rapport de Benjamin avec le surréalisme,
« je n’entends pas ici seulement une école littéraire du XIXe siècle, mais une vision du monde, une protestation culturelle contre le désenchantement capitaliste du monde, contre la civilisation bourgeoise moderne, au nom de valeurs pré́-capitalistes. D’une certaine façon, le romantisme peut être considéré́ comme une tentative, animée par l’énergie du désespoir et éclairée par le « soleil noir de la mélancolie » (Gérard de Nerval), de ré́-enchantement du monde, sous des formes religieuses ou profanes » (p.84).
Je ne puis à cette occasion que vivement conseiller la lecture des livres de Löwy et Sayre consacrés au romantisme, Révolte et Mélancolie : Le Romantisme à Contre-Courant de la Modernité (1992), ainsi que Esprits de Feu : Figures du Romantisme Anti-Capitaliste (2010). On y apprend que le romantisme ne peut se réduire à ses moments d’apparitions et de disparitions historiques, il est cette force « auto-critique de la modernité », autrement dit une force interne à la modernité, disent Löwy et Sayre pour couper court à l’argument selon lequel les romantiques seraient purement et simplement « ailleurs », hors du monde, passéistes et perdus dans leurs rêveries par trop solitaires4. J’aurais dès lors tendance à penser que le romantisme constitue bel et bien un ailleurs, mais interne : une puissance inachevée de disruption qui empêche le présent d’être plein, de se croire source (et non pas saisie) de lui-même, d’être seul lieu et temps d’existence (sans passé, sans fantômes du présent comme de l’avenir). En ce sens, le romantisme – entendu comme événement à la Badiou, autrement dit comme vérité arrachée au temps pour mieux le transfigurer en retour – est ce qui contrevient au rabattement de l’existence sur sa mécanisation, son aplatissement ontologique, sa réduction au statut d’objet et de valeur. Est romantique ce qui ne travaillera jamais.
Comment dès lors penser le rapport entre révolution et romantisme, en quoi ce rapport, tel qu’il est pensé par Löwy avec Benjamin, modifie le concept de révolution ? Ce qu’il nous faut comprendre est que le romantisme est l’interruption en tant que telle, ou que la révolution donne lieu au romantisme comme interruption. En ce sens, le mouvement des Gilets Jaunes aura été romantique au sens précis dégagé par Löwy : une protestation vive, menée avec l’énergie du désespoir, contre le désenchantement absolu engendré par le capitalisme, son ravage du tissu urbain et de la vie commune. Une fois diagnostiquée la critique aveugle des Gilets jaunes telle qu’elle a été établie par les Macronistes et autres libéraux-autoritaires (quand il ne s’est pas agi d’anciens de Mai 68 effrayés par un mouvement qu’ils n’étaient pas intellectuellement équipés pour comprendre), il me semble qu’on pourrait, sans volonté d’offense, ajouter ceci : transformer ce mouvement en surmoi de la pensée de la politique (vérifier que tout ce qui est dit, écrit, agi, confirme le « fait » Gilets Jaunes) ne ferait pas justice à ce que leur interruption du monde avait de romantique. Faire justice à la puissance de ce mouvement, comme à d’autres avant lui et après lui, c’est redonner lieu à ce qui en lui, et pendant même qu’il existe, n’est pas suffisamment exprimé. Romantique est ce qui défait tout soi-disant « fait » afin de libérer sa charge de justice, et de beauté. Ainsi seulement l’interruption peut être soulignée, agrandie, intensifiée, comme si le moment de l’interruption devenait infini ; ainsi, activer le frein d’urgence peut donner lieu à la concentration extraordinaire – en termes d’affect, de pensée, d’existence – du point exact où la locomotive va s’arrêter. Le romantisme commence à chaque fois que s’arrête la locomotive de l’histoire mondiale. Voilà peut-être une manière de s’approcher de ce que Benjamin nomme le « messianisme romantique » (p.60).
Messianisme et politique
Pour toute personne intéressée par la philosophie de Benjamin, l’un des points les plus délicats est de comprendre la relation que ce dernier a élaborée entre politique et religion, et plus précisément pour ce qui nous occupe : entre révolution et messianisme. L’un des grands mérites de l’exégèse proposée par Löwy est de montrer qu’il serait totalement erroné de cliver les deux, de les juxtaposer (p.69) : « matérialisme marxiste » et « dimension religieuse », révolution et messianisme, écrit Löwy, sont « deux manifestations d’une même pensée » (p.48).

Mais que faut-il entendre par théologie ? Elle est, nous dit Löwy, « mémoire des vaincus et espoir de rédemption », elle n’est donc pas « un but en soi, une contemplation mystique du divin : elle est au service de la lutte des opprimés » (p.49). Löwy développe d’ailleurs dans l’avant-dernier chapitre du livre, intitulé « Le point de vue des vaincus dans l’histoire de l’Amérique Latine. Réflexions méthodologiques à partir de Walter Benjamin », une analyse des travaux des « théologiens de la libération » latino-américains, afin de montrer par cet exemple contemporain la manière dont le religieux peut constituer (contre ce qu’on pourrait appeler le religieux majoritaire, qui se situe toujours du côté du pouvoir et des vainqueurs) une force émancipatrice – un ailleurs interne, un dehors en rupture du dedans. Car c’est bien « de manière occulte, à l’intérieur du matérialisme historique » (p.130) que le théologique peut fomenter son œuvre de contestation de ce monde-ci, c’est à l’intérieur et contre ce monde-ci que le messianisme prend sa fonction.
Messianisme en effet, plutôt que théologie ou religion. Car théologie, écrit Löwy, en fait « renvoie à deux concepts fondamentaux : la remémoration (Eingedanken), et la rédemption messianique (Erlösung) » (p.131). Donnons d’abord une définition générale de la remémoration pour Benjamin : être sujet au retour d’un événement du passé qui portait en lui une possibilité de bonheur insuffisamment vécue, et, au moment de ce retour, rendre justice à cette possibilité. Quelque chose a eu lieu, une expérience authentique, on pensera sur le plan individuel à un moment de jouissance esthétique, à une rencontre amoureuse ; mais précisément parce que cette expérience était authentique, et non pas seulement dérivée (reproduite), elle ne pouvait pas être pleinement vécue, ressentie et comprise selon sa modalité d’existence la plus haute, elle ne pouvait que donner lieu à la nécessité d’un retour. Quand – par hasard, de façon inaccessible à la volonté – le souvenir de l’expérience passée fuse dans le présent, ce dernier est l’occasion d’une rédemption, c’est-à-dire que le présent devient en mesure de donner accueil et présence à ce qui manquât d’être, le présent peut alors « sauver » le passé.
On voit que le théologique ne désigne pas une sphère divine en dehors du monde. Et c’est bien, comme l’écrit Löwy, d’une « auto-rédemption » (p.134) dont il s’agit, puisque le sauvetage du passé ne vient pas d’un dieu, elle vient d’une pensée et d’une praxis humaine. Reste à illustrer de façon plus concrète ce que cette remémoration, cette rédemption, peut signifier en termes politiques.
Communisme, anarchie et archaïque
Pour traduire la question de la remémoration et de la rédemption en termes politiques, je crois qu’on pourrait essayer de poser la correspondance suivante : remémoration communisme / rédemption anarchie.
Politiquement, ce dont il s’agit de se remémorer, c’est du communisme. « L’utopie révolutionnaire », écrit Löwy dans le chapitre 4, central à mes yeux, intitulé « Walter Benjamin et l’anarchisme »,
« passe par la redécouverte d’une expérience ancienne, archaïque, pré́-historique : le matriarcat (Bachofen), le communisme primitif, la communauté́ sans classes ni État, l’harmonie originaire avec la nature, le paradis perdu d’où̀ nous éloigne la tempête « progrès » » (p.78).
Ce que nous dit Löwy est fondamental. On pourrait en effet soutenir, au nom d’un geste déconstructif facile, ou d’un lacanisme mal compris, que le « communisme primitif » n’est qu’un fantasme, un effet rétroactif, une projection imaginaire dans le passé ; mais ce que nous dit Benjamin est bien plus intéressant : le communisme primitif n’est pas un fantasme, on peut l’attester historiquement et anthropologiquement, mais il n’est pas non plus un fait, il est ce dont nous devons nous emparer pour défaire ce qui empêche la libération de son existence ; il a eu lieu, mais de façon ontologiquement incomplète.
Mais comment faire droit à cette incomplétude ? C’est la fonction de l’anarchie, et Löwy insiste sur les
« affinités électives entre messianisme juif et anarchisme : le renversement des puissants de ce monde, la perspective restauratrice/ utopique, le changement radical plutôt que l’amélioration ou le « progrès », le catastrophisme » (p.71).
Löwy montre en effet que Benjamin avait une « conception extrêmement large de l’anarchisme » qui pouvait aussi bien concerner Dostoïevski que Rimbaud et Lautréamont (p.76). Alors, que veut dire anarchisme pour Benjamin ? Je crois que le terme est en rapport étroit – comme le chapitre 4 du livre de Löwy nous invite à le penser – avec l’archaïque. L’archaïque n’est pas le passé mais ce qui a manqué d’être dans le passé et ce qui demeure en souffrance d’être, en demande d’existence. On pourrait dire aussi : l’archaïque est l’absolu du passé qui cherche à se finir, d’où le messianisme, qui consiste à accomplir l’inaccompli. Mais alors, l’anarchisme serait l’expression de l’archaïque ; après tout, les deux termes sont en rapport avec le terme grec archè, signifiant à la fois principe (métaphysique) et commandement (politique). Ce qu’il y a d’explosif chez Ravachol comme chez Rimbaud est la violence de l’archaïque : la violence de ce qui n’a pas eu lieu assez. Et c’est peut-être ainsi qu’il faudrait comprendre, à l’occasion d’une manifestation, la dégradation de telle façade de banque, telle voiture qui flambe suite à un soulèvement populaire : ce qui est alors détruit, réduit à néant, est la seule manière que le néant d’être – ce qui n’a pas eu lieu assez – a d’exister. Ce qui est détruit est alors la rédemption du manque de communisme.
On voit donc comment peut s’opérer la « fusion » de « l’inclination anarchiste initiale » et du « communisme marxiste » (p.71), et donner lieu à cette position de « marxisme libertaire » que Löwy identifie chez Benjamin (p.65). Position difficile, « infiniment périlleuse entre la fronde anarchiste et la discipline révolutionnaire », comme l’écrit Benjamin (p.76). Car la révolution doit être à la fois organisée, liante et structurante, sans que cette organisation assourdisse la « fronde » anarchiste. Elle s’effectue à partir du présent, mais en se souvenant que son origine archaïque vient d’un passé qui ne s’est pas passé assez. Elle ne peut pas seulement accumuler des revendications, elle doit aussi faire place au manque d’archè, c’est-à-dire au manque de plénitude de l’avoir-eu-lieu. Son messianisme, c’est-à-dire son anarchisme et son archaïsme, est le rappel forcené que la politique ne peut se réduire à ce qui a lieu ici et maintenant qu’à se perdre.
Sans arche
Alors, quelle forme révolutionnaire serait pensable, souhaitable aujourd’hui, en lisant l’actualité mondiale avec les lunettes de Benjamin ? Le sous-titre du dernier chapitre du livre de Löwy est le suivant : « Actualité́ politico-écologique de Walter Benjamin ». Tout d’abord, rappelons à quel point Benjamin s’est opposé à toute lecture en termes de nécessité historique (p.52). Cela ne veut bien entendu pas dire qu’il ne faut pas admettre ce que les sciences de la Terre nous disent quant au destin apocalyptique affectant d’ores et déjà la biosphère, cela veut dire qu’on ne peut faire du destin du capitalocène un abri, une protection ontologique et psychologique. Une Arche. Politiquement, et éthiquement, on ne peut à partir des données produites au sujet de ce destin apocalyptique décider que le monde est condamné et qu’il faudrait donc s’en tenir à faire son examen spirituel, devenir bouddhiste, et organiser des micro-communautés de résistance agricole. Car une telle conception de l’histoire revient, en termes benjaminiens, à renforcer la perspective du temps « homogène et vide » qui est celle du progrès. Et en ce sens la perspective collapsologiste risque de se réduire à incarner le calque ontologique inversé de la vision temporelle associée à l’idée de progrès5.

Or le concept de révolution que nous avons tenté d’éclairer avec Löwy nous a aussi appris que ce qu’il s’agit de trouver est une forme de métabolisation entre passé et présent, archaïque et inédit, communisme et anarchisme, romantisme et organisation, action et rêve6 – entre, écrit Löwy, « l’ « ivresse » libertaire et la « sobriété » marxiste » (p.80). Ivresse, c’est-à-dire « raisonné dérèglement de tous les sens », pour employer les mots de Rimbaud. Car le risque de la pensée politique éclairée au soleil sombre de la fin du monde est de ne viser que la sobriété, le pas-trop – pas trop d’idées, pas trop de théories, pas trop de rêves, pas trop de hors-sol. Juste survivre, ici. Construisons des arches pour survivre. Calculons pour survivre. Mais pourquoi ? Survivre, pour quoi ? Pour survivre ? Pour maintenir en vie la créature passée maître en écocide, en torture, en mise en esclavage, en fascisme, en viol, en massacre d’animaux, en écrasement de penseurs comme Benjamin ? Il me semble préférable de proposer le bonheur et la justice, le communisme au centre d’anarchie, par différence d’avec le vœu de survie. « Plutôt la vie » (Breton). Mais n’est-ce pas déplacé, exagéré ? Sans aucun doute, extravagant même ; notons pourtant comment Benjamin achevait son ouvrage Sens unique : « L’être vivant ne surmonte le vertige de l’anéantissement que dans l’ivresse de la procréation »7.
Cette ivresse, que l’on peut nommer procréation, création, amour, liberté absolue, romantisme révolutionnaire, ne peut être obtenue si l’on cherche à construire une Arche, ou des Arches. Si la technologie doit elle aussi être repensée de fond en comble, ce n’est pas pour suivre les plans de géo-ingénierie, mais pas non plus seulement pour la reléguer à son usage territorial-local. Comme Löwy le rappelle, Benjamin dénonçait dès 1928, dans Sens Unique,
« l’idée de domination de la nature comme un discours « impérialiste » et propos[ait] une nouvelle conception de la technique comme « maîtrise des relations entre la nature et l’humanité » (p.151),
c’est-à-dire comme maîtrise des « forces sociales élémentaires », ainsi que Benjamin l’écrit ailleurs8. Laisser de côté la question technique, son rapport avec l’ensemble de la société et son ancrage planétaire en se suffisant du nécessaire et juste combat anti-industriel, autrement dit imaginer que des communautés autonomes survivraient à l’explosion des centrales nucléaires en cas de collapse intégral, à l’asphyxie des océans, et à la disparition des abeilles, est un luxe que la pensée écologiste ne peut se permettre. Pour faire de la place à la « fronde » anarchiste au cœur d’une pensée communiste, il me semble dès lors indispensable de se dispenser de toute idée d’arche, de toute idée directrice en termes de survie. Indispensable de se vivre en conséquence comme sans-arche, de savoir exprimer ce sans- dans le monde, la violence anarchiste étant la violence du sans-, telle qu’elle se rapporte à ce qui manque : à l’archaïcité du communisme.
Comète de sang froid
Il y aurait, bien sûr, à redire sur ce que Benjamin nous a légué en termes de diagnostic d’époque. Par exemple, critiquer l’idée de progrès n’est-il pas aujourd’hui un combat d’arrière-garde ? Qui croit encore au progrès, en tant que valeur partagée, fondatrice du social, idéologie de l’être-ensemble ? Les transhumanistes ? Mais leur croyance s’établit précisément contre toute idée de société, pour leur seul intérêt. Elon Musk, Jeff Bezos ? Là encore, il ne s’agit pas pour eux de vanter l’idée de progrès, mais d’un plan B pour survivre hors de la Terre. Monsanto, Bayer ? Allez sur leur site-web, vous verrez que le progrès n’y est pas pensé sans le paramètre du risque conjuré, de son caractère soutenable (sustainability) et des « menaces » sur l’environnement. Sur ce point, il nous faut écouter Brigitte Fontaine : « Les enfants ! Le 19ème siècle est terminé ! » (« Encore »). Enfin, il faudrait montrer dans une autre étude l’insistance d’une dimension cosmique dans la philosophie de Benjamin, ouvrant ainsi une possibilité pour attacher le messianisme à autre chose que le théologique. Mais, pour cette note de lecture, je crois plus utile de conclure ainsi : Walter Benjamin, écrit Löwy, est
« un personnage singulier, unique même, une comète en flammes qui traverse le firmament culturel du XXe siècle, avant de s’abîmer à Port-Bou, sur les rives de la mer Méditerranée » (p.10).
À l’heure où flambe l’Australie, la Californie, il faudrait peut-être parler d’une comète froide. Fusion des opposés, à la manière des surréalistes. Ivresse des idées, organisation calculée. Brûler tout en restant de glace face à l’abjection politique des temps. Voilà en quoi Benjamin nous parle encore, et voilà pourquoi on lui doit une révolution.
Notes
- Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle – Le livre des passages, Paris, Les Éditions du Cerf, 1989, p.473.[↩]
- Ibidem, p.405.[↩]
- Cf. Alex Williams et Nick Srnicek, « Manifeste accélérationniste », in Multitudes, n° 56; Laboria Cuboniks, « Xenofeminism : A Politics for Alienation Manifesto » (https://www.laboriacuboniks.net/); Robin Mackay et Armen Avanessian (sous la dir. de) #Accelerate : The Accelerationist Reader, Falmouth, Urbanomic, 2014[↩]
- M. Löwy et R. Sayre, Révolte et Mélancolie, Paris, Payot, 1992, p.35.[↩]
- Cf. Yves Citton et Jacopo Rasmi, « Le Plantationocène dans la perspective des undercommons » in Multitudes n°76, 2019, p.77, §3.[↩]
- Sur l’action comme sœur du rêve, cf. Löwy, La révolution est le frein d’urgence, p.155 (et cf. aussi le poème de Baudelaire auquel Benjamin, dans le texte que cite Löwy, se réfère, Le reniement de St Pierre : « – Certes, je sortirai, quant à moi, satisfait / D’un monde où l’action n’est pas la sœur du rêve ; / Puissé-je user du glaive et périr par le glaive ! » – ou Jésus anarchiste…).[↩]
- Walter Benjamin, Sens Unique, Petite Bibliothèque Payot, 2013, p.216.[↩]
- Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique » in Œuvres, III, Folio-essais – Gallimard, 2000, p.112.[↩]