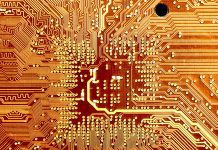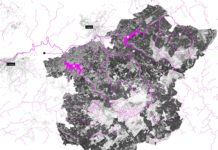Le Coronavirus pourrait ainsi jouer en Iran un rôle similaire à la catastrophe de Tchernobyl qui en 1986 révéla la faillite de l’URSS. Car cette épidémie frappe un pays déjà au bord du gouffre.
Michel Taubmann, Telos, 26-05-2020
Il est frappant qu’après près de trois mois d’une expérience, voire d‘une expérimentation, sans précédent depuis la seconde guerre mondiale, qui a conduit les autorités de différents pays à confiner plus de la moitié de la population mondiale, à engager les dettes de milliers de milliards de dollars (110 milliard d’euros rien que pour la France), à détruire une partie de l’économie mondiale, et à précipiter des dizaines de millions de personnes dans le chômage et la précarité1 et accessoirement subit une pandémie ayant tué à ce jour 390 000 personnes dans le monde, on s’autorise encore à parler de « crise sanitaire ». Vécue sur le mode de l’accident, c’est-à-dire d’un événement réparable, réversible et inscrit dans la continuité du temps de l’histoire, cette expérience sans précédent d’un point de vue politique, technique et anthropologique, nous précipite pourtant dans un monde nouveau, comme tous les événements majeurs qui ont cette capacité à transformer les choses, les rapports sociaux comme les rapports au monde, que l’on nomme catastrophe. Si cette question sémantique se pose, c’est peut-être que l’abîme qui sépare les causes et les conséquences, la crise sanitaire et la réponse politique (qui est également technique et économique), fait apparaître une forme d’incommensurabilité problématique sur laquelle nous souhaitons revenir.
Tout l’appareil gestionnaire, de nature technocratique2 et bureaucratique3, semble s’être afféré a vouloir gérer les risques, risques sanitaires, par la mise en œuvre d’une logistique destinée à combler le manque d’anticipation d’un événement largement prévisible, mais aussi risques sociaux en verrouillant l’espace politique de manière autoritaire à partir de la réduction des libertés fondamentales d’aller et venir, de s’associer et de travailler4. Mais l’expérience du monde vécu dans le confinement, de manière presque synchrone par la moitié de la population mondiale, ne peut être ressaisie ni comprise dans ce seul registre de l’opératoire. L’enfermement des nouveaux Robinson que nous sommes devenus, condamnés à réinventer un monde à partir du local (au propre et au figuré), nous conduirait plutôt à nous métamorphoser en cette créature que Franz Kafka avait, dans une nouvelle intitulée « Le terrier »5, enfermée dans un labyrinthe pour se protéger des menaces extérieures… qui deviendra bientôt sa sépulture. Le visionnaire écrivain tchèque avait entrevu le problème auquel nous sommes confrontés aujourd’hui et que nous pourrions résumer de la manière suivante, en renversant la célèbre formule du poète d’Hölderlin6 : le danger vient de ce qui sauve.
Du risque…
Au sens commun, la notion de risque a fait florès depuis l’émergence des crises environnementales des années quatre-vingt. Elle s’est tellement répandue, avec son corollaire la sacro-sainte sécurité, dans les usages sociaux (discours, catégorisations, dispositifs) que nous pourrions l’appréhender comme une nouvelle catégorie de perception du réel, une nouvelle catégorie esthétique. Le premier sociologue à instituer le risque comme déterminant des sociétés contemporaines, aussi nommées postindustrielles, fut le sociologue allemand Ulrich Beck dans l’ouvrage intitulé La Société du risque (1986) pour qui « la production sociale de richesses est systématiquement corrélée à la production sociale de risques » (p. 36)7. Michel Foucault et Paul Virilio l’avaient précédé, mais sans parvenir à montrer en quoi le risque pouvait être assimilé à un nouveau facteur de production au titre du capital immatériel (savoir-faire, organisation, esprit entreprise, le travail immatériel ou le savoir). Partons du constat que les risques sont désormais produits par la même société industrielle qui devait, via le progrès technique et le progrès social (Etat Providence), engendrer de nouveaux régimes de protection. Les risques sont également désormais collectifs et s’appliquent à des populations prises dans leur ensemble, voire à l’humanité entière dans le cas du COVID, du changement climatique ou de la bombe atomique. Enfin, les risques technologiques, ou plutôt les dangers, sont différés et donc pas immédiatement perceptibles par nos sens, ils sont donc, pour reprendre la formulation de Beck, des « passagers clandestins » de notre monde. Comme les radionucléides ou les pesticides, le coronavirus n’a ni couleur, ni odeur, ni saveur. L’impossibilité de sentir ces dangers et de les caractériser immédiatement leur confère enfin un caractère politique en ce qu’ils donnent lieu à des spéculations, des calculs, des scénarios portés par différentes parties prenantes de la société (GIEC vs climato-sceptiques) et appellent donc des formes de mise en débat qui dépassent le strict cadre de la science.
Il est indéniable que, depuis une trentaine d’années, le monde moderne connaît une résurgence et une prolifération de situations de crises liées aux questions de développement et d’innovations techniques (OGM, nanotechnologies) mais aussi aux effets induits par un certain nombre de pratiques dont les effets nous apparaissent parfois brutalement (accidents industriels massifs type AZF ou Lubrizol, marées noires) ou diffuses (problématique des perturbateurs endocrines, multiplication exponentielle des « maladies crées par l’homme » jusqu’à la résurgence des pandémies). Ce « revers du progrès » a imposé la nécessité de penser à nouveaux frais « ce qui arrive », selon la formule de Günther Anders et d’Hannah Arendt8, face au triple constat des limites : 1/ du système classique de prévention, 2/ des logiques d’indemnisation et 3/ de notre prétention à maitriser par la science et la technique les maux qu’elles ont engendrés. La nouveauté des catastrophes technologiques majeures, dont Tchernobyl (1986)9 marque à notre sens le tournant, repose sur l’incertitude de leur survenue et de leurs effets, les politiques étant désormais conduits à prendre des décisions en situation d’incertitude10, par exemple face à la crise de la vache folle ou aux épidémies telles que la « crise » du COVID 19 aujourd’hui.
Le risque comme rapport au monde spécifique
Le risque est inscrit dans l’imaginaire de la modernité, de la maîtrise, du calcul. Il renvoie à la démesure, l’hubris, c’est-à-dire de savoir comment aller toujours plus loin en gérant les risques. Risiko/risque, rappelons-le, désigne chez les Anciens l’écueil à éviter. Theodor Adorno et Max Horkheimer feront ainsi du marin mythologique, Ulysse, la figure-même de la rationalité 11. Il faut dire que le concept de risque tel que nous l’entendons est incompréhensible avant la modernité, quand seuls les Dieux (ou le Dieu) décidaient de « ce qui arrive » dans les sociétés traditionnelles, suivant une conception théologique et fataliste de l’existence. La transition apparut d’abord à la Renaissance avec le mythe de Faust (l’homme négocie son sort avec le diable et ouvre ainsi sur la perspective de maitriser son destin) puis avec les Lumières et le désastre de Lisbonne en 1755, où un effroyable tremblement de terre, entrainant incendie et raz-de-marée, provoqua une virulente polémique en Europe sur l’origine du mal. Les derniers partisans d’une rationalisation de l’existence d’une force divine (Leibniz, Voltaire) se heurtèrent au rationalisme montant (Rousseau) qui incriminait désormais l’homme dans sa responsabilité face à son malheur, dans le cas de Lisbonne, l’urbanisme. La science du danger était née.

Le discours du risque se situe donc résolument du côté de l’abstraction rationaliste, du côté de la pensée calculante qui appréhende le monde au travers d’une série d’artefacts mathématiques, mais qui fait du monde un non-monde, un monde abstrait dénué de toute sensibilité. Le risque se déploie dans l’univers des disques durs et du silicium, des algorithmes et des intelligences dites artificielles qui n’ont, suite à une malencontreuse traduction de l’anglais, rien de commun avec ce que nous appelons intelligence humaine, c’est-à-dire faculté de compréhension, d’entendement, mais aussi d’imagination et de création. La programmation de la vie a gagné toutes les dimensions de l’existence, l’économie, les échanges, la sexualité et la santé, les migrations, la vie privée comme la vie publique… toute la vie humaine, qu’elle soit individuelle ou sociale, est saisie par la puissance du calcul, modélisée, numérisée. La crise du COVID constitue de ce point de vue un « laboratoire » inespéré pour les promoteurs de technologies numériques qui ont, entre panique programmée et suspension de l’Etat de droit, gagné une dizaine d’années sur le plan de la numérisation de la société. La justice et la police n’échappent pas à ce phénomène de « maîtrise du risque totale » avec l’émergence de la police prédictive, comme il existe une santé prédictive qui pronostique le risque de développer telle pathologie selon l’analyse – numérique elle aussi – du génome. Là encore, la mise en œuvre des contre-mesures liées au coronavirus aura ouvert une porte technologique dont peu ont pris la mesure et qui pourrait changer nos vies assez radicalement : les deux géants de la téléphonie mobile (Apple et Google) ont déverrouillé leurs codes afin d’autoriser l’usage de la « sympathique » technologie bluetooth afin de permettre la production de données entre un téléphone et son environnement proche. Cette petite révolution, tout autant économique que technique, initialement destinée à permettre la traçabilité des porteurs du virus pourra servir à toute sorte d’usage utilisant ce protocole de communication puisque la porte est désormais, pour ainsi dire, ouverte à toute sorte d’applications. Le champ du risque, on le voit, a depuis longtemps quitté le seul domaine assurantiel et économique, où il s’est développé, pour produire une nouvelle forme de société, la société de contrôle12, mue par un nouvel imaginaire technique et politique.
Pour une éthique de la vulnérabilité
Nous voulons opposer au concept de risque calculable celui de vulnérabilité13 (la fragilité), concept éthique, qui accepte le travail du négatif dans la perspective de la disparition, de la perte. Venant du terme latin vulnus (la blessure), le vulnérable est celui « qui peut être blessé, frappé », « qui peut être facilement atteint, qui se défend mal ». Synonyme de « fragile » et à la fois « sensible », la vulnérabilité fait référence, comme l’a montré Hélène Thomas, à deux notions, d’un côté la zone sensible, fragile, par où arrivera l’atteinte, de l’autre la blessure, la perte14. C’est dans l’univers judéo-chrétien (jusqu’au XVIIIe siècle), que « le danger aurait été imputé aux dieux et à la nature, et la vulnérabilité perçue comme existentielle, biologique, propre de l’homme depuis la faute originelle – d’où un certain fatalisme. Ce n’est donc qu’avec la modernité (XIXe-XXe siècles) que « la vulnérabilité aurait inversement été perçue comme une question maîtrisable à traiter ; d’où l’édification de la protection sociale républicaine, le développement de la médecine, etc. »15. Or depuis la fin du XXe siècle, le sentiment de vulnérabilité ré-émerge, comme nous l’avions analysé dès 199816, dans l’émergence des crises sanitaires et environnementales et dans l’impossibilité de les maîtriser par le seul recours à la technique. Nous pourrions même, à l’instar de nombreux analystes qui ont commenté la « crise » du COVID, appréhender l’expérience humaine du coronavirus, et surtout celle de la réponse politique à la situation sanitaire, comme un puissant révélateur de nos propres vulnérabilités : impossibilité de maîtriser les flux, dépendance aux marchandises mondialisées, aux structures hospitalières sous-capacitaires, aux technologies numériques capricieuses, confrontation aux possibles effets de l’action humaine sur la nature17, mais aussi fragilité du processus démocratique face aux logiques autoritaires de gestion des risques via l’Etat d’urgence sanitaire17.
Le concept de vulnérabilité est, par nature, éthique. Il se situe du côté de la limite, il appelle au sens de la mesure, à la prudence, la précaution (au care, au prendre soin). C’est sur cette base que repose la réflexion de Hans Jonas dans Le Principe responsabilité. Il faut, écrit-il, partir de nos peurs, de nos craintes, pour savoir ce à quoi nous tenons vraiment. Fonder une nouvelle éthique pour les sociétés technoscientifiques, les sociétés de la démesure, suppose précisément de faire retour sur l’expérience du monde vécu, le sensible. L’analyse se situe non plus du côté de la raison calculante, de la rationalité instrumentale comme dans l’analyse des risques calculables, mais dans l’espace du sentiment, du sentiment rationnel qui fonde une grande partie de notre éthique. Sommes-nous affectés par la disparition des espèces vivantes de la surface de la Terre ? Sommes-nous indignés par les écarts croissants dans la répartition des ressources et des richesses ? Seule une phénoménologie de la vulnérabilité, de la détresse de l’autre et de soi, tracera le chemin d’une éthique collective qui nous permette d’appréhender ce que nous faisons. Sommes-nous, finalement, affectés par les 28 000 victimes du Covid en France dans un monde où meurent chaque année plus de trois millions d’enfants de malnutrition ? Sommes-nous capables de comprendre ces données comme étant le dessin du monde dans lequel nous vivons ? Certainement pas. On prête à Staline cette citation : « un mort, c’est une tragédie, un million, c’est une statistique ». D’ailleurs la question n’est plus de savoir ce qui pourra être fait par et pour la technique afin de gérer les contradictions du développement – c’est grosso modo le projet du « développement durable » – que de mesurer ce qui nous semble acceptable et ce qui ne l’est pas, ce qui est « authentiquement humain » comme l’écrivait Husserl. Mourir d’un virus comparable au virus grippal n’est peut-être pas si insoutenable… à moins que l’idée de la mort nous soit tout simplement devenue étrangère.
Nous aboutissons, en distinguant le risque de la vulnérabilité, à deux systèmes de pensée que nous pourrions schématiquement résumer dans le tableau suivant :
| RISQUE | abstraction | calcul | maîtrise | ubris/action |
| VULNERABILITE | monde vécu | expérience sensible | éthique (précaution) | phronesis (renoncement à agir) |
Penser avec la catastrophe
Le rétablissement du paradigme de la catastrophe (en grec, « renversement » et « chute », mot qui désigne le dernier acte de la tragédie, le moment du retournement de situation), contre celui du risque calculable, a donné lieu à une littérature abondante et stimulante. Citons les travaux du philosophe et polytechnicien Jean-Pierre Dupuy18, lequel, inspiré de Hans Jonas et de Günther Anders, considère que ni notre action ni notre imagination ne sont à la hauteur de ce que nous savons (sur la prolifération nucléaire, l’effondrement de la biodiversité, le changement climatique…). S‘il existe sur tous ces maux une littérature scientifique précise, alors comment expliquer notre inaction? C’est d’ailleurs une question à laquelle devront aussi répondre ceux qui ont, durant deux mois, ignoré les alertes lancées par les experts au sujet de la situation en Chine. Ce n’est donc pas, pour le père du catastrophisme, contrairement à ce que prône le principe de précaution, l’incertitude qui est la cause de notre inhibition. Le problème est, toujours pour Dupuy, que « nous ne croyons pas ce que nous savons »19. Or, si l’on veut éviter les désastres, il faut croire en leur possibilité avant qu’ils ne se produisent, la catastrophe ayant tendance à devenir « possible » (et l’ayant toujours été) à partir du moment où elle a eu lieu. La proposition faite par Dupuy s’inscrit, nous le voyons, dans la redéfinition métaphysique de la question du temps, en essayant d’inscrire la catastrophe ontologiquement dans l’avenir, et donc sur un modèle totalement différent du risque qui construit l’événement comme une occurrence parmi d’autres, pouvant ou non avoir lieu. Nous devons sortir du paradigme de la prévention (faire qu’un possible ne se réalise pas) en abandonnant ce que l’auteur nomme le « temps de l’histoire » (communément représenté par un arbre de décisions) pour adopter ce qu’il nomme le « temps du projet ». Cette nouvelle temporalité boucle de manière rétroactive passé et futur de telle sorte que l’avenir et le passé se déterminent réciproquement. Concrètement, il s’agit de considérer l’avenir dont on ne veut pas (la catastrophe) comme certain, comme un point fixe, un destin… pour pouvoir s’en détourner. Si les autorités des différents pays avaient adopté cette posture en écoutant les lanceurs d’alertes ou les nouveaux Cassandres que sont devenus les scientifiques20, point n’aurait été besoin de confiner la moitié de l’humanité… avec les conséquences humaines dont il faudra bien faire l’inventaire.
La deuxième raison qui nous conduit à réintroduire ce mot dans le lexique de l’expérience humaine du COVID19, comme nous l’avons tenté avec la catastrophe de Tchernobyl21), tient au fait que le monde dans lequel nous nous sommes réveillés le 17 mars, jour de la suppression de la liberté de mouvement en France, ne sera plus jamais le même. Le propre de la catastrophé est d’instituer un imaginaire nouveau (celui de la pandémie), de nouvelles peurs (l’autre comme vecteur de contamination, que l’on connaissait avec le sida), de nouvelles manières d’être (les gestes barrières, la « distanciation sociale »), de travailler (télétravail, télé-enseignement), de se déplacer, de se vêtir (la parade des masques) et surtout de nouvelles technologies (tracking, big data, usage des drônes) qui vont durablement transformer le monde dans lequel nous vivons, jusqu’à la problématique question de la démocratie : de la lutte contre le terrorisme des années quatre-vingt-dix à la « guerre »22 qui nous oppose au virus, la mobilisation totale des moyens de sécurisation du territoire – et surtout des enjeux économiques – s’accompagne systémiquement d’un déclin de l’Etat de droit. Tant que l’on situera la question – tronquée – dans le domaine du risque, le dilemme de la sécurité et de la liberté fera immanquablement pencher la balance du côté de la sécurité, et ce quel que soit le type de société envisagé, de la Chine despotique et holiste aux sociétés libérales et individualistes. Penser avec la catastrophe, c’est revenir à l’éthique de la vulnérabilité, à la question du sens et, surtout, de ce qui est acceptable et de ce qui ne l’est pas. Est-on en droit de dire, avec Comte-Sponville « J’aime mieux attraper le Covid-19 dans un pays libre qu’y échapper dans un État totalitaire »23) ? La seule question qui vaille n’est pas tant de savoir quand ni comment nous allons mourir, chacun d’entre nous, bien que le catastrophisme éclairé puisse parfois nous aider à en retarder l’échéance à la fois individuelle et collective, que de savoir dans quel monde nous voulons vivre. La catastrophe apparaît ainsi comme le concept qui permet de signifier ces états du monde et d’en mesurer les étapes dans un changement, un « renversement » ou un bouleversement, permanents. De la « crise » du COVID, qui n’est que celle, révélée, de nos propres formes d’organisations sociales, économiques et politiques, sortiront d’heureuses et de moins bonnes nouvelles. Installation durable des technologies de contrôles anticipées par Gilles Deleuze24, redécouverte des vertus du local (AMAP) et des moyens de transports conviviaux (bicyclette), bonheurs et malheurs du télétravail, ennui carcéral du confinement ou temps retrouvé en famille,… La jarre de Pandore du coronavirus nous posera durablement des questions auxquelles nous devrons répondre, comme l’ont expérimenté les Tchernobyliens avant nous qui ont dû, eux aussi, apprendre à vivre en zone contaminée25).
La majorité d’entre eux a choisi d’ignorer la radioactivité contre laquelle ils ne pouvaient rien et de vivre comme avant, en sachant que rien ne serait plus comme avant.
Frédérick Lemarchand, Professeur de sociologie à l’Université Caen Normandie, Codirecteur du CERREV (Centre de recherche sur les vulnérabilités)
Notes
- https://www.lefigaro.fr/social/coronavirus-1-25-milliard-de-travailleurs-courent-un-risque-de-licenciement-ou-de-reduction-de-salaire-selon-l-oit-20200407[↩]
- Juan S., La technocratie en France: une nouvelle classe dirigeante?, Ed. du bord de l’eau, 2015.[↩]
- Graeber D., Bureaucratie, Paris, LLL, 2015.[↩]
- Le journaliste Jean Quatremère analyse finement ce processus dans « Confinement : le débat interdit », Libération, Coulisses de Bruxelles, 30 avril 2020 (en ligne).[↩]
- Écrite à Berlin pendant l’hiver 1923-1924 et publiée dans La métamorphose.[↩]
- « Là où croît le péril croît aussi ce qui sauve »[↩]
- Beck U., La société du risque, Paris, Aubier, 2001 [1986][↩]
- Arendt H., Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1961.[↩]
- Ackerman, Grandazzi, Lemarchand, Les silences de Tchernobyl, Paris, Autrement, 2006.[↩]
- Barthe Y. et alii, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique. Paris, Seuil, 2001.[↩]
- Adorno, T., Horkheimer M., La dialectique de la raison, chapitre premier.[↩]
- Deleuze, G., Post-scriptum aux sociétés de contrôle, in L’autre journal, n° l, mai 1990.[↩]
- Notamment au sein du Centre de recherche sur les risques et les vulnérabilités (CERREV) de l’Université de Caen.[↩]
- Thomas Hélène, Les vulnérables, Paris, Éditions du Croquant, 2010.[↩]
- Axelle Brodiez-Dolino, « Le concept de vulnérabilité », La Vie des idées , 11 février 2016.[↩]
- Technosciences, risques et vulnérabilité. Revue Mana n°4 (Dir F. Lemarchand), Presses universitaires de Caen. 1998.[↩]
- Frédéric Keck : “Nous n’avons pas l’imaginaire pour comprendre ce qui nous arrive”, in Philosophie magazine, mars 2020.[↩][↩]
- Dupuy Jean-Pierre, Pour un catastrophisme éclairé, Paris, Le Seuil, 2002.[↩]
- Anders G., L’Obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle [1956], Paris, EDN, 2002.[↩]
- Le risque de pandémie était prévu.[↩]
- Lemarchand F., « Fukushima, l’autre Tchernobyl », Le Monde, 18 avril 2011 (https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/04/18/fukushima-l-autre-tchernobyl_1509365_3232.html[↩]
- B. Bensaude-Vincent, « Guerre et paix avec le virus », Terrestres, 30 avril 2020.[↩]
- Comte-Sponville A., « J’aime mieux attraper le Covid-19 dans un pays libre qu’y échapper dans un État totalitaire », L’Echo.be (27 avril 2020[↩]
- Deleuze G., Post-scriptum aux société de contrôle, L’Autre Journal, 1990.[↩]
- Ackerman G. et Lemarchand F., « De Tchernobyl au Covid : une pédagogie des catastrophes », in Le Grand Continent, 14 mai 2020. (https://legrandcontinent.eu/fr/2020/05/14/tchernobyl-covid-19-pedagogie-des-catastrophes/[↩]