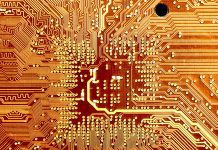Il y a près de trois ans, du 20 au 22 septembre 2019, dans la campagne de Bure, petit village de l’Est de la France, résonnaient des chants et des cris d’un cortège extraordinaire. Trois cents MINT1 défiaient la lourde présence policière et répressive pour défendre, depuis une posture féministe, ce territoire menacé par un projet d’enfouissement massif de déchets nucléaires. Une longue histoire qui se résume ainsi : vingt ans d’implantation par l’Andra – l’agence nationale dédiée à ces questions – et au moins autant d’années d’opposition de la part d’habitant·es et de militant·es de tous horizons.
Il y a près de trois ans, rassemblé·es entre autres sous le nom des « Bombes Atomiques », nous ajoutions nos voix à cette lutte avec la volonté de mettre en avant les liens entre une industrie mortifère et le système patriarcal. En tissant ce lien, nous nous inscrivions dans le sillage de luttes féministes et écologistes peu connues, et que nous avions (re)découvertes et partagées pendant près d’un an avant ce week-end. C’est en effet à l’hiver 2018, au seuil de l’année 2019, que l’idée du rassemblement commence son chemin. Tout juste installée à Paris à l’époque, j’assiste à un séminaire où, face à un public qui déborde de la salle, trois intervenantes décortiquent les rouages du féminisme anti-nucléaire, dont l’objectif est de montrer que les systèmes de domination – patriarcat et capitalisme, principalement – sont imbriqués et ne peuvent être détruits qu’ensemble. « Le nucléaire est un monstre du patriarcat »2 aura pu dire l’un·e de nous. Autrement dit, c’est cette culture et sa vision du monde rationnelle et abstraite, désincarnée, qui favorise de tels projets au mépris de ses impacts sociaux et environnementaux. À Plogoff, à Greenham Common, à Fessenheim, à Three Mile Island ou à Fukushima, des femmes* se sont ainsi organisées à travers les époques et les pays contre les ravages du nucléaire et contre l’ordre du monde militariste qui les a permis. Les traces de leurs combats, cependant, restent rares et difficiles d’accès. À ce constat de notre éternelle invisibilité s’ajoute alors celui qu’un territoire proche, concret, voit se rejouer les mêmes enjeux : Bure. L’étincelle était là, le feu a pris.
Agir ensemble, affirmer nos rôles dans la lutte anti-nucléaire de manière radicale et créative, revendiquer nos colères et nos joies, en faire des forces, manifester notre « pouvoir-du-dedans » – tel que l’appelle Starhawk dans Rêver l’Obscur (2015) – mais aussi ranimer les héritages de nos prédécesseures* et marcher symboliquement avec des adelphes3 contemporaines : autant de flammes qui ont éclairé notre voie pendant les semaines, les mois suivants. Nous nous sommes ainsi réuni·es entre l’Île-de-France et l’Est, les deux endroits principaux d’où est né le collectif des Bombes Atomiques. Nous avons imaginé et questionné inlassablement cet événement et son infinité d’aspects, notamment en travaillant en plus petits groupes concentrés sur des thématiques particulières. La mise en scène de la marche, par exemple, a été l’occasion de nous plonger dans les récits de femmes* comme celles de la Women’s Pentagon Action et dans leur manière de théâtraliser des émotions tout au long de leur action – colère, deuil, joie – pour rendre toute leur importance à ces dernières et manifester ensemble à travers elles4. Comment et à quel degré s’en inspirer ? Au fur et à mesure des semaines, notre trame s’est dessinée, a bougé, des symboles sont apparus – une portée d’animales/animaux radioactif·ves est venue au monde, et à la fin du printemps 2019, l’un·e d’elleux, une chouette à trois yeux, est devenue enfin la porteuse de l’annonce de l’événement à travers la France.

Le récit qui suit est porté et imprégné de ces intentions, de notre histoire commune. Issu de carnets restés longtemps sur mes étagères, il relate mon expérience d’un moment culminant du week-end : la « marche festive » du samedi 21 septembre, depuis le départ du campement en cortège de voitures jusqu’à la célébration finale dans une clairière surplombant le site de l’Andra. Avec ces mots, mais surtout avec ces gestes, ces chants, ces émotions qu’il rapporte, il vise à réaffirmer la présence et le rôle fondamentaux des femmes* et MINT dans les luttes écologistes – pour que l’histoire de nos luttes soit transmise et surtout, pour en tisser les suites.
Samedi 21 septembre. Il est environ 13h30, et sous un soleil de plomb et un ciel éclatant, des nuages de poussière accompagnent les départs successifs d’une soixantaine de voitures. Depuis le campement – une salle des fêtes dans le village de Montiers-sur-Saulx –, elles doivent rallier le sentier de la marche plus loin dans les terres.
L’agitation désordonnée du départ est progressivement rattrapée par l’excitation. Les voitures avancent pare-choc contre pare-choc avec une extrême lenteur pour que tout le monde puisse s’insérer dans la file en sortant du parking – le but étant de ne pas pouvoir être séparées par la police en cas de contrôle. Certaines personnes sortent de leur véhicule et accompagnent le cortège en marchant à côté. Les klaxons se succèdent, accompagnés de cris, de mains qui battent la mesure et de musique. La plus forte provient de notre voiture et de notre unique CD de chansons rock’n’roll. Elles inondent l’atmosphère : accords de guitare électrique et rythmes de batterie débordent des fenêtres et des portes que nous ouvrons allègrement (…).
Je saute de ma place passagère et trottine jusqu’à la voiture suivante, et la suivante, et la suivante, pour demander si quelqu’un·e a vu passer un mégaphone. Quand je reviens à ma portion du cortège, je constate qu’une autre passagère est sortie et circule pieds nus, et que mon amie, au volant, tient à la main un tube de paillettes argentées et du baume à lèvres, qu’elle distribue avec entrain. Elle sort de la voiture à l’arrêt avec les deux dernières passagères, et en applique sur leurs joues, leurs lèvres, leurs paupières. Je vois des bras et des torses qui scintillent au soleil, et les personnes autour de nous s’exclament à leurs fenêtres : « Moi aussi j’en veux ! ». De la voiture devant la nôtre s’échappe l’air de « Girls just wanna have fun » – on baisse le son de notre radio, parce que celui-ci nous paraît plus festif. Devant nous, une personne monte sur le toit de sa voiture, fait de grands signes au loin, les klaxons continuent (…).

Le trajet est partagé entre enthousiasme, silences solennels, musique et lecture, tandis que nous sillonnons plusieurs villages jusqu’à notre point d’arrivée. Nous avons tous et toutes enfilé nos masques. Ce sont parfois des assemblages de lunettes de soleil, tissus colorés dans les cheveux et cartons aux formes fantaisistes, que l’on fixe grâce à un élastique. Tout est très plat autour de nous lorsque finalement, les premières voitures s’engagent sur un chemin de pierres et de poussière entre des champs privés, dépouillés de leurs récoltes à cette période de l’année. La bifurcation donne l’occasion d’avoir une vue complètement dégagée sur une plus grande partie du cortège, et elle me coupe le souffle. Il y a des dizaines et des dizaines de voitures, au moins soixante, et certaines émergent encore des bosquets. Entre les deux parties de la boucle, on se remet à klaxonner et à se faire des signes de mains, en criant de joie. « C’est sûrement le premier bouchon de l’histoire ici ! » s’exclame une passagère à l’arrière de notre voiture, et une autre poursuit : « Greenham Common is back ». Mon cœur est gonflé d’émotions dans ma poitrine. Mon amie, au volant, serre ma jambe pendant une seconde. « On vit un moment historique », me dit-elle. Je me sens plusieurs à la fois, je me sens faire corps avec un groupe qui me dépasse, et malgré les voitures banalisées et les hélicoptères qui nous surveillent, je n’ai pas peur.
Une voiture après l’autre, nous nous garons alors dans un champ prêté pour faire office de parking, en formant des « escargots » successifs. Puis vient le moment de sortir, de déballer nos affaires et de commencer la marche. Autour de moi, c’est un défilé de tissus plus ou moins épais, colorés, brillants, à motifs, sur le corps mais aussi sur les visages, pour former des masques bariolés, parfois surréalistes et impressionnants de détails. Ils donnent à voir des animaux, des franges qui tombent au niveau des lèvres et se soulèvent avec les souffles et les paroles, des nez allongés, épais et solides, des oreilles en plumes, des couches de couleurs superposées, des chapeaux – bobs, casquettes, et même, chapeaux de sorcières, noirs et pointus. Une immense mascotte en toiles de tentes bleutées, tendues entre des cerceaux, soutenu par huit piquets en bois, et à la tête en papier mâché bleu électrique, museau rose et yeux jaunes, est posée au sol. On y fixe huit pattes en cartons, jointes par des punaises à l’articulation. Il/Elle/Iel s’élève soudain dans les airs – en quelques secondes, ses plusieurs mètres de hauteur dessinent, grandeur surréaliste, le symbole d’une lutte antinucléaire et féministe. L’animal, apparemment symbole classique de la lutte antinucléaire, c’est ici l’animal·e, fluorescent·e et irradié·e, à la fois légendaire et bien réel·le, qui marque l’expansion du nucléaire et ses effets. Iel est spectaculaire, dépasse toutes les proportions, comme cette foule qui remplit le champ de ses cris et ses agencements colorés aléatoires.

La marche est lancée dans cette atmosphère survoltée. La première étape consiste à remonter un chemin à vue, entre champs et bosquets, que notre cortège foisonnant déborde de toutes parts. Slogans, chants et cris accompagnent notre progression. Des hélicoptères tournent au-dessus de nous, mais la seule véritable rencontre avec des autorités intervient un peu plus tard… J’approche du haut du chemin, là où se forme un croisement avec, à droite, les sentiers menant en direction des bâtiments [du site] et, légèrement à gauche, celui qui continue de longer la forêt et un champ agricole à la terre retournée. Le cortège s’est arrêté. J’entends un « Les flics à la vaisselle / les flics à la poubelle ! » scandé en chœur, et se propager à demi-mot la rumeur que « les flics sont là » et nous bloquent. De là où nous sommes, nous n’en savons pourtant pas plus, et le cortège se remet assez rapidement en marche. Je passe le dernier espace qui me sépare du croisement, noyée dans un élan d’adrénaline général qui s’exprime par des « Cassez-vous ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! » vociférés à l’adresse de ce que je découvre bientôt : deux camionnettes foncées, postées sur notre droite. « Cassez-vous, la forêt n’est pas à vous ! », les mains tapent, et à cette charnière du croisement, alors que les camions redémarrent pour s’en aller, des cris de loups (et louves !) et des miaulements de chat·te·s accompagnent le départ. Une vraie colère s’empare, erratique, des groupements.
Après un dernier moment de marche à travers les champs, nous entrons enfin dans un sous-bois, que nous traversons jusqu’à la clairière, point d’arrivée et de célébration.

Dès lors, le paysage change complètement : le sol est tapissé de vert, d’herbes et de feuilles surtout, certaines déjà brunes et tombées mortes. Un sentier descend vers un poteau de bois qui indique que nous sommes sur un chemin de randonnée. De notre poste, nous voyons défiler toutes les participant·es, leurs perruques et leurs accoutrements colorés tranchant cette fois avec la dominante verte et ombragée de l’atmosphère. Le cortège progresse ici en petits groupes plus espacés, de deux à dix personnes qui marchent tranquillement, au rythme d’une balade. Des slogans reprennent un peu plus loin, devant nous. Le chemin tourne et serpente pour suivre la limite de la forêt et contourner le champ. Nous ne voyons pas les personnes qui avancent et qui chantent, nous apercevons seulement quelques taches de couleur vagues et éparpillées – mais nous entendons. Nous entendons les slogans qui rebondissent et se propagent dans l’espace, et qui font résonner toute la forêt. Ils viennent de partout à la fois et de nulle part précisément. « Réoccupons le bois », « récupérons les champs » sont scandés, entrecoupés de « L’Andra, dégage !/ résistance et sabotage / l’Andra, dégage ! / résistance et sabotage ! ».
Nous remontons légèrement pour émerger d’une partie du sous-bois. Les arbres forment un arc de feuilles au-dessus de nos têtes jusqu’à la sortie de la forêt, et lorsque nous arrivons à ce niveau et que la vue est dégagée, nous constatons qu’ils créent une fenêtre ronde donnant directement, en contrebas, sur les bâtiments du site. Accompagné·e·s par les paroles des Penn Sardin5, « écoutez l’bruit d’leurs sabots », nous émergeons du bois directement vers eux, sur eux, pendant quelques instants, avant de bifurquer vers une clairière. Une vague d’enthousiasme se répand au fur et à mesure des dernières arrivées, signalant que nous sommes sur la fin du trajet. Nous allons occuper cet endroit, entre un champ et une clairière, très haut par-rapport à notre point de départ. Derrière le bûcher qui se construit au fur et à mesure des aller-retours à la lisière du bois, une dalle bétonnée est taguée de grosses lettres rouges : « Des vulves contre des missiles ». C’est pour nous une référence évidente à l’ouvrage « Des femmes contre des missiles » qui relate le combat anti-nucléaire et féministe de Greenham Common en Angleterre.

C’est pile à ce moment que les riffs électriques profonds d’une chanson de Jeanne Added saturent l’air, émis depuis une sono mobile au volume poussé à fond, et les paroles « A war is coming » emplissent l’espace. Elles sont répétées pendant plusieurs secondes, dans un quasi-martèlement de basses qui fait vibrer le sol, et soulève une puissance, une adrénaline collectives, imprévisibles, débordantes. La tension de la musique monte, monte, jusqu’à éclater brusquement, et plusieurs personnes du premier rang s’embarquent alors dans une ronde autour du feu. Nous nous y joignons, on nous prend les mains ; certains segments du cercle en mouvement sont encore éloignés et on nous tire avec force pour les rejoindre. La course se fait de plus en plus rapide, frénétique, se communique à plusieurs rangs comme une répercussion d’ondes. Celles et ceux qui restent aux abords frappent des mains, sifflent, applaudissent. Lorsque la ronde s’immobilise, des slogans sont à nouveau lancés, et cette fois-ci leur écho paraît décuplé : « Sorcières, vénères, anti-nucléaires ! ». Le feu diminue progressivement, et au bout d’un moment, deux clowns improvisent un numéro en sautant par-dessus les braises sous les applaudissements. Le cercle finit par se rompre et le mouvement général retourne à la danse, au son de chansons telles que « Tomboy » de Princess Nokia. Les bras font des vagues et des formes dans les airs, les yeux se ferment, les pieds tapent le sol, les mains se tordent ou se prennent… Je demande à certain·es que je croise comment ça va, extatique, portée par l’élan du groupe : « Comment ça pourrait ne pas aller ? » me dit l’une, tandis qu’une autre sourit à travers son masque, les larmes aux yeux. Avec ma binôme, nous nous retrouvons transpirantes et ravies, transportées, au point que, alors que nous voulions seulement échanger nos gilets colorés, nous finissons par retirer nos t-shirts et danser torse nus, toujours masquées depuis la sortie du bois.

Quelques chansons plus tard, l’initiative d’une sorte de course à travers le champ, en direction de l’Andra, est lancée. Je ne comprends pas d’où elle vient, mais elle se répand comme un feu de paille, avec des réactions d’abord enthousiastes puis, très vite, mitigées voire opposées. Les risques sont soulignés avec vigueur, les discussions se tendent. Pourquoi se mettre en danger, avec nos niveaux de vulnérabilité différents, alors qu’on a réussi à en arriver là ? Parallèlement, tout ça semble difficile à entendre pour celleux qui se tiennent presque sur la ligne de départ et qui souhaitent plus que jamais montrer notre puissance, témoigner du fait que nous n’avons pas peur. Pour trancher, c’est une assemblée générale qui s’improvise finalement à même la clairière, malgré les soupirs et la fatigue. Assis.es en cercles successifs, nous sommes invité.es à prendre la parole, et plusieurs personnes partagent leurs ressentis et leurs arguments, souvent avec de l’émotion – colère ou larmes – dans la voix. Les témoignages se répondent, la tension est toujours palpable, mais l’évidence finit par émerger d’elle-même : nous renonçons collectivement à cette action, et entamons ensuite le trajet du retour.
La tombée du jour fait écho à la redescente générale d’adrénaline et d’énergie dans le cortège, qui s’est scindé en plusieurs groupes. Nous nous tenons les mains, les bras, épuisé·es mais grisé·es. Pour moi, les choses semblent encore irréelles – a-t-on vraiment fait ça ? Cet état de flottement m’enveloppe tout au long de la route qui nous ramène au campement. Là-bas, seulement là-bas, une fois toutes les voitures à nouveau garées, une fois que ça y est, que c’est réellement arrivé, que nous sommes toustes là et en sécurité, je m’éloigne et m’effondre dans l’herbe. Allongée, les yeux rivés sur le ciel rose et violet, je laisse mon corps absorber toutes les émotions qui l’ont secoué ces dernières heures. Chacune d’elle a été aussi éprouvante que fulgurante, tandis qu’à présent le temps s’allonge, s’étend comme moi, contemple. Ce sont les voix joyeuses de mes adelphes, prêt·es à fêter, qui me ramènent à une réalité dans laquelle il me semble que nous sommes – pour un instant, mais un instant infini – intouchables. Invincibles.
Il y a presque exactement trois ans, je vivais l’une des plus belles et intenses expériences de ma vie. Une expérience qui m’accompagne depuis, parce qu’elle m’a appris ce que peuvent les forces collectives féministes, même lorsqu’elles s’échauffent et frictionnent. Le travail, le soin et l’attention qui nous ont réuni·es ont ouvert une brèche dans leur monde, une possibilité bien réelle de la remplir d’autres choses, d’autres manières de vivre et de ressentir. Comme tout travail, il n’est jamais fini : à plusieurs égards, nous aurions voulu faire plus, mieux, toucher plus de personnes, de générations, de milieux. Notre fort ancrage parisien et intellectuel nous a toujours posé question.
Quoi qu’il en soit, ces souvenirs gardent une magie que je porte avec moi et que j’essaye de prolonger au quotidien. Quelque chose dont je suis fière. Et si l’élan qui nous a porté·es si nombreux.ses me paraît aujourd’hui difficile à retrouver, que je me demande quelles peuvent concrètement être ces suites à l’histoire, et que moi-même j’ai peur parfois de m’en être éloignée, je sais que nos luttes, vives et protéiformes, ne cesseront jamais de proliférer. Déterrer ce chapitre, c’est peut-être le premier pas en ce sens : c’est faire sortir de terre ces imaginaires, et c’est peut-être donner de nouveaux murmures à égrainer à cette chouette à trois yeux qui, il y a trois ans, s’est fait la fidèle messagère de notre appel.
Une Bombe Atomique, toujours
Merci à la photographe Diana Mara Henry pour son aimable autorisation de reproduire ses deux photos des luttes antinucléaires américaines des années 1980.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Acronyme de « Meufs, Intesexes, Non-Binaires et Trans », ici utilisé pour signifier que le week-end se déroulait en mixité choisie sans hommes cisgenres, c’est-à-dire, dont le genre masculin correspond à celui qui leur a été attribué à la naissance. Dans la suite du texte, l’étoile accolée au terme de « femmes » a la même utilité : il ne s’agit pas que de femmes cisgenres.[↩]
- Lorène Lavocat, « Week-end féministe à Bure : « Le nucléaire est un monstre du patriarcat » », Reporterre, 2019.[↩]
- Adelphe désigne de manière indéterminée les « frères », les « sœurs », et les personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces catégories de genre binaires.[↩]
- Ynestra King, « Si je ne peux pas danser, je ne veux pas prendre part à votre révolution », dans Reclaim, recueil de textes écoféministes, Cambourakis, coll. « Sorcières », 2016.[↩]
- « Penn Sardin » (« tête de sardines ») désigne ici des sardinières qui, à Douarnenez en Bretagne au XXe siècle, se sont mises en grève pour exiger de meilleures conditions de travail. Leur chant, connu sous ce même nom, intervient régulièrement dans des contextes militants, notamment les marches et manifestations.[↩]