Entretien réalisé par Quentin Hardy et Pierre de Jouvancourt.
Tu as récemment publié des articles1 remettant en cause la notion de transition énergétique, en montrant notamment que cette notion biaise la manière dont on pense les transformations aujourd’hui nécessaires face au changement climatique. Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont tes arguments principaux ?
Jean-Baptiste Fressoz : La transition énergétique est le futur le plus consensuel qui soit. Face au changement climatique, il faut évidemment faire une « transition énergétique ». Mais quand on y réfléchit, il s’agit de quelque chose de gigantesque dont on n’a aucune expérience historique. A l’échelle globale, il n’y a jamais eu de transition énergétique, on ne sait pas combien de temps cela peut prendre.
Cette idée de transition énergétique semble naturelle parce qu’on a une vision entièrement fausse de l’histoire de l’énergie, selon laquelle on aurait connu par le passé plusieurs transitions, qu’on aurait à plusieurs reprises entièrement changé de système énergétique (du bois, au charbon, du charbon au pétrole), alors qu’en fait on n’a fait que consommer de plus en plus toutes ces énergies.
A l’échelle globale, il n’y a jamais eu de transition énergétique… La notion actuelle de transition énergétique fait passer un problème civilisationnel pour un simple changement d’infrastructure énergétique.
Jean-Baptiste Fressoz
Notre culture historique a comme normalisé une futurologie extraordinairement étrange. La notion actuelle de transition énergétique fait passer un problème civilisationnel pour un simple changement d’infrastructure énergétique. C’est une erreur de catégorie.
Dans tes travaux récents, tu parles de « symbiose énergétique et matérielle »2 au sujet des relations entre les infrastructures énergétiques et productives dans l’histoire. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par là et donner quelques exemples ?
De manière générale, d’histoire de l’énergie est classiquement divisée en grandes phases : au XVIIIᵉ siècle on utilisait du bois et de l’hydraulique, au XIXᵉ siècle, avec la révolution industrielle, ce serait le charbon et au XXᵉ siècle du pétrole et de l’électricité. Dans un livre à paraître prochainement j’étudie au contraire les symbioses entre les énergies. Par exemple, en quoi l’usage du charbon fait qu’on consomme beaucoup plus de bois, y compris pour des raisons énergétiques ? En quoi l’usage du pétrole provoque une plus grande consommation de charbon, y compris pour des raisons énergétiques, etc.
Prenons l’exemple de la symbiose bois-charbon. En Angleterre, les mines de charbon dans la première moitié du XXe siècle consomment plus de bois que ce pays n’en brûlait au XVIIIᵉ siècle, car il faut entretenir des milliers de kilomètres de galeries souterraines. En Angleterre au XVIIIe siècle, on brûle environ 3,5 millions de mètres cubes de bois. Au début du XXe siècle on utilise 4,5 millions de mètres cubes d’étais.… Ce n’est pas du bois de feu, mais c’est bien du bois qui sert à faire de l’énergie. En outre, comme c’est du bois d’œuvre, cela nécessite des espaces forestiers environ six fois plus vastes. Que des historiens très réputés comme Anthony Wrigley racontent cette transformation comme une transition, ou pire encore une sortie de l’économie organique laisse songeur…
Si vous prenez les liens entre charbon et pétrole, on observe le même phénomène. Pour faire une voiture dans les années 1930, il faut sept tonnes de charbon. C’est une masse équivalente à celle que la voiture va consommer en pétrole pendant sa durée d’usage vie. Donc quand on pense charbon, il faut penser bois. Quand on pense pétrole, il faut penser charbon, etc. Ces choses là sont parfaitement inextricables.
Quand on pense charbon, il faut penser bois. Quand on pense pétrole, il faut penser charbon. Une ressource en appelle une autre : il faut voir ces complémentarités et faire des additions…
Jean-Baptiste Fressoz
Et puis, grâce au pétrole, on a de plus en plus de bois. Une des plus grandes transformations des quarante dernières années, dans l’histoire de l’énergie, c’est l’explosion du charbon de bois en Afrique. C’est la première fois dans l’histoire qu’on a des mégalopoles de plus de 10 millions d’habitants qui utilisent massivement le charbon de bois pour la cuisson. Par exemple, Kinshasa, ville de 11 millions d’habitants, consomme 2,15 millions de tonnes de charbon de bois par an. Par comparaison, Paris consomme 100 000 tonnes de charbon de bois par an dans les années 1860. C’est un autre ordre de grandeur.
Cette consommation de charbon de bois est rendue possible grâce au pétrole : on peut aller chercher le charbon de bois beaucoup plus loin avec des camions. Le bois c’est du pétrole et inversement. Dans les pays riches, si on prend en compte les engins forestiers, le transport, on arrive au résultat qu’il faut une calorie de pétrole pour avoir dix calories de bois.
Toutes les énergies entretiennent des relations symbiotiques. On s’est trop focalisé sur certains cas locaux de substitution comme celui du moteur diesel qui a remplacé la machine à vapeur dans la navigation et les chemins de fer. Mais cela n’empêche pas une énorme consommation de charbon, ne serait-ce que pour produire les bateaux et les trains.

Arrêtons-nous justement sur l’argument de Timothy Mitchell, qui a eu beaucoup de succès. Dans son livre Carbon Democracy, il soutient que que les systèmes sociaux sont reliés aux systèmes énergétiques, et notamment aux propriétés physiques des énergies elles-mêmes. Par exemple, le charbon rendrait possible des rapports de forces favorables aux classes ouvrières dans la mesure où les travailleur·ses du charbon étaient nombreux·ses, pouvant bloquer totalement l’approvisionnement (la mine est dangereuse, difficile d’accès et donc facile à bloquer, etc.). Au contraire, le pétrole serait davantage un flux qu’un stock, plus ou moins liquide et distribué via des tuyaux, requérant tendanciellement un personnel plus instruit (ingénieur·es) et remettant peu en cause les conditions de travail et la domination économique. Mitchell soutient que le passage d’une énergie à l’autre permet d’expliquer la montée d’un État de moins en moins préoccupé par la redistribution des richesses…
Mitchell a tort tout simplement car le pétrole ne se substitue pas au charbon, ou pas avant les années 1960. La thèse de Mitchell repose sur une comparaison biaisée, celle du pétrole moderne des années 1960 avec une vision du charbon figé dans les années 1900.
Le pétrole empiète sur les marchés du charbon seulement à la fin des années 1950 et à ce moment le charbon est très intense en capital. C’est avec des haveuses électriques qu’on extrait le charbon. Aux Etats-Unis, en 1958, les mines de charbon emploient nettement moins de monde que les champs de pétrole et les raffineries. Sans parler des pompistes, des camionneurs etc… Le syndicat des camionneurs américains est une puissance sociale considérable, le plus redouté des syndicats depuis l’entre deux guerres.
En outre, le charbon est très fluide. Il sert à produire du gaz depuis longtemps, de l’électricité, et dans les centrales électriques on l’utilise sous forme de poudre etc. Il existe même des carboducs, des sortes de pipelines à charbon…
La thèse de Mitchell illustre une appétence pour les explications matérialistes du politique mais un désintérêt paradoxal pour l’histoire de la production, ce qui conduit à des récits faux. Son succès s’explique facilement : les intellectuels n’ont jamais fait le deuil du déterminisme technique.
Dans les années 1950, l’idée de transition énergétique est très hétérodoxe. On considère les énergies comme s’additionnant les unes aux autres, le charbon étant alors indétrônable.
Jean-Baptiste Fressoz
Dans un article récent3, tu montres que le lobby atomique est une racine importante de l’idée de transition énergétique. Ce milieu est aussi préoccupé par la rapidité de la croissance démographique et la limitation de ressources. Est-ce que tu peux préciser en quoi ce milieu est néo-malthusien4 et revenir sur les discours et les idées portées par celui-ci à cette époque?
Pour bien préciser les choses, il faut dire qu’au départ, l’idée de transition énergétique est très hétérodoxe. Économistes, ingénieurs, géologues ne pensent pas du tout le système énergétique comme un système en substitution. Pour tout le monde, le charbon reste et va rester longtemps encore le pilier du monde industriel, même si le pétrole et l’hydroélectricité progressent et même si dans les années 1950 y a un battage médiatique autour de l’âge atomique à venir. On le voit par exemple, dans les rapports de la commission du sénateur Paley : on n’y parle du nucléaire comme une énergie intéressante mais pas très importante, qui pourrait au mieux s’ajouter aux autres sources fossiles, sans réellement s’y substituer.
Mais il y a un groupe d’intellectuels qui pensent différemment. Ce sont des savants qui sont à la fois atomistes et néo-malthusiens, et c’est important que ce soient les deux à la fois. Ils ont souvent travaillé pendant la guerre au projet Manhattan et plus précisément au Metallurgical Laboratory de l’université de Chicago. Ils ont mis au point la première pile atomique sous l’égide d’Enrico Fermi et ils sont fascinés par les applications civiles, énergétiques de l’atome, en particulier par le surgénérateur nucléaire qui sur le papier a des rendements absolument extraordinaires. Ils se sentent aussi horriblement coupables d’Hiroshima et Nagasaki et veulent expliquer que le nucléaire, c’est aussi la clef de survie de l’humanité.
Comme ça a été dit dès le lendemain de Hiroshima…
Oui, Hiroshima réalise une révolution scientifique, comme titrait Le Monde en 1945. L’originalité de ces savants est de fabriquer une futurologie nouvelle car ils pensent le très long terme. Est-ce qu’il y aura du charbon en 2050 ? en 2100 ? Et question connexe : que se passe-t-il dans l’atmosphère si on brûle tout le charbon, tout le pétrole ?
De ce point de vue, ce sont réellement des visionnaires : ce sont les premiers à étudier le réchauffement climatique de manière très nouvelle grâce aux isotopes et au spectromètre de masse. Le nucléaire permet d’éviter à la fois l’épuisement des ressources fossiles et le réchauffement climatique. Cela permettrait aussi de nourrir la population mondiale. Car si l’on dispose du surgénérateur c’est-à-dire d’une énergie illimitée tout devient possible : on pourrait désaliniser l’eau de mer, produire des engrais à foison, rendre fertiles de vastes zones arides de la planète. Donc le nucléaire, disent-ils, va augmenter la capacité de charge de la planète !
Jusqu’aux années 1970, tout le monde pense que le futur énergétique restera structuré par les fossiles.
Jean-Baptiste Fressoz
C’est Harrison Brown, un savant atomiste, ancien du projet Manhattan et du Met Lab, figure de proue des ligues néo-malthusiennes qui invente l’expression de « transition énergétique » en 1967. Au départ, ce terme est un concept de physique atomique. Il s’agit d’un un électron qui change d’état autour d’un noyau. Brown recycle un terme qui lui est familier. Une autre source d’inspiration est l’idée de transition démographique chère aux néo-malthusiens, qui date de 1945 et qu’on doit au sociologue Kingsley Davis. Il emploie l’expression « transition énergétique » pour la première fois dans un livre sur le contrôle des naissances, parrainé Rockefeller III, qui est un des philanthropes du néo-malthusianisme dans les années 1960. Excepté les atomistes, personne ne parle de « transition » jusqu’aux années 1970, tout le monde pense que le futur énergétique restera structuré par les fossiles et en particulier le charbon.
Donc, au départ, l’idée de transition est un argument de promotion de l’atome. Elle est portée par un milieu influent certes, mais tout petit en comparaison des économistes, des experts de l’industrie pétrolière, charbonnière, etc. qui sont très sceptiques sur l’intérêt économique de l’atome. Pour les malthusiens atomiques, les économistes n’ont rien compris : le but n’est pas d’être compétitif avec le charbon, mais de faire en sorte que l’atome soit disponible quand il n’y aura plus de charbon, à l’horizon du XXI ou XXIIe siècle. Ces gens-là pensent l’énergie différemment, à très long terme.

Il y a donc une sorte d’idéalisme énergétique dans un petit milieu techno-scientifique. Est-ce que c’est cet idéalisme énergétique qui imprègne le discours écologique d’aujourd’hui ?
Non car il s’est passé beaucoup de choses entre temps…Et d’abord : le choc pétrolier et la notion de crise énergétique. Dès la fin des années 1960, l’Atomic Energy Commission et General Electrics commencent à vulgariser l’idée qu’on ferait face à une crise énergétique. Il y a des blackouts dont un à New York en 1965, qui a beaucoup d’écho dans la presse.
Les causes sont bien connues : les investissements dans les infrastructures manquaient. Il y aussi des normes sur le soufre qui fait qu’on ne peut pas toujours utiliser le charbon avant d’installer des équipements pour désulfuriser les fumées à la sortie des centrales thermiques. Donc le manque d’électricité n’est pas dû à une pénurie de charbon aux États-Unis, évidemment.
Toujours est-il que l’idée de crise énergétique commence à être diffusée de manière subreptice par le lobby atomique qui dit : « Si vous continuez à nous embêter, d’empêcher les procédures d’autorisation des centrales, on va avoir une crise énergétique. » C’est un argument anti-écolo au départ. La crise énergétique est une arme contre la crise environnementale qui commence à faire parler d’elle — pensez au Earth Day de 1970.
Certes, l’environnement c’est très télégénique, on voit des mouettes dans le mazout, c’est choquant, mais le vrai problème, explique le lobby atomique, c’est qu’on va manquer d’énergie.
Jean-Baptsite Fressoz
L’idée est de dire que la crise énergétique est urgente alors que la crise environnementale est plus lointaine. Certes, l’environnement c’est très télégénique, on voit des mouettes dans le mazout, c’est choquant, mais le vrai problème, explique le lobby atomique, c’est qu’on va manquer d’énergie. Le but c’est d’obtenir des financements pour le programme nucléaire. Les gens de l’Atomic Energy Commission (AEC) vont faire des séminaires et former des journalistes, notamment du New York Times au thème de la « crise énergétique ». Et on voit paraître ensuite des séries d’articles sur la crise énergétique, comme en 1971.
Arrive le choc pétrolier. Cette idée de crise énergétique, évidemment, s’impose dans le débat public et avec elle l’idée de transition énergétique. A ce moment-là, les associations environnementalistes américaines reprennent le discours de l’ennemi. C’est par exemple Lester Brown qui est le fondateur du World Watch Institute, un agronome néo-malthusien américain qui affirme que la transition sera obligatoire car il n’y a plus d’énergie. Le pétrole, c’est fini. Il fait passer l’idée de crise énergétique pour quelque chose de complètement naturel, alors qu’elle était créée de toutes pièces.
Donc, au départ, ce discours de la crise énergétique et de la transition énergétique n’est pas du tout un discours qui vient d’écologie. C’est un discours qui vient du monde du nucléaire. En fait, ça a été repris ensuite par les associations environnementalistes américaines. Et c’est un peu ça le problème.
C’est-à-dire ?
Primo les écologistes ont repris cette idée que le pétrole était en bout de course ce qui n’était pas vrai. Deuxio, certains ont aussi repris l’idée d’un monde technique malléable, qui au départ vient de l’industrie nucléaire. Amory Lovins est un très bon exemple. Il est physicien et membre de Friends of the Earth. C’est un promoteur des « énergies douces » (soft energy path) c’est-à-dire des renouvelables, du solaire surtout. Il publie en 1976 un article intitulé « Energy, the path not taken » dans lequel il défend l’idée qu’en trente ans on peut faire basculer entièrement les Etats-Unis sur l’énergie solaire. Pour les voitures, pas de problème : on fera des biocarburants. Maintenant c’est vu comme un précurseur, mais ses prédictions de 1976 sur le mix énergétique ont été complètement à côté de la plaque.
C’est aussi un discours très néolibéral, qui critique le nucléaire comme une technologie étatique, bureaucratique, lente et coûteuse, etc. à l’inverse des renouvelables que chacun peut s’approprier. Chaque ingénieur dans son garage va inventer les nouvelles techniques énergétiques et la transition ira très vite grâce à l’ingéniosité des Américains. C’est une vision du monde de l’énergie très startup nation, disruption et compagnie, où le monde matériel peut basculer très rapidement.
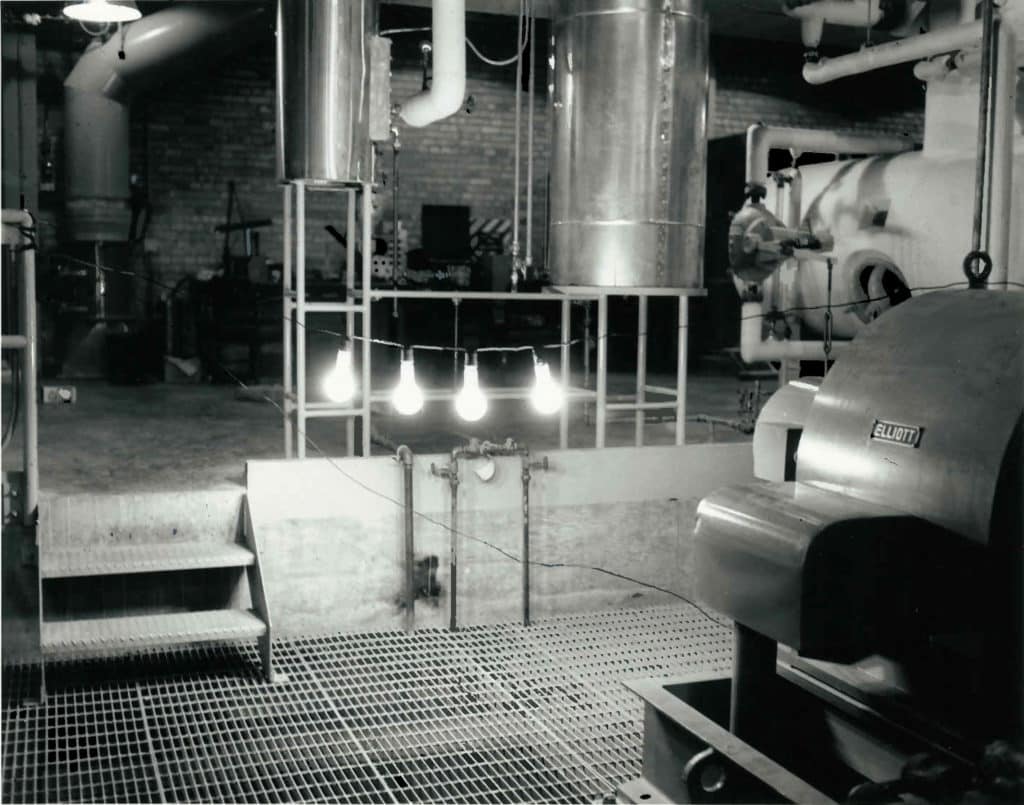
Une autre étape importante de cette histoire est le discours de Jimmy Carter du 18 avril 1977 sur la transition énergétique. Il présente son National Energy Plan qui prévoit un triplement du charbon aux États-Unis, décision qui est liée à la souveraineté énergétique.
Pour décrire cela, il utilise le terme de « transition énergétique » ce qui donne un atour futuriste à un retour au charbon…. Son discours commence par une grande fresque historique : « par le passé, on a fait deux transitions énergétiques, la première du bois au charbon, la seconde le charbon pétrole et maintenant nous devons faire une troisième transition énergétique ». Le lendemain, le New York Times publie un article disant que les États-Unis et le monde sont à l’aube d’une troisième transition énergétique…. Et le charbon n’est alors présenté que comme énergie de transition, ou « bridge to the future »5.
Chose intéressante, ce futur n’est pas forcément nucléaire puisque Carter n’est pas très enthousiaste de cette technologie, car il la connaît bien. Un point peu connu : Carter a fait l’école de la Marine et il a travaillé dans un des premiers sous-marins nucléaires, sous l’égide de l’amiral, Rickover, une légende aux Etats-Unis, qui a organisé la conversion des sous-marins de la marine américaine vers l’atome. Donc Carter connaît très bien l’atome et il sait par expérience que c’est dangereux car il a participé directement à la gestion d’un incident dans un sous-marin américain.
En mettant en évidence les énormes inerties techniques héritées de notre histoire, ne pourrait-on pas penser que ton travail reconduit précisément une forme de déterminisme technologique ? Mais comment alors réhabiliter la possibilité d’une bifurcation politique ? Ou cela te semble-t-il impossible ?
Non, ce n’est pas impossible, mais si tu ne comprends pas l’inertie, tu ne peux te donner les moyens de faire la bifurcation dont tu parles. L’inertie du système énergétique à l’échelle mondiale est un phénomène réel, titanesque, qu’il faut penser à sa juste hauteur et affronter de face. Certes il faut politiser mais pas n’importe comment.
L’inertie du système énergétique à l’échelle mondiale est un phénomène réel, titanesque, qu’il faut penser à sa juste hauteur et affronter de face.
Jean-Baptiste Fressoz
En histoire, récemment, il y a eu cette tendance de présenter le changement climatique comme un complot ourdi par quelques capitalistes. Cela paraît radical. C’est surtout très réconfortant pour la gauche et c’est mésestimer l’ampleur des transformations à opérer, c’est mal comprendre la politique de l’Anthropocène. Sortir du carbone est encore plus difficile que sortir du capitalisme.
On retombe sur la vieille question de la décroissance et le fait qu’il reste très difficile d’en discuter avec la vaste majorité des économistes. Dans le dernier rapport du groupe III du GIEC, 3000 scénarios ont été testés, mais aucun scénario de décroissance n’a été proposé. Il n’y a pas un économiste qui s’est dit « tiens, modélisons des hypothèses de décroissance ! » Sans même parler de baisse du PNB mondial, ils pourraient au moins regarder ce qui se passe si on réduit drastiquement la consommation de matériaux dont on sait qu’on ne pourra pas les décarboner à l’horizon 2050—je pense à l’acier, au ciment— ou encore à l’aviation.
Est-ce que ce serait la catastrophe ? Peut-être pas. Si cela se trouve, plein d’autres choses croîtront pour le mieux. Il pourrait y avoir plein de « co-bénéfices » pour parler comme le GIEC.
Est-ce que ton travail ne met pas en évidence qu’au fond, les sociétés industrielles et productivistes, et avec elles, leur stratification sociale nationale et internationale, sont plus rétives à la lutte contre le changement climatique qu’à s’exposer aux conséquences d’un réchauffement très important ?
Evidemment, c’est pour cela qu’on ne fait rien. La transition énergétique a surtout eu une fonction idéologique dans les pays du Nord. Raconter un futur vert est très utile pour justifier la procrastination présente. D’ailleurs pour les élites américaines, dès la fin des années 1970, la messe est dite, il y aura un réchauffement, la question c’est l’adaptation. Dès 1976 on discute de l’adaptation aux Etats-Unis et on conclut que le pays est finalement bien armé pour faire face au réchauffement.
C’est ce choix qui a été fait, mais cela n’a pas été présenté comme cela. Ce choix il faut l’expliciter, le poser clairement et il faudra surtout l’expliquer aux pays où l’on mourra de faim — où l’on meurt déjà de faim — à cause du réchauffement et du prix des denrées alimentaires trop élevé. Le blabla sur la transition a aussi cet aspect sordide.
Et on ne trouve aucun équivalent qui pourrait nous permettre de donner un élan politique en nous disant qu’une bifurcation est possible ?
Non désolé, je ne crois pas que l’histoire ait d’analogie utile à fournir. On pourrait invoquer le New Deal, la mobilisation pour la seconde guerre mondiale, etc. Mais c’est complètement à côté de la plaque. Il faut se passer de l’essentiel de ce qui a fabriqué la seconde nature depuis un siècle. Toute analogie historique courrait le risque de sous-estimer ce qu’il faut faire maintenant.
Des sociologues très en vue dans le dernier rapport du GIEC se plaisent à faire ce genre d’analogie. Ils citent par exemple le programme électronucléaire français qui a permis de sortir le charbon du mix électrique.
Une fois prises en compte les émissions importées, l’empreinte carbone de la France stagne ou baisse tout doucement.
Jean-Baptiste Fressoz
Mais, même en mettant de côté le fait que le rythme auquel il faudrait diminuer nos émissions est de très loin supérieur à la vitesse d’installation possible de centrales, il faut aussi rappeler que la France n’a pas vu ses émissions baisser drastiquement depuis les années 1980. Une fois prises en compte les émissions importées, l’empreinte carbone de la France stagne ou baisse tout doucement.
Tu dis que le discours sur la transition est obsolète, faut-il complètement y renoncer ?
Oui et non, ce discours est obsolète et en même temps il faut bien faire une « transition », mais là où c’est possible, à savoir dans la production d’électricité.
Sur ce point une autre évidence : il serait dommage de se laisser enfermer dans un débat « innovation versus décroissance » — les panneaux solaires coûtent moins cher et c’est tant mieux — mais il faut aussi que les tenants de la croissance verte comprennent qu’ils ont une vision aberrante des techniques et de leurs temps de diffusion : les renouvelables marchent bien pour fabriquer de l’électricité, beaucoup moins pour faire du ciment et de l’acier. Or l’acier et le ciment, c’est 15% du CO2, et ça suffit à nous faire passer le cap des 2°C. Donc des pans entiers de l’économie mondiale doivent décroitre, l’aviation bien sûr, l’automobile, les cimenteries, les aciéries et j’en passe. Au fond le sujet c’est voir quel est le CO2 vraiment utile.
Ce qui m’intéresse en tant qu’historien, ce n’est pas tant la question dont tout le monde débat : est ce que cette transition est possible ? Dans les temps impartis pour les 2°C tout le monde sait que non — mais de montrer à quoi dans le passé a servi les discours sur la transition depuis les années 1970, à qui il a servi et aussi à quoi il sert encore.
Les tenants de la croissance verte ont une vision aberrante des techniques et de leurs temps de diffusion. Des pans entiers de l’économie mondiale doivent décroitre : l’aviation, l’automobile, les cimenteries, les aciéries…
Jean-Baptiste Fressoz
Par exemple, dans mes recherches j’ai été très frappé par un discours de 1982, du chef de la R&D d’Exxon, Edward David. Il est invité à un colloque par le climatologue James Hansen, qui deviendra par la suite très médiatique. Ce personnage admet l’évidence d’un changement climatique produit par la combustion des énergies fossiles. La question qu’il soulève est cependant la suivante : « Qu’est ce qui va aller plus vite ? La catastrophe climatique ou bien la transition énergétique ? »
Il dit alors que le monde est en transition et que cette dernière aura lieu avant la catastrophe. Le plus étrange est de voir combien les climatologues, ceux-là même qui portent l’alerte, achètent cet argument.
Ils affirment qu’on sentira les effets du changement climatique en l’an 2000, qu’il aura des conséquences économiques en 2020 et qu’il sera catastrophique en 2070. Mais d’ici là, pense-t-on, évidemment qu’on aura fait une transition énergétique puisqu’une transition prend environ un demi-siècle. Cette idée devient une évidence partagée, alors qu’on n’en sait rien. On n’en a jamais vraiment fait.

Mais n’y a-t-il pas une contradiction avec le rapport Meadows de 1972, dans la mesure où celui-ci prétendait prédire un effondrement des sociétés industrielles si celles-ci poursuivaient la même trajectoire ?
Oui, c’est un moment important dont je n’ai pas parlé là pour l’instant. Ce rapport a eu indirectement une influence considérable sur la question climatique et cela pour au moins deux raisons.
Premièrement, d’un point de vue général, le rapport au club de Rome a pesé sur la manière dont le problème du réchauffement a été défini comme analogue à un problème de ressource. En 1979 lors de la conférence mondiale sur le climat à Genève, le météorologue américain Robert White déclarait : « il faut penser le climat comme une ressource ». Et c’est ce qu’avaient fait les économistes, en particulier William Nordhaus dont ne ne peut surestimer l’importance — néfaste — dans cette histoire.
Les économistes ont pensé le climat comme un problème de valorisation actuelle nette d’une ressource non renouvelable. Comment optimiser le PNB sous contrainte climatique ? Et ils ont recyclé la réfutation de l’alerte néo-malthusienne du rapport au club de Rome dans l’économie du climat. Cela donnait une place clé à l’innovation qui jusqu’alors avait effectivement paré, dans les pays riches, à l’épuisement des ressources, par des gains d’efficacité, des innovations, des capacités à puiser plus profond, à trouver d’autres gisements, ailleurs, plus loin, etc. Le problème est que le changement climatique est une affaire de surabondance inégalitaire du carbone.
Deuxièmement, une institution clé pour le groupe III du GIEC qui s’appelle l’IIASA, pour Institute for Advanced Systems Analysis, est créée en 1972 avec en son sein un groupe énergie qui se conçoit comme la réponse sérieuse au club de Rome. L’idée est de reprendre la même méthode, utiliser des ordinateurs et des modèles, pour montrer que les époux Meadows se trompent, qu’il y a des trajectoires qui nous permettent de faire une « smooth transition », une transition douce en dehors des fossiles.
Or ces modèles vont fournir la base de ceux du groupe III du GIEC. Nordhaus fait d’ailleurs ses classes au IIASA. La stratégie adoptée par le IIASA est la suivante : on utilise du charbon pour faire face à la crise pétrolière, et puis vers 2000, on aura enfin le surgénérateur nucléaire. Il faut faire une transition, mais plus tard, quand elle sera meilleure marché grâce au surgénérateur. C’est aussi la stratégie de Nordhaus et celle du rapport du groupe III du GIEC de 1995.
Au sein du IIASA travaille un savant italien assez fascinant : Cesare Marchetti. Dans cette affaire transition énergétique, s’il y a un intellectuel à retenir, c’est lui. Grand promoteur de l’économie de l’hydrogène dans les années 1960 et 1970, il est en quelque sorte l’ancêtre de Jeremy Rifkin. Son idée est que l’hydrogène liquide est la clé pour que le nucléaire devienne important, en s’étendant au-delà du simple marché de l’électricité. En quelque sorte, derrière sa passion pour l’hydrogène, c’est le plus fanatique défenseur de l’atome.
Dans les années 1970, un savant italien juge que l’horizon temporel d’une sortie des fossiles en 50 ans est tout à fait irréaliste et finalement la grande énergie des années 2000-2020, c’est le gaz.
Jean-Baptiste Fressoz
En 1974, il commence à travailler pour l’IIASA et se met à faire de l’histoire des techniques en regardant leur temps de diffusion. Et c’est là qu’il va commencer à utiliser des courbes de diffusion logistique pour savoir combien de temps prendrait une transition énergétique. En faisant cela, il se met à considérer l’évolution des énergies en relatif et définit la transition comme le temps que prend une énergie pour passer de 1 à 50 % d’un mix énergétique. Si Jimmy Carter parle de transition le 18 avril 1977 c’est parce qu’il a vu des graphiques inspirés des travaux de Marchetti.
Plus intéressant encore, Marchetti critique la méthode des scénarios employés par le IIASA. Pour lui, l’horizon temporel d’une sortie des fossiles en 50 ans est tout à fait irréaliste et finalement la grande énergie des années 2000-2020 c’est le gaz, — il a vu juste d’ailleurs. Et il critique la méthode par scénarios qui donne l’illusion qu’on pilote cette chose colossale qu’est le système énergétique global, cet énorme ensemble de ressources, de marchés, de consommateurs, d’habitudes, de lois, etc. Avec les scénarios, on voit beaucoup de trajectoires possibles. Marchetti rejette cette vision et défend l’idée que le futur est largement prédéterminé par l’histoire.
Bien sûr, c’est beaucoup trop mécaniste. Il a été critiqué par l’historien Vaclav Smil parce qu’avec son modèle logistique de diffusion, le charbon aurait dû disparaître autour de l’an 2000. Donc, oui, il s’est légèrement planté. Mais, alors qu’il était très pro-nucléaire, son message était de dire, contrairement à ses collègues : « Ne rêvez pas, cela prend énormément de temps de sortir des fossiles. » Il est déçu d’une certaine manière par ce que l’histoire montre : il ne verra jamais son rêve de société hydrogène.
Ce que Vaclav Smil ne dit pas et qui à mon avis très inquiétant, c’est que Marchetti était le prospectiviste le plus pessimiste parmi les futurologues des années 1970. Pour le dire autrement : les plus pessimistes étaient beaucoup trop optimistes.
Notes
- Voir notamment Fressoz, Jean-Baptiste. « The age of » et ses problèmes. Du phasisme matériel dans l’écriture de l’histoire », Revue d’histoire du XIXe siècle, vol. 64, no. 1, 2022, pp. 173-188 ; Fressoz, Jean-Baptiste. « La « transition énergétique », de l’utopie atomique au déni climatique : États-Unis, 1945-1980 », Revue d’histoire moderne & contemporaine, vol. 69-2, no. 2, 2022, pp. 114-146. [↩]
- Fressoz, Jean-Baptiste. « Pour une histoire des symbioses énergétiques et matérielles », Annales des Mines – Responsabilité et environnement, vol. 101, no. 1, 2021, pp. 7-11.[↩]
- « La transition énergétique de l’utopie atomique au déni climatique. Etats-Unis, 1945-1980 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2022, vol. 69, n°2, p. 114-146.[↩]
- « Le malthusianisme désigne une réduction de la natalité, soit planifiée par une autorité (une politique malthusienne), soit adoptée par une population (un comportement malthusien). […] Dans un sens plus large, le « néo-malthusianisme » peut désigner des approches de l’environnement dans lequel l’accent est mis sur le caractère limité des ressources imposant de limiter la croissance démographique, en opposition avec les approches préconisant par exemple des changements dans les modes de vie ou une répartition plus équitable des ressource », voir : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/malthusianisme[↩]
- ndlr : « un pont vers le futur »[↩]







