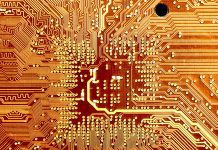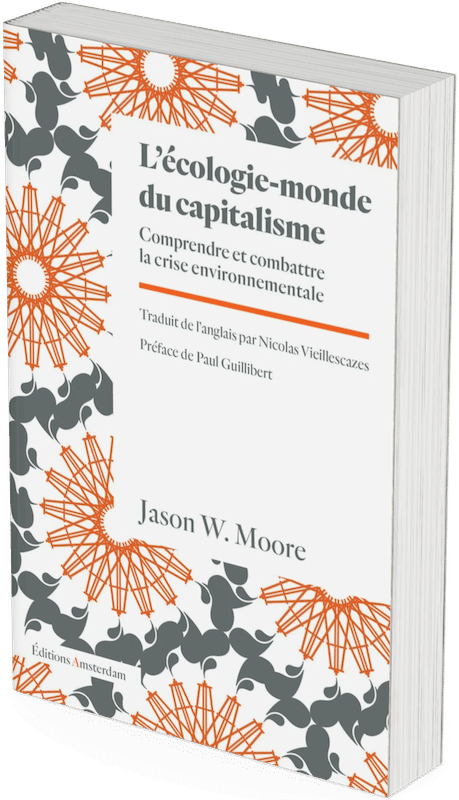
Préface au livre de Jason W. Moore, L’écologie monde du capitalisme. Comprendre et combattre la crise environnementale, trad. Nicolas Vieillescazes, Paris, Amsterdam, 2024.
Toutes les images d’illustration sont de la photographe et plongeuse Naja Bertolt Jensen.
En théorie politique, il existe deux manières principales d’écrire et de penser. Certain·es auteur·rices clarifient des énoncés, tranchent entre des alternatives contradictoires, tracent des lignes de démarcation. D’autres au contraire formulent des problèmes nouveaux par rapport auxquels il conviendra désormais de se positionner et élaborent des concepts originaux qui permettront d’en faire la théorie. Les un·es privilégient l’analyse, les autres la synthèse. À la première tendance appartient la rigueur du raisonnement et la clarté des énoncés ; la seconde s’illustre par la formulation épineuse de problèmes complexes dont il n’est pas dit qu’ils trouveront de résolution rapide ou de solution définitive. Jason W. Moore est de ceux-là.
Auteur prolifique, responsable de plusieurs dizaines d’articles de recherche, fondateur du courant de l’écologie-monde, traduit dans une vingtaine de langues, il compte parmi les penseurs les plus originaux de la pensée écologiste contemporaine. À la croisée de l’histoire environnementale, de l’histoire globale et de la géographie critique, grand lecteur de Karl Marx, de Rosa Luxemburg, de Fernand Braudel et d’Immanuel Wallerstein, il invente sans cesse de nouveaux mots pour nommer les concepts qu’il produit : « écologie-monde », « oikeios », « double internalité », « Capitalocène », « Nature bon marché », « Nature sociale abstraite »… Cette profusion donne parfois l’impression que Moore n’a pas choisi le cap le plus simple pour naviguer entre les obstacles conceptuels et les difficultés empiriques.
Pourtant, la synthèse qu’il propose constitue l’une des formulations les plus ambitieuses de l’écologie politique contemporaine, articulant une théorie rigoureuse de l’accumulation du capital et l’élaboration d’une cosmologie non dualiste. Rares sont ceux qui parviennent aujourd’hui à fonder la critique du capital sur une philosophie de la nature où les humains apparaissent comme des faiseurs de monde parmi toutes les autres espèces, comme une espèce inscrite dans « le tissu de la vie ».
Selon Jason Moore, le capitalisme est un système économique fondé sur la production de marchandises pour le profit, par l’intermédiaire de l’exploitation du travail salarié mais aussi par l’appropriation gratuite du travail et des énergies déployées par toutes les forces naturelles pour reproduire les conditions de la vie. Développant une thèse désormais classique chez les féminismes marxistes, Moore considère que l’accumulation de valeur produite dans la sphère du travail salarié serait impossible sans une appropriation non rémunérée et systématique des forces naturelles productives et reproductives dans leur ensemble. La stimulation et l’appropriation du tissu de la vie, la captation du travail des faiseurs de monde humains et extrahumains est la condition fondamentale du capitalisme. Cette thèse ontologique sur le devenir écologique du capital a pour corollaire une thèse historique sur l’émergence du dualisme nature-société et une thèse épistémologique sur la manière d’en faire le récit.
S’il faut décrire le capitalisme à partir de sa capacité à s’approprier le tissu de la vie, il convient également de définir la nature à partir de l’histoire des sociétés qui l’ont transformée. Repenser le capitalisme dans la nature et la nature dans le capitalisme, c’est l’idée principale du concept moorien de « double internalité ». D’où une conclusion ontologique importante : il n’existe pas une nature mais bien des natures historiques, forgées par l’histoire réelle des modes de production et par l’histoire symbolique des formations discursives qui les prennent pour objet. Le récit de la modernité doit pouvoir rendre raison de l’historicité des natures et de l’écologie du capital.

Histoires de traduction
Lorsque nous avons commencé à publier Jason W. Moore avec le comité de rédaction de la revue Période en 20151, il était encore tout à fait inconnu dans les débats publics et relativement absent dans les discussions académiques françaises2. « Au-delà de l’écosocialisme : une théorie des crises dans l’écologie-monde capitaliste » introduisait ses principaux concepts dans une perspective de longue durée. En effet, c’est d’abord la dimension globale qui nous avait frappé dans ses articles historiques sur l’émergence de la crise écologique dans les plantations esclavagistes de Madère au XVe siècle3. La mondialité de la catastrophe écologique n’apparaissait plus comme l’effet tardif de l’industrialisation de l’économie fossile en Europe mais comme la matrice du développement du capitalisme depuis son origine coloniale.
Toujours en 2015, Verso publiait l’œuvre maîtresse de Moore, Capitalism in the Web of Life : Ecology and the Accumulation of Capital4. À cette occasion, il était invité à Paris par des historien·nes de l’environnement5. Il s’est imposé peu à peu comme un auteur incontournable dans les débats anglophones tant dans le « Green Marxism » qu’en écologie politique en général6. Rapidement, il est apparu comme une référence importante dans l’université française : ainsi, il est largement étudié dans l’ouvrage d’Armel Campagne Le Capitalocène, cité dans La Ronde des bêtes de François Jarrige, largement utilisé dans Nous ne sommes pas seuls de Léna Balaud et Antoine Chopot, qui concrétisent et actualisent ses principales thèses7.
L’œuvre de Moore constitue une tentative radicale pour refonder la critique du capitalisme sur une cosmologie non dualiste.
Pourtant, l’excellente traduction française de Robert Ferro aux éditions de l’Asymétrie, Le Capitalisme dans la toile de la vie8 (2020), n’a pas reçu la réception qu’elle méritait. Cela tient selon moi à trois éléments essentiels. Le premier concerne la difficulté de ses textes, exigeants et parfois sibyllins. Le deuxième est relatif aux nombreuses controverses intellectuelles dans lesquelles il a été engagé — notamment avec John B. Foster ou Andreas Malm9 — et qui ont quelquefois tourné à l’avantage des auteurs qu’il critiquait. Enfin, le dernier élément est lié au champ éditorial de l’écologie française qui, à l’exception de quelques maisons d’édition, a joué un rôle important dans la structuration d’un antagonisme stérile entre « penseurs du vivant » et théorie critique du capitalisme. Or, l’œuvre de Moore constitue une tentative radicale pour refonder la critique du capitalisme sur une cosmologie non dualiste attentive à la puissance d’agir des travailleur·ses humains et des forces de la nature extrahumaine.
Les frontières du désastre : système-monde et colonisation
Ancien étudiant d’Immanuel Wallerstein, formé à la théorie du système-monde moderne10, Moore a toujours favorisé les approches de longue durée et à grande échelle. La théorie du système-monde partage avec les histoires globales l’idée que les phénomènes sociaux typiquement modernes doivent être compris dans leur interdépendance à l’échelle mondiale. Elle insiste donc, à la suite des travaux de Fernand Braudel dans Civilisation matérielle, économie et capitalisme, sur le rôle de la mondialisation des échanges commerciaux dans l’émergence du système-monde capitaliste plutôt que sur les rapports de production. Plus attentif que Wallerstein ou Braudel à la production capitaliste elle-même, Moore ne tombe cependant pas dans le piège qui consiste à traiter la production et la circulation des marchandises comme deux sphères économiques distinctes mais cherche au contraire à penser « le procès d’ensemble de la production capitaliste11 ». C’est la raison pour laquelle il adopte une perspective relationnelle sur l’espace social. Les lieux ne sont pas des points discontinus dans un espace vide et homogène mais doivent au contraire être pensés à partir des relations qui les constituent. Selon lui, l’espace est le produit d’un ensemble de rapports entre les humains et la nature et médié par des techniques d’appropriation et d’usage12. Cette perspective apparaît d’abord dans ses travaux sur la plantation coloniale comme matrice du capitalisme et de la crise écologique.

Dans un article de 2010 intitulé « Madère, le sucre, et la conquête de la nature dans le premier XVIe siècle », Moore élabore le concept de « frontière marchande » (commodity frontier), qu’il reprendra dans la plupart de ses travaux ultérieurs13. À la différence du concept de border, celui de frontier n’indique pas une limite absolue, une séparation linéaire matérialisée par la représentation d’un trait sur la carte ; il désigne plutôt une zone, un espace de conquête à la limite du territoire souverain de la nation14. Le capital marchand du XVIe siècle tire une large partie de ses profits de la vente de marchandises qui, bien qu’elles supposent d’importants investissements, permettent d’accaparer d’immenses réserves de nature bon marché. Comme l’écrit Moore, « un volume relativement faible de capital, soutenu par une puissance territoriale [coloniale], permet de s’approprier un grand nombre de dons de la nature15 ». Le trait fondamental de l’économie coloniale de la frontière marchande est donc sa capacité à « maximiser la productivité du travail par l’appropriation [gratuite] des natures biophysiques et humaines16 ». Elle réoriente toute l’écologie d’une région pour la mettre au service de la production de marchandises pour le profit. Ce faisant, l’exploitation raciste d’une force esclave noire, la destruction des écosystèmes par la monoculture intensive et l’accumulation de capital fonctionnent ensemble comme matrice de l’écologie-monde moderne.
Rapidement, les forêts de Madère sont complètement détruites par les déforestations nécessaires au raffinage du sucre de canne ; la fertilité des sols s’effondre, conduisant à une baisse de rentabilité de la plantation coloniale. S’ouvre alors une période de recherche de nouvelles bases écogéographiques de l’accumulation de valeur, du Brésil aux Philippines, en passant évidemment par les Caraïbes. Les frontières marchandes du capital colonial sont des lieux de conquête et d’accumulation, ruinés par la logique productive de la monoculture et de l’extractivisme, appauvris écologiquement et économiquement par leur intégration progressive au marché mondial capitaliste. Avant même qu’une frontière soit épuisée, le capital cherche la prochaine nature à approprier.
Cette causalité capitaliste-coloniale de l’écocide conduit Jason W. Moore à préférer au concept d’Anthropocène celui de Capitalocène. Il mobilise deux types d’arguments pour critiquer l’Anthropocène. Le premier, assez classique, consiste à montrer la causalité des structures de différenciation sociale dans l’émergence de la crise écologique. Pour le dire plus simplement, ce n’est pas l’Anthropos, l’humanité en tant qu’espèce, qui est responsable du désastre environnemental mais le capitalisme en tant que système d’appropriation généralisée du travail et des forces de la nature qui repose sur la propriété privée des moyens de vivre par la classe capitaliste. Cela permet de dénaturaliser la crise écologique : celle-ci n’est pas le résultat naturel de l’action d’une espèce biologique mais le produit historique d’un système social17. Le second argument de Moore concerne la temporalité, ce qu’il appelle le « biais conséquentialiste18 » des récits de l’Anthropocène. En effet, rares sont les penseur·ses à soutenir que l’humanité en général est responsable de la catastrophe globale. En général, pour les pensées de l’Anthropocène, il s’agit plutôt d’affirmer que le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité engagent l’humanité dans son ensemble, à l’avenir. Toute l’humanité subira les effets du changement climatique même si elle ne les subit pas de la même manière. C’est par exemple l’un des arguments de Dipesh Chakrabarty dans Après le changement climatique19. Or, Jason W. Moore est très sceptique quant à la possibilité de mener une critique sociale qui nomme les conséquences plutôt que les causes des destructions de l’environnement : si l’on veut éviter de reproduire les mêmes effets, il faut bien changer les causes elles-mêmes.
S’il faut repenser le capitalisme à partir de son histoire écologique, encore faut-il être prêt à repenser la nature à partir de son histoire sociale.
Les causes de la catastrophe écologique s’enracinent dans l’histoire globale du capitalisme. Voilà une thèse en apparence consensuelle mais qui engage en réalité une controverse avec deux positions dominantes dans l’écologie politique contemporaine. La première, qu’on qualifierait volontiers de « latourienne », refuse le concept de « capitalisme » au motif que la réalité qu’il désigne serait introuvable. En apôtres pragmatistes de Kant, les saint Thomas « capitalosceptiques » affirment à qui veut l’entendre que n’existe que ce dont on peut faire l’expérience, et que personne n’a jamais fait l’expérience d’une totalité. Ce à quoi Jason Moore répondrait que la vie moderne est une expérience historique mondiale : l’expérience des esclaves noirs dans les plantations ou des ouvrier·es blanc·hes d’Europe dérive de relations à une nature transformée par la révolution scientifique, d’une division internationale du travail, de flux de marchandises et de capitaux, de la mise en place d’un système raciale, d’une discipline du travail, de politiques impériales, bref d’un système-monde ou d’une écologie-monde qui ne se limite certainement pas à ce que la description de faits atomisés peut offrir.

La seconde position avec laquelle bataille Jason W. Moore relève d’un camp marxiste ou socialiste pour lequel le capitalisme est le déjà-là, le bien-connu, le familier. Les nouveaux attributs écologiques du capitalisme (écocide, Anthropocène, extinction) ne changeraient rien à la définition ordinaire de son concept. Nous savons déjà que le capitalisme est un système d’exploitation de la Terre et des travailleur·ses, rien de nouveau ne pourrait sortir d’une enquête sur sa trajectoire écologique mondiale. Or Moore n’a eu de cesse de montrer que le capitalisme est un système historique dont le devenir se comprend notamment à partir de ses relations à la nature. Les manières de s’approprier ou de transformer l’environnement changent les rapports sociaux. S’il faut repenser le capitalisme à partir de son histoire écologique, encore faut-il être prêt à repenser la nature à partir de son histoire sociale.
Ontologie de la nature et philosophie post-dualiste
Pour Moore, le problème ontologique fondamental de la modernité réside dans le dualisme nature-société. On veut généralement dire par là que nature et société sont deux substances séparées, ayant des attributs matériels et idéels distincts, et dotées d’histoires différentes. Selon lui, cette représentation de la nature se serait développée à partir du XVe siècle et serait progressivement devenue hégémonique à partir du XVIIe parce que le capital avait besoin de s’approprier une Nature bon marché, quantifiée, réduite à des unités de ressources qui peuvent facilement entrer dans la sphère de la production marchande, au moindre coût et donc au plus grand profit des capitalistes.
Comme beaucoup d’auteur·rices, Moore cède à un raccourci anticartésien qui frôle parfois le contre-sens : par exemple, lorsqu’il affirme que « le vocabulaire cartésien du changement social a la vie dure20 ». Descartes n’est ni un penseur de l’histoire ni un penseur de la société, encore moins de la culture. N’en déplaise à ses pourfendeurs contemporains, il n’est certainement pas un philosophe du dualisme nature-société mais de la dualité âme-corps qui, pour n’en n’être pas moins problématique, ne relève pas exactement de la même discussion. Moore a néanmoins raison d’insister sur le problème que soulève un « dualisme de substance », c’est-à-dire l’idée qu’il existerait deux ordres de réalité très différents et relevant de régions séparées de l’être. Il formule donc une ontologie générale ambitieuse pour répondre à ce problème.
Il avance que l’idée d’une nature inerte, objective, extérieure aux sociétés humaines correspond à une construction qui se répand à partir d’un ensemble de pratiques de quantification et de mesure. Cette nature extérieure, quantifiable et appropriable, il l’appelle « nature sociale abstraite ». Ce concept a deux origines philosophiques distinctes. Forgée par analogie avec l’expression marxienne de « travail abstrait », « la nature sociale abstraite » désigne toutes les procédures de calcul et de symbolisation permettant la marchandisation de la nature, c’est-à-dire l’échange d’une certaine quantité de ressources contre une autre marchandise de valeur « équivalente ». La nature sociale abstraite désigne donc à la fois l’ensemble des dispositifs techniques permettant la mise en équivalence généralisée des biens naturels (de la cartographie à l’établissement d’unités de poids et de mesures) et le résultat symbolique de cette marchandisation.

La seconde origine philosophique de l’idée de nature sociale abstraite provient du philosophe francfortois Alfred Sohn-Rethel, qui avait développé le concept d’« abstraction réelle21 » pour désigner une abstraction résultant d’un processus socio-historique et non d’un processus mental. Cette abstraction serait réalisée dans l’échange marchand en tant qu’il suppose de manière provisoire la suspension de l’usage de la marchandise échangée : la marchandise est l’objet de l’échange dans la mesure où sa valeur d’usage est provisoirement abstraite, suspendue, au profit d’une prise en compte de la seule valeur d’échange. Pour Moore, la nature devient un concept ontologiquement séparé parce qu’on a d’abord fait abstraction de toutes ses déterminations concrètes dans l’échange marchand, qui rend strictement équivalentes des quantités de matières et d’énergies qui sont pourtant le résultat de processus naturels, hautement spécialisés, différents, multiples et évolutifs. Moore applique la même critique à la question des races, des genres et des nations22.
D’autre part, il affirme qu’il n’existe pas une nature mais des natures historiques. Dans la mesure où les entités extrahumaines ont une histoire sociale, il faut reconnaitre leur historicité et leur pluralité. La nature de Madère avant le XVe siècle n’est certainement pas identique à celle qu’offrent les paysages productifs dévastés de l’exploitation coloniale. Entre une nature sauvage, en libre évolution et une nature domestiquée et exploitée, l’écart est grand. Suivant une thèse déjà défendue en histoire environnementale, notamment par William Cronon, les natures sont donc multiples et historiques. Pourtant, cette thèse se développe parfois dans une confusion entre des propositions ontologiques différentes et qui gagneraient à être distinguées.

L’histoire écologique du capitalisme et l’histoire capitaliste de la nature constituent ce que Moore appelle la « double internalité ». Le capital émerge à partir de réalités bio-géo-physiques (des corps humains, des énergies fossiles, de l’eau, du vent, etc.) et la nature elle-même semble intériorisée par le capitalisme. En effet, toutes les énergies et les matières qu’elle fournit sont intégrées à l’économie humaine mais le capitalisme intériorise aussi les fonctions reproductives des écosystèmes pour traiter ses déchets et ses pollutions. Avec le capital, l’atmosphère apparaît comme une gigantesque usine de recyclage de l’air grâce à la captation de CO2 par les plantes. Les marchés carbones, par exemple, intègrent l’atmosphère à l’économie capitaliste et la transforment en « éboueur non rémunéré23 ». Pour penser l’unité commune de cette double internalité, Moore forge le concept d’oikeios, qui désigne un ensemble de flux et d’écosystèmes à partir desquels et au travers desquels les pratiques humaines se déploient. L’oikeios, c’est la totalité englobante du capitalisme et du tissu de la vie, des tendances écocidaires du capital et de l’habitabilité des faiseurs de monde humains et extrahumains.
Le rejet du cartésianisme s’accompagne parfois d’un refus un peu rapide de la méthode analytique qui fournit les moyens d’une clarification conceptuelle.
Cependant, le fait que la nature soit intégrée aux circuits du capital et que celui-ci n’existe que dans la nature n’implique pas que la nature n’a pas une histoire autonome, une histoire propre et singulière. En d’autres termes, la nécessité d’adopter une ontologie relationnelle et processuelle ne signifie pas qu’il faille refuser les discontinuités réelles entre entités naturelles et dispositifs techniques, par exemple. Or l’ontologie moniste de Moore semble parfois dénier l’altérité des processus naturels affectés par le capitalisme. Pourtant, ces deux thèses ne sont pas inconciliables, loin s’en faut. On peut très bien critiquer la tendance du capitalisme à internaliser la nature dans son propre procès de développement et défendre l’autonomie de processus naturels par rapport aux modifications techniques qui les prennent pour objet24. Une pensée dialectique suppose précisément que les entités distinctes de la nature et de la société soient posées, dans leur différence, par la relation qui les unit. À cet égard, l’unité apparaît comme le résultat d’une relation processuelle qui fabrique de la différenciation. La domestication en serait un bon exemple. Il s’agit d’une relation qui fabrique de la différenciation entre la nature domestiquée et la nature « domestiquante » et qui, par cette relation différenciante, constitue un type d’unité hiérarchisée entre les vivants humains et autres qu’humains. La prédation constitue un autre type d’unité différenciante entre humains et non humains.
Le rejet du cartésianisme s’accompagne parfois d’un refus un peu rapide de la méthode analytique qui fournit les moyens d’une clarification conceptuelle. Pourtant, avec sa théorie de l’écologie-monde, Moore propose en même temps une redéfinition tout à fait nécessaire et originale de l’écologie du capital.
L’écologie-monde et la critique du capital
Selon Moore, l’accumulation du capital ne peut fonctionner que selon une double logique de « capitalisation de la production » et d’« appropriation de la reproduction ». La capitalisation suppose l’exploitation capitaliste du travail humain, seul producteur de survaleur, et la marchandisation des forces naturelles. L’appropriation désigne au contraire une manière d’accumuler des conditions de reproduction nécessaires à la valorisation sans rémunération ou sans paiement du travail/de l’énergie fournis par la nature, humaine et non humaine. Par exemple, le travail du soin peut être approprié gratuitement (sans rémunération) dans le cadre de la famille bourgeoise ou être, au contraire, « capitalisé » dans le cadre d’une crèche privée où les travailleuses vendent leur force de travail à des capitalistes qui tirent un profit de la vente des services de soin fournis aux enfants.
Dans le capitalisme, la catégorie de nature renvoie à l’ensemble des réalités dévalorisées, celles qui font l’objet d’une appropriation gratuite ou d’une très faible capitalisation.
Pour Moore, il en va de même pour toutes les forces naturelles : elles peuvent être soit appropriées sans rémunération, ou en tout cas au moindre coût, soit capitalisées, c’est-à-dire transformées en marchandises par un investissement en capital plus important. Par définition, le capital ne peut s’accumuler que par cette double logique simultanée d’exploitation de la force de travail humaine (productrice de survaleur) et d’« appropriation des capacités de la nature à produire la vie25 ». Plus la nature est capitalisée, plus les coûts de production augmentent et plus le taux de profit baisse. Le taux de profit est donc, en partie, relatif à la différence entre la quantité de capital investi et le volume de travail/d’énergie non rémunérés que ce taux de capitalisation permet de s’approprier. Pour donner un exemple, s’il est facile d’avoir accès à du pétrole, les coûts de production sont moins élevés et le taux de profit augmente. Cependant, pour s’approprier toujours plus de forces naturelles, il n’existe que deux moyens : ou bien l’extension du pouvoir étatique-impérial-colonial, qui garantit l’accès à des territoires et à des ressources bon marché en engageant lui-même les dépenses nécessaires à cette extension ; ou bien la capitalisation des natures, c’est-à-dire l’investissement toujours plus important en capital constant et en capital variable, qui conduit à la chute du taux de profit dans le secteur concerné. La dialectique de la capitalisation et de l’appropriation constitue le cœur de la théorie de la Nature bon marché élaborée par Moore.
Lire sur Terrestres, les extraits du livre de Moore et Patel Comment notre monde est devenu cheap, mai 2019.
La notion de Nature bon marché désigne l’ensemble des forces naturelles et des stocks de ressources qui peut être approprié à des coûts suffisamment bas pour favoriser l’accumulation du capital. La principale contradiction écologique du capitalisme provient du fait qu’il a besoin de Natures bon marché mais qu’il épuise en même temps la possibilité de les reproduire26. Ou bien les natures historiques sont détruites, annihilées par la logique extractiviste du capital, comme dans le cas d’écosystèmes effondrés (les îles de Madère constituent l’un des premiers exemples historiques, désormais nombreux, d’un tel effondrement colonial), ou bien la nature continue à fournir du travail/de l’énergie mais à un coût qui ne permet plus l’accumulation de valeur.

Dans son premier ouvrage, Le Capitalisme dans la toile de la vie, Moore répertoriait quatre éléments caractéristiques de la Nature bon marché : force de travail, nourriture, énergie et matières premières. Dans Comment notre monde est devenu cheap, paru en français en 2018, Jason W. Moore et Raj Patel recensaient désormais « sept choses cheap » : la nature, l’argent, le travail, le soin, la nourriture, l’énergie et les vies humaines. Or, ce catalogue à la Prévert complexifie le tableau originel puisque la nature n’est plus la catégorie englobante des « choses cheap ». Il semble manquer ici un critère clair d’établissement de la liste : s’agit-il des conditions de reproduction de la seule force de travail ? ou bien des conditions naturelles de tous les moyens de production (capital constant et capital variable réunis) ? Néanmoins, l’idée générale est la suivante : le capitalisme a besoin de s’approprier les conditions de reproduction de la force de travail au plus bas coût possible, c’est-à-dire avec la capitalisation la plus faible possible. Plus il se les approprie, plus il les épuise et plus il a donc besoin de les capitaliser, ce qui conduit à une baisse du taux de profit. C’est la raison pour laquelle les « frontières marchandes » se déplacent, à la fois dans l’espace et dans le temps, en entraînant la multiplication des « cheap things ».
Dans le capitalisme, la catégorie de nature renvoie à l’ensemble des réalités dévalorisées, celles qui font l’objet d’une appropriation gratuite ou d’une très faible capitalisation. C’est donc un système qui vise l’accumulation par exploitation du travail payé et dévalorisation permanente des conditions de la vie. Alors que « toutes les espèces travaillent, à leur manière », la seule à percevoir un salaire et donc à produire une survaleur est l’espèce humaine. La possibilité de la capitalisation de la force de travail humaine détermine une intégration différenciée des corps des travailleur·ses au circuit de la valorisation selon des rapports de classe, de race et de genre. La force de travail productive est valorisée, c’est-à-dire qu’elle produit de la valeur, mais exploitée (une partie seulement de la valeur produite est rémunérée) ; la force de travail reproductive est dévalorisée, c’est-à-dire qu’elle ne participe que marginalement au procès de valorisation capitaliste et qu’elle est donc appropriée dans la violence. Comme les autres forces naturelles de production, le travail reproductif tend à être réduit à un don gratuit de la nature. Dans la logique du capital, les réalités naturelles n’ont pas de valeur morale, parce que ce qui ne produit pas de valeur économique n’en a aucune. La dévalorisation économique du travail de reproduction des conditions de la vie légitime sa relégation sociale et politique et prive les travailleur·ses de toute intégrité morale et physique. Pour le capital, la nature est l’ensemble des réalités qui, n’ayant pas de valeur, sont disponibles pour l’appropriation.
Conclusion
« Wall Street est une manière d’organiser la nature27. » Cette formule provocatrice résume la thèse la plus originale de Moore dans l’écologie politique contemporaine. Elle signifie qu’un mode de production, une société technique ou une civilisation matérielle émergent toujours à partir du tissu de leurs relations avec des natures historiques. Même dans sa version la plus spéculative — le capitalisme financier incarné par la Bourse de New York —, l’économie est façonnée par les natures qu’elle s’approprie et qu’elle transforme. En d’autres termes, le capitalisme n’a pas une écologie, il est une écologie, un ensemble de processus, de flux de matières et d’énergies ayant sa place au sein d’une totalité entropique, le tissu de la vie, l’oikeios. L’écologie-monde du capital réoriente en permanence les flux de matière et d’énergie au service de l’accumulation de valeur, elle façonne des environnements et des milieux autant qu’elle les annihile. Le capital n’est pas qu’un destructeur de monde, il est aussi un faiseur de mondes appauvris et de travailleurs·ses aliéné·es. Mais alors, quelle politique construire pour lutter dans et contre l’écologie-monde ?

Si Moore élabore une ontologie générale, il lui manque encore la théorie d’une stratégie révolutionnaire. Il n’est en effet pas très prolixe sur la question stratégique. On peut néanmoins identifier trois propositions politiques, plus ou moins implicites. La première consiste en une théorie de l’effondrement : en raison de la tendance à la baisse du taux de profit et de l’augmentation du prix des cheap natures, le capital risque de rencontrer ses propres limites internes de développement. Mais cette première piste ne précise pas comment l’effondrement va advenir. Est-ce par un « collapse » du système ou par une radicalisation des antagonismes sociaux et de la lutte des classes ? Deuxièmement, la fin de Comment le monde est devenu cheap permet d’imaginer que l’effondrement sera l’œuvre d’un front unique du prolétariat regroupant les mouvements féministes et LGBTQIA+, l’antiracisme politique et les luttes de classe du mouvement ouvrier. Mais il faut bien reconnaitre que l’appel à la convergence n’est pas le garant d’une tactique efficace. Peut-être se dessine alors une troisième voie chez Moore, qui consiste, en reprenant le mot d’ordre du salaire pour le travail domestique, à faire pression sur les capitalistes en intégrant aux prix de production les coûts de reproduction des écosystèmes. Aussi révélatrice qu’il ait été pour le mouvement féministe, cette tactique n’exprime pas l’espoir réel d’obtenir une telle rémunération, car les capitalistes seraient tout simplement dans l’impossibilité matérielle de payer ce qu’ils détruisent et s’approprient. La perspective stratégique la plus adéquate à la pensée de Moore est peut-être à chercher du côté de l’opéraïsme écologique de Léna Balaud et Antoine Chopot : si l’accumulation du capital suppose la mise au travail de toutes les forces naturelles, la stratégie qui s’impose est celle du refus du travail. La grève écologique des forces productives du capital serait la tactique essentielle du communisme de la vie.
Pour prolonger, lire aussi sur Terrestres le texte de Léna Balaud et Antoine Chopot, « Suivre la forêt. Une entente terrestre de l’action politique », novembre 2018.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Voir Jason W. Moore, « Au-delà de l’écosocialisme : une théorie des crises dans l’écologie-monde capitaliste », trad. fr. B. Bürbaumer, Période, 16 mars 2015 ; et Jason W. Moore, « La nature du capital : un entretien avec Jason W. Moore », trad. fr. J. Farjat, Période, 30 novembre 2015.[↩]
- Pour l’une des premières apparitions académiques francophones de Moore, on consultera par exemple, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, « Capitalocène : une histoire conjointe du système-terre et des systèmes-mondes », in G. Allaire et B. Daviron (dir.), Transformations agricoles et agroalimentaires, Versailles, Quae, 2017, p. 42, n. 29.[↩]
- Jason W. Moore, « Madeira, Sugar, and the Conquest of Nature in the “First” Sixteenth Century, Part I: From “Island of Timber” to Sugar Revolution, 1420-1506 », Review, 2009,vol. 32, n°4, p. 345-390 ; et Jason W. Moore, « Madeira, Sugar, and the Conquest of Nature in the “First” Sixteenth Century, Part II: From Regional Crisis to Commodity Frontier, 1506-1530 », Review, 2010, vol. 33, n°1, p. 1-24.[↩]
- Jason W. Moore, Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital, Londres et New York,Verso, 2015.[↩]
- Intervention au Séminaire « Gouverner le vivant : savoirs, cultures et politiques de la biodiversité », Museum national d’histoire naturelle, 12 juin 2015.[↩]
- Voir par exemple Donna Haraway, « Anthropocène, Capitalocène, Plantationocène, Chthulucène. Faire des parents », trad. fr. Fr. Neyrat, Multitudes, 2016/4, n°65, p. 75-81 ; et l’entretien de Joseph Confavreux et Jade Lindgaard dans « Jason W. Moore : “Nous vivons l’effondrement du capitalisme” », Mediapart, 13 octobre 2015.[↩]
- Armel Campagne, Le Capitalocène. Aux racines historiques du dérèglement climatique, Paris, Divergences, 2017 ; François Jarrige, La Ronde des bêtes. Le moteur animal et la fabrique de la modernité, La Découverte, Paris, 2023 ; Léna Balaud et Antoine Chopot, Nous ne sommes pas seuls. Politique des soulèvement terrestres, Paris,Le Seuil, 2019. Il est désormais un auteur incontournable des études marxistes francophones comme en témoigne le travail de jeunes chercheur·ses en philosophie (Marius Bickhardt, Cannelle Gignoux, Benjamin Gizard, Sara Marano ou Aimé Paris).[↩]
- Jason W. Moore, Le Capitalisme dans la toile de la vie. Écologie et accumulation du capital, trad. fr. R. Ferro, Toulouse, L’Asymétrie, 2020.[↩]
- Voir par exemple John B. Foster et Ian Angus, « En défense du marxisme écologique : John Bellamy Foster répond à un critique », Le Capitalisme dans la toile de la vie. Site associé au livre, 27 novembre 2020 ; ou Andreas Malm, « Nature et société : un ancien dualisme pour une situation nouvelle », trad. fr. J.-Fr. Brissonnette, Actuel Marx, n° 61, 2017, p. 47-63.[↩]
- Voir Immanuel Wallerstein, Le système du monde du XVe siècle à nos jours, trad. fr. C. Markovits, 3 vol.,Paris, Flammarion, 1980-1984.[↩]
- Karl Marx, Le Capital. Livre troisième, trad.fr. C. Cohen-Solal et G. Badia, Paris,Éditions sociales, 1969.[↩]
- Moore s’inscrit dans l’héritage d’Henri Lefebvre, La Production de l’espace, Paris, Anthropos, 2000 ; et de David Harvey, Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development, Londres et New York, Verso, 2006.[↩]
- Voir par exemple Jason W. Moore et Raj Patel, Comment notre monde est devenu cheap. Une histoire inquiète de l’humanité, trad. fr. P. Vesperini, Paris, Flammarion, 2018.[↩]
- Voir par exemple William Cronon, « Revisiter la frontière disparue : l’héritage de Frederick Jackson Turner », Nature et récits. Essais d’histoire environnementale, Paris, Dehors, 2016.[↩]
- Jason W. Moore, « Madeira: Part II », art. cité, p. 4.[↩]
- Ibid., p. 5.[↩]
- Ces arguments ont par ailleurs été longuement développés, de manière tout à fait convaincante, dans Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’Événement Anthropocène, Paris, Le Seuil, 2015 ; et dans Razmig Keucheyan, La Nature est un champ de bataille. Essai d’écologie politique, Paris, Zones, 2014.[↩]
- Jason W. Moore, Le Capitalisme dans la toile de la vie, op.cit., p. 239.[↩]
- Dipesh Chakrabarty, Après le changement climatique, penser l’histoire, trad. fr. A. de Saint-Loup et P.-E. Dauzat, Paris, Gallimard, 2023.[↩]
- Jason W. Moore, Le Capitalisme dans la toile de la vie, op.cit., p. 277.[↩]
- Alfred Sohn-Rethel, « Travail intellectuel et travail manuel », La Pensée-marchandise, trad. fr. G. Briche et L. Mercier, Bellecombes-en-Bauge, Éditions du Croquant, 2010.[↩]
- Voir par exemple Jason W. Moore et Raj Patel, Comment notre monde est devenu cheap, op. cit., p. 180-200.[↩]
- Jason W. Moore, Le Capitalisme dans la toile de la vie, op.cit., p. 146.[↩]
- On trouve sans doute l’une des pistes les plus convaincantes pour penser cette relation historique entre nature et société dans le cadre d’une ontologie du capitalisme dans l’ouvrage de Frédéric Monferrand, La Nature du capital. Politique et ontologie chez le jeune Marx, Paris,Amsterdam, 2024.[↩]
- Jason W. Moore, Le Capitalisme dans la toile de la vie, op.cit., p. 138.[↩]
- Ibid., p. 161.[↩]
- Jason W. Moore, « Au-delà de l’écosocialisme », art. cité.[↩]