Nous vivons un moment étrange et paradoxal : les gouvernements et les grandes figures du capitalisme ne cessent d’en appeler à la sobriété, à modérer les consommations, à freiner les gabegies autrefois considérées comme nécessaires au fonctionnement de l’économie et à la relance de la croissance. Mais ces appels incessants semblent d’abord viser à préserver le modèle économique dominant dans un contexte de turbulences écologiques et géopolitiques inédit : baisser le chauffage et restreindre les consommations doit permettre d’éviter les rationnements et les coupures de courant lors des phases de tensions sur le réseau, il s’agit de conjurer le spectre du Black Out et de la panne générale désormais au cœur de toutes les préoccupations.
Loin d’initier un basculement et une bifurcation vers des modes de vie plus sobres et la réinvention d’autres liens au vivant comme aux objets qui peuplent nos vies, ces appels à la sobriété ressemblent de plus en plus à des stratégies désespérées pour maintenir nos modes de vie « non négociables », sauver ce qui peut encore l’être de l’ancien monde, en évitant les réorientations plus radicales que beaucoup appellent désormais de leurs vœux. « En aucun cas, la France ne court un risque de ‘black-out’» assurait RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité dans un communiqué rassurant du 14 septembre 2022. Les grandes pannes ne sont pourtant pas rares ces dernières années : en juin 2019, une immense panne liée à des problèmes d’interconnexion du réseau électrique a privé de courant 50 millions de personnes en Argentine et au Paraguay. Lors de la dernière rentrée de septembre 2022, le spectre de la panne n’a cessé de s’accentuer et de planer sur les débats politiques et médiatiques, l’arrêt de certains réacteurs nucléaires pour maintenance, les interruptions d’approvisionnement liés à la guerre en Ukraine, font craindre la multiplication des pannes et relancent le spectre de la pénurie et l’arrêt des flux énergétiques qui conditionnent nos vies.
Les économies et les modes de vie– en dépit de très fortes inégalités – sont devenus dépendants d’approvisionnements en combustibles ou en électricité pour une grande diversité de besoins, qu’il s’agisse du transport et du chauffage, ou pour alimenter le monde numérique en expansion. Diminuer l’éclairage public, baisser d’un degré l’eau des piscines, développer le co-voiturage, ou fermer deux semaines les universités, autant de solutions pour conjurer le spectre de la panne générale qui offriront au mieux des pansements provisoires, sans jamais enrayer le processus. Comme la pénurie qui a ressurgi au cœur des préoccupations, la question de la panne hante les sociétés high Tech contemporaines, elle interroge ses modes d’existence, ses impasses, comme ses possibilités de bifurcation.
Présentées comme le fruit d’une défaillance passagère, ou d’une catastrophe naturelle qui peut être réparée, les pannes sont renvoyées à des dysfonctionnements d’un monde technique qui serait par ailleurs de plus en plus robuste et efficace. Mais la panne, en particulier électrique, devient aussi un symbole, un marqueur, un signe qui révèlent la fragilité croissante de monde interconnecté et de l’hyperpuissance technologique. Il est vain de vouloir quantifier et mesurer les pannes pour savoir si le phénomène régresse ou augmente, c’est la nature même de ce qu’on nomme panne qui se transforme et change de signification parallèlement aux dépendances énergétiques et au développement des systèmes techniques à grande échelle.
Les sciences sociales s’emparent de plus en plus de ces enjeux, elles semblent même opérées aujourd’hui un tournant en faveur de l’étude des processus matériels, de leur dysfonctionnement, de leur maintenance comme de leur renouvellement. De nombreux travaux invitent à repenser nos rapports aux infrastructures et aux objets, à être davantage attentifs au soin que les acteurs portent aux choses, et comment celles-ci se reproduisent, persistent et se transforment. Nous sommes en effet insérés dans un système technique toujours plus complexe dont la panne électrique devient l’une des manifestations, même si les sources de fragilité sont nombreuses à l’ère numérique et des flux incessants de données. Nous pensons que ces enjeux sont essentiels à l’élaboration d’une politique terrestre. En partant d’une brève réflexion sur la généalogie historique de la question des pannes, ce papier entend présenter certains ouvrages et propositions récentes qui s’efforcent de repenser notre rapport aux techniques à l’heure des catastrophes écologiques globales.
La question de la panne : généalogie et histoire
La question des pannes occupe une place privilégiée parmi les risques systémiques contemporains. Elle représente une menace à mesure que s’accroît la complexité et le gigantisme des équipements techniques, mais aussi nos dépendances à l’égard des combustibles fossiles et des grands réseaux d’approvisionnement électrique. Les pannes sont la manifestation frappante de la « fragilité de la puissance », l’envers de notre quête de sécurité et de notre sentiment de maîtrise1.
Les dernières années ont d’ailleurs été marquées par le retour régulier du spectre de la panne et de l’accident, dans la foulée des grands accidents nucléaires et des catastrophes écologiques comme les marées noires ou les explosions d’usine comme Lubrisol : peu avant le Covid, les années 2017-2018 ont aussi été marquées en France par quelques pannes électriques géantes, comme en novembre où la moitié de la Corse a été privée d’électricité pendant plusieurs heures. Une autre panne a bloqué un important hébergeur de sites internet, alors que d’autres ont paralysé le trafic de la gare Montparnasse. Hors de France, de nombreuses pannes ont été signalées au cours des dernières années. Le Costa Rica a connu une panne quasi générale de courant alors que l’aéroport d’Atlanta, aux États-Unis – le plus grand du monde –, a été victime d’une énorme panne qui a affecté des centaines de vols et des milliers de passagers. En Amérique latine, le manque d’entretien et d’investissement des infrastructures conduit régulièrement à des pannes d’électricité. Toutes ces défaillances des grandes infrastructures modernes, pensons encore aux ponts qui s’effondrent, censées se caractériser par leur solidité et leur résistance, ont donné naissance à un courant d’étude qui se consacre désormais à l’étude des fragilités et défaillances des techniques modernes2.
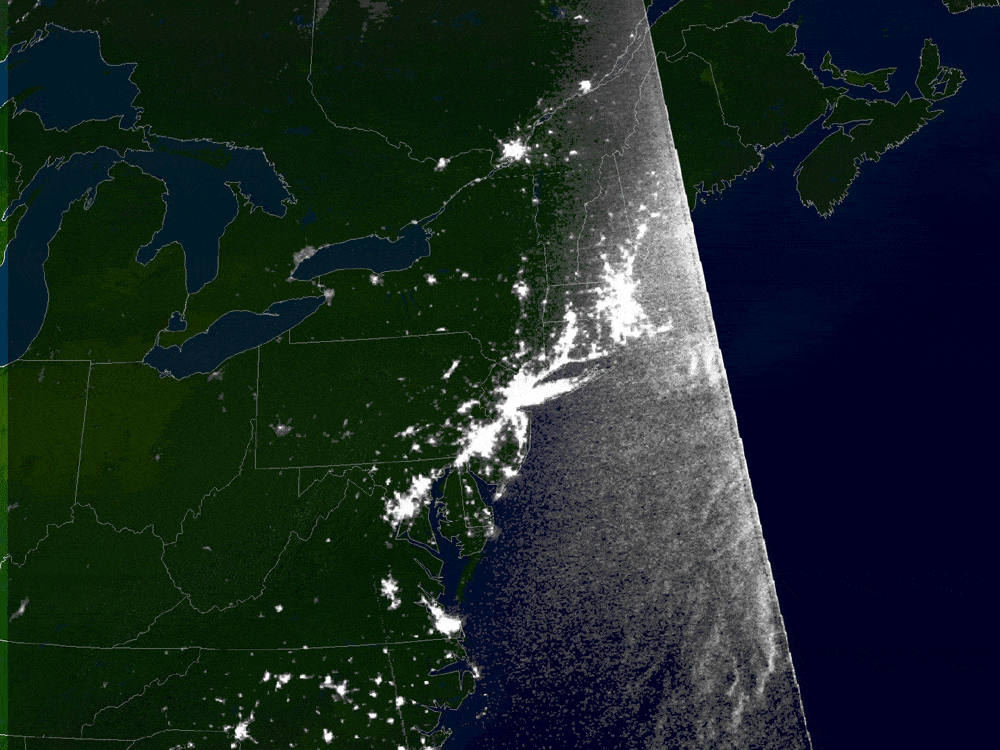
La question de la panne et de l’accident, longtemps secondaire, ou jugée périphérique, acquiert dans ce contexte une centralité croissante pour penser le monde contemporain et ses contraintes matérielles. Pour les sciences sociales, la panne et l’accident sont même devenus des outils de réflexion et de problématisation de ce qui nous arrive ; dès le début des années 1990 les science studies en ont fait un enjeu de réflexion pour problématiser nos dépendances aux grands systèmes techniques, inaugurant de plus en plus travaux consacrés aux risques, à leur gestion3.
Le Black Out, l’accident spectaculaire, ou la panne sont en effet des événements qui remettent en cause l’ordre naturel des choses, et qui ouvrent donc des fenêtres sur ce qui reste généralement dissimulé. Ils permettent de penser des aspects jusque-là négligés des infrastructures techniques, de leur fonctionnement, comme de l’expérience des usagers : « en forçant l’ouverture des boîtes noires, l’accident ou la panne dévoilent des éléments constitutifs hétérogènes jusque-là « pliés » dans l’objet et rendus invisibles par l’usage ordinaire » constatent ainsi deux sociologues auteurs d’un ouvrage récent et stimulant sur ces questions4.
Envisager la question de la panne, ses formes, la façon dont elle modèle les sociétés, et les réponses qui lui sont apportées, implique d’interroger son historicité tant ce qu’on nomme panne a changé parallèlement aux mutations des régimes sociotechniques et aux évolutions du monde industriel. La panne peut être définie comme l’arrêt accidentel de fonctionnement d’un système technique. Avant le XXe siècle, le mot était peu utilisé et recouvrait des significations toutes autres. Dans le vocabulaire de la marine par exemple, il renvoyait ainsi à l’action de ralentir. Au XVIIIe siècle l’expression « en panne » passe dans le langage courant au sens figuré pour désigner l’attente ou l’impossibilité d’agir. Au début du XIXe siècle, la panne désigne encore une peau chargée de graisse comme dans le cochon, ou bien une étoffe de soie ; dans les métiers du bâtiment la panne est aussi une pièce de bois utilisée dans les charpentes. Le mot se répand ensuite au XIXe siècle dans le sens d’un arrêt de fonctionnement d’un mécanisme5.
Si les cultures matérielles préindustrielles étaient frustes, elles étaient aussi souvent très robustes, la complexité des agencements était réduite, les mécanismes étaient fabriqués sur place au moyen de pièces et de matériaux facilement remplaçables par les artisans du lieu, limitant les risques de pannes et les difficultés à les résoudre. Les paysans et artisans, tous généralement pluriactifs, maîtrisaient de nombreux savoir-faire techniques dont nous avons même perdu l’idée, ils pouvaient réparer eux-mêmes leurs outils, appartenaient à des cultures populaires qui se caractérisaient par la richesse et la diversité des savoirs pratiques, manuels, par leurs compétences diversifiées qui n’ont cessé de s’appauvrir au fur et à mesure de la spécialisation des tâches.
Avec l’industrialisation et la complexité croissante des équipements techniques, le mot panne a de plus en plus été renvoyé à l’arrêt d’un mécanisme. L’obsession pour les pannes s’étend alors peu à peu, parallèlement à l’arrivée de machines-outils et de moteurs de plus en plus puissants et difficiles à réparer, comme les machines à vapeur puis les moteurs à explosion, confiés à des spécialistes et des experts, et couplés aux premiers réseaux techniques comme le chemin de fer et le télégraphe au XIXe siècle, avant les grands réseaux électriques du XXe siècle.
L’essor du nouveau régime énergétique fossile et la dépendance croissante au charbon puis au pétrole a accentué les craintes de pénurie et les inquiétudes face à la panne générale que provoqueraient l’arrêt de l’approvisionnement énergétique du fait de l’épuisement de la ressource, mais aussi des grèves, des sabotages, des accidents ou des dysfonctionnements. Le spectre d’une pénurie de carburant interrompant le fonctionnement des économies n’a cessé d’accompagner l’accroissement des dépendances énergétiques. Dès le XIXe siècle les alertes se multiplient, notamment après la signature du traité de libre-échange franco-anglais de 1860 qui libéralise les échanges entre les deux pays. Le Parlement britannique s’inquiète alors de la menace qui pèse sur la suprématie du pays du fait de l’épuisement programmé des réserves de charbon, qui menace d’arrêter les activités industrielles. 30 ans plus tard, vers 1900, c’est le spectre du mouvement ouvrier et révolutionnaire qui hante la société lorsque la menace de grève générale s’affirme comme un outil de lutte qui risque d’interrompre les flux de matières en multipliant les pannes et l’arrêt des systèmes.
Dépendances électriques et nouvelles fragilités
L’essor de l’électrification à la fin du XIXe siècle inaugure un nouvel environnement technique mais aussi un nouveau régime et un nouvel imaginaire de la panne. Source d’enthousiasme et de foi dans le progrès pour les uns, l’électricité a aussi été dès le début une source d’inquiétudes pour d’autres, à l’image d’Albert Robida peignant dans son livre La Vie électrique (1892) un avenir de catastrophes. Au cours du XXe siècle, l’électricité devient un moyen essentiel pour transporter l’énergie, alors que les grands réseaux s’étendent sur des distances toujours plus importantes. La maîtrise des flux électriques fonde peu à peu un nouveau modèle économique, qui tend à irriguer l’ensemble des pays industrialisés. Produite à partir de sources d’énergie primaire (hydraulique, thermique ou, plus tard, nucléaire), l’électricité a été utilisée pour de très nombreux usages domestiques et industriels et a rendu possible la mécanisation du quotidien. C’est elle qui actionne presque la totalité des artefacts qui peuplent les lieux de vie et de travail. Cette dépendance croissante à l’égard de l’approvisionnement électrique, pour se chauffer et s’éclairer, pour communiquer et aujourd’hui pour presque toutes les actions, a fait dès le début de la panne électrique un spectre terrifiant et omniprésent6. Au fur et à mesure où s’installent nos « servitudes électriques », l’interruption du courant devient de plus en plus effrayante.

Lorsque le flux électrique servait d’abord à éclairer les théâtres et les quartiers huppés avant 1914, son interruption restait un risque secondaire. Mais peu à peu l’emprise électrique s’est accentuée, et elle triomphe aujourd’hui avec le numérique et les innombrables incitations à tout électrifier : d’un luxe pour certains l’électrification est devenue un nouveau milieu de vie, l’accès au courant s’affirmant comme un droit fondamental, son interruption devenant un scandale insupportable qui menace de tout bloquer7.
Dès le début de l’électrification, la panne devient une obsession qui envahit la presse populaire. Elle est soit causée par les grèves des électriciens, soit par la défaillance des moteurs des centrales, soit par des coupures dans l’alimentation. Elles sont fréquentes, justifient la prudence et modèlent les premières utilisations. Dans le petit village bourguignon de Sacquenay en 1929, comme dans des milliers d’autres, l’éclairage électrique existe depuis déjà deux ans, pourtant « les vieilles lampes à pétrole ne sont pas encore mortes » car la population a souvent à se « plaindre des pannes électriques 8. » Dans les Ardennes, un inspecteur du travail enquêtant sur l’électrification des petits ateliers observe en 1924 que « le nombre de pannes électriques est incalculable et, quand on pense qu’une grève ou une avarie d’une seule usine génératrice peut arrêter tout un département, on comprend que, dans l’espèce, l’électricité ne constitue pas un progrès9 ».
D’abord locale, limitée à un quartier ou à une ville, la panne s’étend à partir des années 1930, lorsque les petits réseaux locaux de production et de distribution laissent la place à des infrastructures centralisées reliées par des lignes à haute tension couvrant d’immenses distances. Dès lors naît la crainte du Black-Out, c’est-à-dire la coupure générale interrompant toutes les activités d’une région ou d’un pays. Expression anglo-américaine utilisée à l’origine dans le théâtre pour décrire l’extinction des feux, le « black-out » désigne pendant la Seconde Guerre mondiale l’interruption de l’éclairage lors des bombardements. Après 1960, il désigne le spectre d’une panne générale d’électricité qui plongerait les populations dans l’effroi et conduirait à l’effondrement des institutions comme des activités économiques10.
À l’époque de la Guerre froide, la panne électrique est souvent considérée à l’Ouest comme une manifestation de défaillance et de retard technique, comme la preuve de l’infériorité du communisme soviétique. Mais les puissances industrielles de l’Ouest sont elles aussi régulièrement victimes de pannes, aux effets de plus en plus spectaculaires et médiatisées. En 1965, une panne gigantesque du réseau entre le nord des États-Unis et le Canada touche plus de 30 millions de personnes alors que 800 000 usagers sont bloqués dans le métro new-yorkais. En juillet 1977, une autre panne plonge New York dans le noir, entraînant des pillages et des émeutes. En France, les autorités engagées dans le programme d’électrification et de construction de centrales nucléaires promettent que ce type d’incident serait impossible dans l’hexagone. Pourtant, quelques mois après, en décembre 1978, à la suite d’un pic de consommation dû au froid, une panne frappe aussi une grande partie du pays.
L’installation du parc nucléaire a été justifiée dans ce contexte comme une manière de pallier ces risques, d’abolir la menace de la panne en offrant une production massive et robuste. C’est ainsi que les promoteurs de la trajectoire nucléaire ont imposé le nucléaire, renforçant le sentiment qu’il existerait une source d’énergie infinie, soi-disant « propre », susceptible de répondre à tous les besoins11. Mais les catastrophes de Tchernobyl puis de Fukushima, l’obsédante question des déchets, l’échec des grands projets EPR, la fragilité des centrales à l’arrêt et leur dépendance au niveau des cours d’eau, ne cessent d’invalider ces promesses d’une énergie sûre et bon marché.
Alors que l’électrification du monde tend à s’achever en couvrant désormais une grande partie de la planète, que les villes doivent devenir « intelligentes » grâce aux réseaux connectés, les dépendances au fluide électrique et à l’approvisionnement énergétique s’accentuent. Alors que les infrastructures du futur doivent être plus autonomes, les réseaux et villes dites intelligentes semblent pourtant devenir plus vulnérables à l’égard du terrorisme ou des cyber-attaques qui menacent de désorganiser l’ensemble des services urbains. Depuis l’apparition massive du thème des « crises de l’énergie » dans les années 1970, la question des dépendances n’a cessé de se renforcer, en accentuant les craintes de pénurie et le spectre de la panne.
Ce spectre de la panne s’affirme au cœur des tensions et ambivalences du monde de croissance qui survalorise la sécurité tout en produisant sans cesse de l’incertitude, qui célèbre la puissance et la maîtrise tout en multipliant les vulnérabilités, comme si l’affirmation de la maîtrise croissante s’accompagnait d’une perte de maîtrise, parallèle à la prolifération de système de moins en moins maîtrisables du fait même de leur complexité. On retrouve ici des constats faits depuis longtemps par les théoriciens des grands systèmes complexes qui alertent sur les risques d’effondrement au-delà d’un certain seuil, à l’image du concept de contre-productivité développé par Ivan Illich selon lequel, passé un certain seuil, les outils et institutions que l’humain a conçus pour se libérer des tâches matérielles deviennent contre-productifs et source de nouvelles dépendances. Depuis les années 1970, d’innombrables auteurs ont pointé les boucles de rétroaction incontrôlables qui menacent les équilibres fragiles sur lesquels nous vivons, ont alerté sur la nécessité de réduire la complexité des grands systèmes qui accroît les vulnérabilités. C’est d’ailleurs l’un des enjeux qui a été au cœur des théories de la décroissance qui invitent à ralentir, simplifier, et réduire les flux de matières12.
La panne n’est pas un dysfonctionnement passager ou le produit d’un accident regrettable, elle est plutôt une épreuve qui met au jour la fragilité des vies connectées et des dépendances énergétiques. Plus les pannes et leur spectre s’étendent et plus il faut de spécialistes et d’experts pour les résoudre, d’infrastructures toujours plus complexes pour les éviter, ouvrant une course apparemment sans fin comme le montrent les promesses actuelles sur l’hydrogène, la voiture électrique, la 5G et le déploiement des nouveaux réseaux et infrastructures numériques. Toutes ces évolutions accroissent les consommations et multiplient les risques de pannes, créant une série d’impasses alors que nous semblons être « à bout de flux » comme l’observe l’historienne des réseaux électriques Fanny Lopez13.
L’interconnexion et les chaînes de dépendance informationnelles n’accentuent-elles pas encore la menace de la panne ? Les appareils qui reposent sur des matériaux rares, des sources d’énergies précaires ne sont-ils pas rendus plus vulnérables par les guerres, les méga-feux, les modifications environnementales en cours ? La question du cuivre et son extraction, les câbles qui peuvent être coupés, les infrastructures qui s’usent et vieillissent mal, ne poussent-elles pas de plus en plus, au lieu de vouloir les préserver, les maintenir, à les démanteler14 ? L’environnement numérique fait désormais sentir à chacun combien nos rapports au monde sont précaires, tiennent de plus en plus à quelques fils qui peuvent casser. Ainsi, les objets dits connectés créent de plus en plus de sources de pannes en ajoutant une couche supplémentaire de complexité aux dispositifs antérieurs. Des enquêtes révèlent d’ailleurs les craintes des consommateurs à l’égard des dysfonctionnements des compteurs intelligents, des serrures ou des voitures connectées. Face à ces inquiétudes, les promoteurs de ces objets voient dans l’intelligence artificielle la solution pour repérer et traiter les défaillances et dysfonctionnements, prolongeant la course à l’innovation promue pour résoudre les impasses et problèmes des innovations précédentes.
Les nouvelles infrastructures numériques, comme les data centers, qui concentrent de nombreux ordinateurs dans un même espace créent eux-aussi de nouvelles vulnérabilités. Ainsi, il suffit d’une panne de la climatisation pour voir de nombreux risques apparaître pour les humains et les appareils ; la panne continue souvent d’être pensée comme le résultat de défaillances humaines dans un monde technologique qui serait par ailleurs autorégulé et de plus en plus sûr ! Pourtant la complexification croissante tend à les exacerber15.

Alors que le paradigme longtemps dominant de l’innovation, pensée comme la réponse aux vulnérabilités, tend à s’essouffler, de nouvelles visions des objets et des cultures matérielles émergent depuis le début du XXIe siècle16. La panne peut en effet devenir aussi une occasion de renouer avec des modes de vie moins artificiels, elle possède des vertus en contraignant à ralentir les flux incessants. Qui n’a jamais ressenti secrètement l’espoir d’une panne générale qui diminuerait soudainement les flux de messages et de sollicitations, en ouvrant la possibilité d’expérimenter d’autres temporalités, d’autres relations aux autres et à soi. La vogue actuelle pour le thème du ralentissement des rythmes de vie, et les innombrables mouvements « Slow » qui prolifèrent dans tous les domaines en sont un indice17. La panne devient alors l’occasion d’expérimenter d’autres voies, fondées sur la décroissance matérielle, la coopération et l’entraide pour imaginer des cultures techniques à la fois plus sobres, plus modestes, et in fine plus solides car capables de durer. L’ère des pannes géantes nous invite à passer d’un paradigme fondé sur l’innovation, la nouveauté, le renouvellement incessant des produits et des infrastructures à un nouvel imaginaire fondé sur la nécessité de réparer, de maintenir, voire de démanteler les objets et réseaux techniques qui nous entourent.
Au-delà de la panne : « soin des choses », acteurs invisibles et démantèlement
L’obsession pour la panne qui travaille notre époque ouvre un immense champ de réflexion pour les sciences sociales. Les inquiétudes devant la fragilité croissante du monde dont elle est un reflet, conduisent en particulier à l’essor des enquêtes sur la réparation et la maintenance, deux modalités possibles de relations aux infrastructures et aux objets longtemps invisibilisés par l’obsession pour l’innovation et le progrès technique.
Au lieu d’explorer comment l’innovation surgit, se diffuse, circule dans l’espace et le temps, de plus en plus de recherches s’attachent désormais à comprendre comment les choses durent, persistent, s’adaptent en dépit des appels incessant à la disruption et au renouvellement18. Cette perspective, peu présente jusqu’à présent au sein des SHS, se développe en mettant au cœur de l’analyse la question de la « désaffectation », de la « défabrication », ou pour le dire comme les chercheurs anglophones de « l’ex-novation » d’un appareil ou d’une infrastructure, enjeux devenus particulièrement urgents à l’heure de l’anthropocène, et des appels à abandonner les systèmes techniques fondés sur le cycle du carbone.
Les historiens sont ainsi partis en quête de pratiques longtemps ignorées et des objets et dispositifs anciens qui persistent et continuent dans les marges. A cet égard, l’historien des techniques britanniques David Edgerton a joué un rôle pionnier en appelant dès les années 1990 à se détourner de l’innovation au profit des usages, à abandonner le mythe de l’innovation permanente qui invisibilise autant qu’il explique, qui obscurcit la complexité des agencements techniques qui constituent nos milieux de vie en marginalisant des pans essentiels de la réalité technique de nos mondes19. Un vaste champ de réflexion s’ouvre qui s’attacherait à retrouver les pratiques techniques disparues, les machines oubliées, à l’image des travaux de l’association « Retrofutur » qui œuvre à redécouvrir et faire renaître les innovations disparues, maisons solaires, machines à vent et autres équipements simples à force animale marginalisées par le surgissement des combustibles fossiles bon marché qui retrouveraient une utilité et une pertinence à l’heure des appels au Low tech et à la décarbonation de l’économie20.
Si elle laisse moins de traces que les moments de crise et de dysfonctionnement, la réparation comme l’histoire des usages et des difficultés d’usage s’affirment dans ce contexte comme un nouveau paradigme pour penser les techniques. A l’encontre du consumérisme qui privilégie le renouvellement incessant des marchandises et qui a triomphé au XXe siècle, ou de l’obsolescence programmée qui empêche toute réparation, il s’agit de documenter des savoir-faire qui œuvrent au maintien du monde matériel, retrouver des imaginaires et des pratiques oubliées qui peuvent offrir des prises pour réinventer notre rapport au monde à l’origine des crises écologiques21.
Dans leur essai récent consacré au « soin des choses » et aux « Politiques de la maintenance » les sociologues Jérôme Denis et David Pontille insistent ainsi – en partant d’une réflexion sur le travail– sur les actions longtemps restées obscures de maintenance réalisées par les nombreux acteurs de l’ombre qui permettent le maintien des grands réseaux techniques, qu’il s’agisse des grandes infrastructures énergétiques et électriques, ou celles de l’eau, comme des objets et équipements plus ordinaires qui façonnent nos vies au quotidien22. Ils racontent comment leur enquête est née lors d’un travail sur la signalétique du métro parisien. Enquêtant sur l’ordre sociopolitique créée par la signalisation rationnalisée, ils ont découvert une tout autre réalité en suivant les travailleurs chargés de la maintenance de ces équipements. Sans leur intervention pour conjurer le vieillissement des appareils, le transport quotidien de millions de personnes serait bien plus difficile ! Adoptant la démarche pragmatiste de l’enquête située, via de nombreux exemples qui vont de la maintenance des infrastructures de l’eau, l’enlèvement des graffitis, l’entretien du photocopieur, ou la réparation des voitures, les auteurs dessinent une ambitieuse philosophie du soin appliquée aux objets.
Alors que la focalisation des regards sur les pannes, les accidents ou les catastrophes spectaculaires tendait à invisibiliser les pratiques et les acteurs ordinaires de la maintenance, l’essai de Denis et Pontille propose de les remettre au premier plan de l’analyse. A travers une enquête minutieuse au plus près des gestes et des pratiques de ceux qui entretiennent les objets, ils explorent le soin des choses en montrant les savoir-faire et les compétences qu’il implique, l’attention aux bruits, aux odeurs, à la dureté de la matière. Ils accordent une attention particulière à la multisensorialité qu’implique toujours le travail de maintenance car il faut contrôler et tester les matériaux et les équipements, ce qui implique leur connaissance étroite et d’innombrables procédures qui échappent souvent aux formalisations.
La première vertu de cette analyse de la matérialité du monde au prisme des pratiques et activités de maintenance est de redonner une place à des acteurs invisibilisés, à des catégories de travailleurs généralement négligés alors même qu’ils sont essentiels. Les agents de maintenance sont en effet omniprésents et indispensables, dans les souterrains des grands réseaux, dans les arrière-boutiques et les ateliers des usines, sans eux rien ne tient. Leur activité possède par ailleurs une réelle « portée politique » selon Denis et Pontille car elle offre une « voie alternative dans les interstices d’un régime capitaliste massivement organisé autour d’une dynamique de consommation et de production toujours en croissance » (p.351). Dans leur récit, la maintenance devient à la fois une activité subversive, créative, critique, car elle offre un « site diplomatique » pour réinventer de nouvelles relations entre humains et choses.
Particulièrement attentifs à la diversité des gestes, des affects, comme à la dialectique incessante qui se joue entre l’homme et la machine, Denis et Pontille se distinguent à cet égard du travail du philosophe mécanicien M. Crawford dans son « éloge du carburateur » qui tendait à produire une esthétique quelque peu idéalisée du rapport authentique à la matière, notamment parce qu’elle conduit à négliger la part sombre des relations avec les choses, en laissant de côté la violence du travail de maintenance, modelé par les souffrances du corps confronté à la résistance des matériaux et des objets23. Si les auteurs ont tendance à mélanger de multiples scènes et situations qu’il faudrait sans doute mieux distinguer, ils parviennent bien à faire ressurgir ces héros et héroïnes du quotidien, grâce auxquels le monde tient encore, et qui apparurent au premier plan lors de la crise du Covid et ses confinements. Aux frontières des activités de maintenance, de recyclage et de gestion des déchets, cette violence est particulièrement marquée dans les innombrables sites des pays du sud qui voient s’amonceler les instruments électroniques délaissés par les consommateurs des pays riches, à cet égard une philosophie de la maintenance mériterait d’être davantage attentive aux inégalités structurelles qui façonnent le rapport contemporain aux choses.
S’écartant à la fois des visions misérabiliste et romantique qui dominaient généralement les regards sur ce travail du quotidien, Denis et Pontille montrent comment la maintenance ne consiste pas seulement à maintenir l’intégrité physique d’une chose, mais de façon bien plus complexe comment elle implique aussi de désassembler, de transformer, d’adapter les objets afin de permettre leur pérennité. Alors que l’imaginaire de l’innovation héroïque célébrait la nouveauté, ces travaux montrent comment beaucoup d’acteurs ont cherché à maintenir à bas bruit les équipements anciens, en portant attention à la réparation, à l’adaptation de choses jugées périmées mais pourtant bien vivantes. Au cœur de ces nouvelles préoccupations s’affirme ainsi la question des temporalités, contre la flèche du temps progressiste s’élabore un temps disjoint, modelé par d’incessantes discordances et frictions24. Cette question est devenue de plus en plus centrale au sein des sciences sociales, notamment dans la sociologie des techniques qui se tourne désormais vers l’étude des incitations à faire « sans » ou « avec moins » de produits ou de procédés, voyant même parfois dans ce « faire sans » de « nouveaux horizons de l’innovation »25.
Si la maintenance et sa valorisation sont essentielles à une véritable politique terrestre c’est d’abord parce qu’elles offrent une voie pour sortir de la frénésie consumériste tout en créant les conditions d’une plus grande « résilience » à l’égard des crises qui menacent aujourd’hui de rompre les flux de marchandises et d’approvisionnement. Mais dans ce cas, le risque est grand aussi que la politique de la maintenance ne soit qu’un pis-aller afin de préserver ce qui peut encore l’être, en empêchant de repenser plus radicalement nos rapports au monde. Comme le rappelle en effet Denis et Pontille, « toute maintenance n’est pas bonne en soi » et l’enjeu majeur consiste sans doute à déterminer ce qui doit être maintenu et mérite de l’être et ce qui doit être abandonné. Ce qui implique de renouer avec l’ancienne et difficile question de savoir comment faire entrer les techniques en politique, comment inscrire les objets et infrastructures hérités, comme les projets techniques qui ne cessent de surgir, dans un débat collectif et démocratique.

Cette sociologie émergente, influencée par les approches pragmatistes, qui s’inscrit dans la filiation de nombreux auteurs soucieux de sauver l’objet technique contre ses pourfendeurs, rencontre aussi des limites car elle tend à gommer les dissymétries de pouvoir en égalisant les situations, en évitant de condamner trop frontalement les objets et infrastructures qui accélèrent la course à l’abîme. En décrivant finement des situations singulières de maintenance dans des univers extrêmement variés –depuis l’effacement des graffitis jusqu’à la maintenance des objets domestiques – n’y a-t-il pas le risque d’oublier que toutes les techniques n’ont pas le même niveau de responsabilité dans les crises sociales et écologiques ? Toutes n’aliènent pas au même titre les usagers. Derrière la fascination pour ceux qui déploient de riches savoir-faire pour maintenir en vie les techniques du présent – à l’image des passionnés d’automobiles – n’y a-t-il pas le risque de faire disparaître l’urgence d’abandonner ces objets qui façonnent nos vies et accentuent les crises? En ce sens, la question de la maintenance complète, précise, sans s’y opposer, les propositions récentes d’une « écologie du démantèlement ».
Il ne fait aucun doute que pour éviter les pannes catastrophiques, et retrouver une maîtrise sur le monde, il convient de redonner une place à la maintenance, au soin des choses, contre l’obsolescence permanente. Il convient de revaloriser et rendre visibles les acteurs qui font durer les choses et œuvrent à limiter les pannes. Mais il faut aussi apprendre à discriminer et élaborer des critères collectifs pour déterminer ce qui doit durer, ce qui doit être entretenu, et ce qui doit être démantelé et abandonné, ces choses dont la panne et l’arrêt seraient un bienfait tant elles aggravent les crises sociales et écologiques. Toute activité de maintenance n’est donc pas bonne en soi, même si la maintenance porte en elle-même un certain rapport politique au monde en nous invitant à mieux « composer des manières ajustées d’habiter le monde sans jamais s’en extraire » comme le remarquent Denis et Pontille (p. 361).
C’est pourquoi, d’autres interrogent désormais de plus en plus explicitement la possibilité de démanteler et fermer les infrastructures et équipements les plus dangereux26. Alors qu’il faudra apprendre à s’accommoder des héritages toxiques de la modernité – pollutions, déchets, sites détruits – tout ce qu’on nomme désormais les « communs négatifs » – il faut parallèlement accepter de renoncer aux projets déjà obsolètes, aux promesses futuristes qui préparent les pannes et les crises de demain. Ce que les militants écologistes et autres décroissants affirment et crient dans le désert depuis des décennies est en train de pénétrer la réflexion des sciences sociales, en remodelant progressivement les façons de penser le monde et les agencements qui organisent les sociétés.
Plutôt que de maintenir et réparer, d’autres en appellent plus frontalement à l’abandon des imaginaires de l’abondance et au démantèlement des appareils industriels toxiques. Ils font le deuil de la fascination pour l’innovation, à l’image du menuisier et ébéniste Bertrand Louart, de la coopérative Longo Maï de Limans qui expérimente l’entretien d’anciennes machines et le travail manuel de subsistance, militant pour une réappropriation des métiers et l’essor d’une vie décente qui passerait par la sortie de « l’impasse industrielle »27. Beaucoup œuvrent aujourd’hui à cette réappropriation, mais ils sont souvent marginalisés, invisibilisés dans les travaux académiques, alors même qu’ils sont des acteurs décisifs de ce « soin des choses » sans lequel il ne pourra pas y avoir de monde vivable. Que ce soit la coopérative l’Atelier Paysan qui travaille à reconquérir une souveraineté technologique pour les paysans, les innombrables groupes qui militent pour des techniques « Low », « appropriées » ou « conviviales », ou les collectifs autogérés qui entreprennent de faire surgir de nouvelles formes de subsistances concrètes, tous oeuvrent à une réappropriation concrète de la matérialité28.
Pour ces acteurs l’enjeu est moins de trouver les voies et les moyens d’entretenir et de maintenir les systèmes techniques destructeurs dominants que d’en sortir, de les abandonner, ce qui implique d’inventer d’autres trajectoires. C’est pourquoi une politique terrestre et décroissante implique aussi de se réarmer sur le plan des savoirs techniques, au-delà des savoirs sur le vivant, elle nécessite d’enquêter et de comprendre les machines qui nous entourent pour mieux y renoncer ou pour les remodeler lorsque c’est possible dans une perspective terrestre. A cet égard, prendre en compte les pannes, explorer les expériences de maintenance, comme penser et imaginer ce qui doit être démantelé participent d’une même tentative pour réinventer nos relations et nos imaginaires, nos manières d’habiter le monde et de coexister avec d’innombrables non-humains, autant de voies qui émergent pour sortir de nos impasses et incapacités d’agir, et ainsi retrouver une maîtrise et une prise sur le monde technique.
Illustration principale : Ørjan Laxaa.
Notes
- Alain Gras, Fragilité de la Puissance. Se libérer de l’emprise technologique, Paris, Fayard, 2003[↩]
- C. R. Henke et B. Sims, Repairing Infrastructures. The Maintenance of Materiality and Power, MIT Press, Cambridge, 2020.[↩]
- T. Pinch, « How Do We treat Technical Uncertainty in Systems Failure? The Case of the Space Shuttle Challenger », in T. La Porte (dir.), Responding to Large Technical Systems. Control or Anticipation, Kluwer, Dordrecht, 1991; Jean-Baptiste Fressoz, L’apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, Paris, Le Seuil, 2012[↩]
- Jérôme Denis et David Pontille, Le soin des choses. Politiques de la maintenance, Paris La Découverte, 2022, p. 42.[↩]
- F. Jarrige, « Panne : la terreur du manque », in Laurent Testot et Laurent Aillet (ed.), Collapsus. Changer ou disparaître ? Le vrai bilan sur notre planète, Paris, Albin Michel, 2020, p. 32-40 ; « Panne générale ! Un spectre du monde high tech », Terrestres, 2 février 2018.[↩]
- Alain Beltran et Patrice Carré, La vie électrique. Histoire et imaginaire, Belin, 2016.[↩]
- Gérard Dubey et Alain Gras, La Servitude électrique. Du rêve de liberté à la prison numérique, Paris, Seuil, 2021.[↩]
- Le Progrès de la Côte d’Or, 17 décembre 1929.[↩]
- Archives Nationales (Paris), F 22 567 : Rapport de M. Chevalier, Charleville, 17 mai 1924.[↩]
- David E. Nye, When the Lights Went Out. A History of Blackouts in America, MIT Press, 2010.[↩]
- Sezin Topçu, La France nucléaire. L’art de gouverner une technologie contestée, Paris, Le Seuil, 2013.[↩]
- Timothée Parrique, Ralentir ou périr : L’économie de la décroissance, Paris, Le Seuil, 2022.[↩]
- Fanny Lopez, A bout de flux de Flux, Editions Divergences, 2022.[↩]
- Comme le montrent par exemple les enquêtes récentes du journaliste Guillaume Pitron : La Guerre des métaux rares : la face cachée de la transition énergétique et numérique, Les Liens qui libèrent, 2018 ; et L’enfer numérique : voyage au bout d’un like, Paris, Les Liens qui libèrent, 2021[↩]
- Carnino, Guillaume, et Clément Marquet. « Les datacenters enfoncent le cloud : enjeux politiques et impacts environnementaux d’internet », Zilsel, vol. 3, no. 1, 2018, pp. 19-62.[↩]
- Ivan Sainsaulieu, Arnaud Saint-Martin (dir.), L’innovation en eaux troubles. Sciences, techniques, idéologies, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, 2017 ; Benoît Godin, Models of Innovation. The History of an Idea. MIT Press eBooks, 2017 ; François Jarrige, Technocritique, Du refus des machines à la contestation des technosciences, Paris, La Découverte, 2016.[↩]
- Laurent Vidal, Les Hommes lents : résister à la modernité, XVe-XXe siècle. Paris, Flammarion, 2020.[↩]
- Stefan Krebs, Heike Weber (dir.), Histories of Technology’s Persistence: Repair, Reuse and Disposal, Bielefeld, 2021.[↩]
- David Edgerton, Quoi de neuf ? Une histoire des techniques depuis 1900, Paris, Le Seuil, 2013.[↩]
- Gianenrico Bernasconi, Guillaume Carnino, Liliane Hilaire-Pérez, Olivier Raveux (dir.), Les Réparations dans l’Histoire. Cultures techniques et savoir-faire dans la longue durée. Paris, Presses des Mines, collection Histoire, sciences, techniques et sociétés, 2022.[↩]
- Cédric Carles (dir.), Rétrofutur – Une contre-histoire des innovations énergétiques, Buchet-Chastel, 2018 ; F. Jarrige et A. Vrignon (dir.), Face à la puissance. Une histoire des énergies alternatives, Paris, La découverte, 2020.[↩]
- Jérôme Denis et David Pontille, Le soin des choses. Op. cit.[↩]
- Matthew B. Crawford, Eloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail, Paris, La Découverte, 2010.[↩]
- Christophe Charle, Discordance des temps : une brève histoire de la modernité, Paris, Dunod Ekho, 2022.[↩]
- Frédéric Goulet, Dominique Vinck (dir.), Faire sans, faire avec moins. Les nouveaux horizons de l’innovation, Paris, Presses des Mines, coll. « Sciences sociales », 2022[↩]
- E. Bonnet, D. Landivar et A. Monnin, Héritage et fermeture. Une écologie du démantèlement, Divergences, Paris, 2021[↩]
- Bertrand Louart, Réappropriation. Jalons pour sortir de l’impasse industrielle, Éditions la Lenteur, 2022.[↩]
- L’Atelier paysan, Reprendre la terre aux machines : manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire, Éditions du Seuil, coll. « Anthropocène », 2021[↩]







