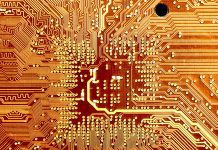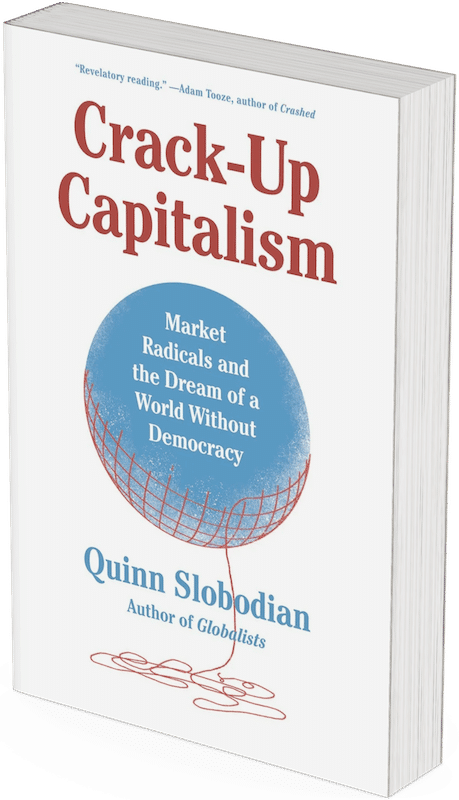
À propos de Quinn Slobodian, Crack-Up Capitalism: Market Radicals and the Dream of a World Without Democracy, Dublin, Penguin Books, 2023, 352 pp.
Dans son ouvrage Les Globalistes. Une histoire intellectuelle du néolibéralisme1, l’historien canadien Quinn Slobodian se proposait de revisiter sous un jour nouveau l’histoire du néolibéralisme. Il s’agissait de montrer comment, dans les suites immédiates de la Grande guerre, ce dernier s’était élaboré comme un projet politique d’unification économique du monde permettant de protéger la libre circulation du capital en contenant les revendications égalitaires des masses par la limitation (voire la pure et simple suspension) du principe démocratique. En s’attachant aux figures-clés du néolibéralisme (de von Mises et Hayek à Röpke, Haberler ou Heilperin) qui, des années 1920 jusqu’à l’aube des années 1980, ont œuvré à élaborer le modèle d’un nouvel ordre mondial tout entier destiné à assurer le fonctionnement du libre marché, c’est par conséquent le global qui était retenu comme l’échelle pertinente pour comprendre ce projet politique néolibéral, dès lors défini par Slobodian comme « ordoglobalisme néolibéral ».
C’est de ce point de vue à un véritable changement d’échelle que l’auteur nous invite dans Crack-Up Capitalism. Car si Les Globalistes se terminait dans les années 1990, avec cette apogée du projet globaliste qu’est la création, à Genève, de l’OMC (et avec les premières manifestations de crise de la globalisation), c’est ici un phénomène en apparence contradictoire qui se trouve pris pour point de départ : une tendance à la « perforation » (p. 16) ou à la « fragmentation » (p. 18) du monde que Slobodian décèle à travers la multiplication toujours croissante du principe de la « zone » économique spéciale – liminairement définie comme une « enclave creusée dans une nation et libérée des formes ordinaires de régulation » (p. 13) – dont il montre qu’elle s’initie à partir des années 1970 dans la colonie anglaise de Hong Kong, et dont la carte qu’il en dresse à l’échelle mondiale n’en dénombre pas moins que 5400 à l’heure actuelle.
Il existe une tendance du capitalisme contemporain à faire « sécession » à travers la multiplication des « enclaves » : l’objectif est de se fortifier en se mettant à l’abri de tout contrôle démocratique.
En faisant le choix de s’installer dans cette « histoire du passé récent et de notre présent troublé » (p. 19) qu’est celle des quatre dernières décennies, il s’agit ainsi de s’attacher à ce qui n’est en réalité pas tant le contraire que l’autre face de la globalisation néolibérale : ce que Slobodian désigne comme le processus de « zonification » ou la prolifération d’espaces visant à l’optimisation du capital au moyen d’une neutralisation de la démocratie, dont l’auteur souligne qu’elle ne s’opère pas tant contre les États qu’elle ne s’opère au moyen de leur propre coopération. Des zones franches aux paradis fiscaux, des charters cities et des gated communities aux start-up nations ou aux utopies de la Silicon Valley, c’est donc une certaine tendance du capitalisme contemporain à faire « sécession » – ou, dit autrement, à se fortifier en se mettant à l’abri de tout contrôle démocratique – que Slobodian nous invite à regarder de plus près en s’attachant à la multiplicité de ces « enclaves » et des figures qui les promeuvent (de Milton, David et Patri Friedman à Murray Rothbard ou Peter Thiel pour ne citer que quelques-uns des plus connus).
Galerie de portraits et topographie de zones économiques spéciales formant ensemble la pointe avancée d’un capitalisme dont la dimension autoritaire se manifeste toujours plus ouvertement, Crack-Up Capitalism pose ainsi des questions centrales (et d’une actualité toute particulière depuis l’élection de Javier Milei en Argentine) pour toute réflexion politique sur le présent. Plutôt que de retracer chapitre par chapitre ce qu’on pourrait avec Mike Davis appeler le « stade Dubaï du capitalisme »2, je propose ici de m’arrêter sur un certain nombre d’éléments qui, dans ce livre passionnant qui se lit comme un bon « roman noir », me paraissent engager les enjeux les plus importants soulevés par l’auteur.
What if History : entre histoire contrefactuelle et utopie capitaliste
L’un des aspects les plus originaux du récit proposé dans cet ouvrage tient sans doute à sa méthodologie qui s’apparente à ce que les historiens contemporains désignent comme une histoire « contrefactuelle », « virtuelle » ou une « what if history ». Cette méthode consiste à analyser l’histoire en se demandant ce qui se serait passé si un événement ne s’était pas produit ou produit différemment, ou en se demandant quel type de futur dessine une tendance déjà décelable au présent. Ou, pour le dire avec Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou : une « histoire des possibles » dont ces auteurs ont très justement souligné la fécondité épistémologique autant que critique et politique3. À aucun moment Slobodian ne revendique explicitement l’usage de ce type d’épistémologie historique. C’est bien cependant sous son signe que se trouve placées les analyses et interrogations poursuivies tout au long de cet ouvrage, comme cela apparaît dès l’introduction où ce sont l’ensemble des questions directrices qui se trouvent formulées sur le mode du « what if ». Et cela, en particulier au moment où l’auteur reprend à son compte une interrogation proposée par le milliardaire Peter Thiel lors d’une conférence du Seasteading Institute4, et que Slobodian reformule de la façon suivante :
« Sans regarder votre téléphone, combien y a-t-il de pays dans le monde ? Vous n’êtes pas sûr ? La réponse est environ deux cents, plus ou moins. Pensez maintenant à l’année 2150. Combien y en aura-t-il alors ? Plus de deux cents ? Moins ? Et s’il y en avait mille ? Ou seulement vingt ? Et s’il y en avait deux ? Ou un seul ? (…) Quels types d’avenir ces cartes suggèrent-elles ? Et si tout dépendait de la réponse ?
La personne qui a posé cette expérience de pensée en 2009 était le capital-risqueur Peter Thiel, âgé de quarante et un ans. Après avoir fait une petite fortune en fondant PayPal et en investissant très tôt dans Facebook, il venait de subir un coup dur lors de la crise financière de l’année précédente. Il n’a plus qu’une idée en tête : échapper à l’État démocratique collecteur d’impôts. ‘‘Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles’’, écrit-il. » (p. 15)
Ou encore, quelques pages plus loin :
« Et si la fin de l’histoire n’était pas le damier de plus de deux cents États-nations existant dans des conditions de démocratie libérale, mais des dizaines de milliers de juridictions de divers systèmes politiques en concurrence constante ? Comme l’a dit un radical du marché, ‘‘Et si la plus grande tendance politique des deux cents dernières années, à savoir la centralisation du pouvoir de l’État, s’inversait au XXIème siècle’’ ? » (p. 23)
Comme l’indiquent ces questions, l’enjeu est bien de prendre au sérieux un type de stratégie – et d’espérance ou de projection – qui n’est autre que celui des « radicaux du marché » (market radicals) qui, en vue de construire des échappées à toute forme de contrôle démocratique, rêvent d’un monde éclaté en une myriade de zones économiques spéciales en concurrence les unes avec les autres. Ce qui conduit l’auteur à relater les expérimentations passées ou actuelles de cette avant-garde capitaliste en s’attachant aux cas bien connus de villes-États comme Hong Kong, Singapour, Shenzhen, Dubaï ou à des quartiers comme Canary Wharf à Londres. Mais ce qui le conduit aussi à s’attacher à des « laboratoires » moins connus comme l’Afrique du Sud post-apartheid où des libertariens proches de la mouvance néolibérale ont fondé une pseudo-nation nommée Ciskei, permettant de parquer les populations noires indésirables en en faisant une main d’oeuvre quasi-gratuite tout en instaurant des règles favorables à l’investissement de capitaux étrangers. Dans cet ensemble de récits et cette géographie politique proposés par Slobodian, l’approche contrefactuelle fonctionne à deux niveaux au moins.
Les radicaux du marché construisent des échappées à toute forme de contrôle démocratique et rêvent d’un monde éclaté en une myriade de zones économiques spéciales en concurrence les unes avec les autres.
Elle est d’abord opératoire dans la manière dont, en racontant ce qu’on pourrait se risquer à appeler cette « histoire des vainqueurs », Slobodian donne à voir une tendance dont il interroge la logique propre et les scénarios futurs qu’elle esquisse en montrant comment, à travers toutes ces expérimentations et conformément au projet politique qui les soutient, la valorisation de la liberté économique va de pair avec une désactivation de toute liberté politique. Une telle fétichisation de la liberté économique ne s’accompagnant pas seulement d’un conservatisme raciste ou sociobiologique (dont la pensée d’un Murray Rothbard se présente ici comme prototypique) mais de formes plus ou moins assumées de néo-colonialisme (l’idée étant d’appréhender la fondation de nouvelles « zones » comme la conquête de nouveaux territoires supposant une main d’oeuvre au moindre prix et privée de droits).
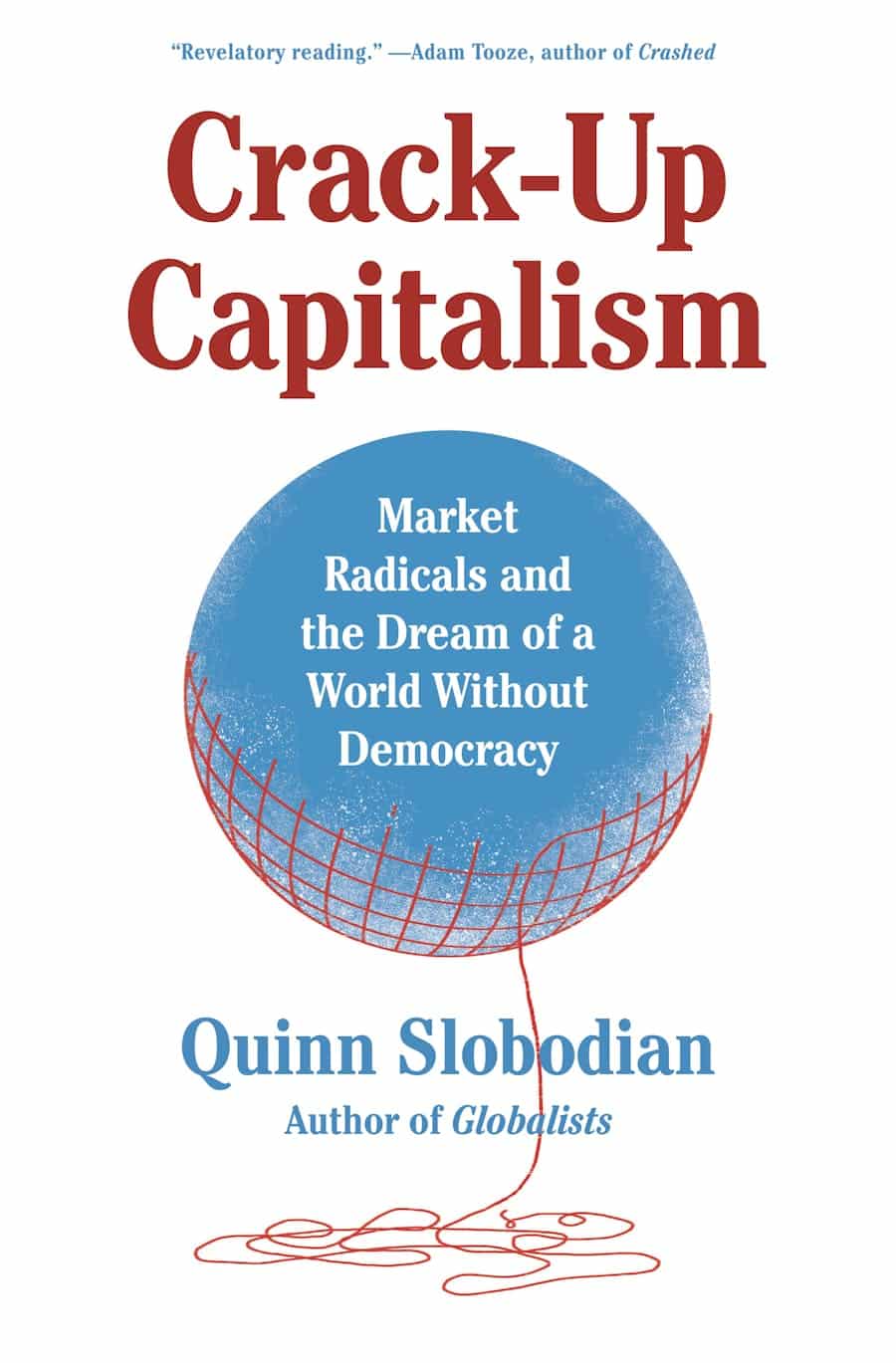
L’ « utopie » que dessine la tendance capitaliste à la « zonification » (p. 99) du monde est donc celle d’un monde où la notion même de droit se trouve entièrement transférée du plan politique au plan économique. Mais, comme le souligne très finement Slobodian à propos des rêves sécessionnistes d’une figure de la Silicon Valley comme Valaji Srinivasan (auteur d’un ouvrage intitulé The Network State : How to Start a New Country), c’est aussi celle de ce qu’on pourrait appeler un monde non terrestre, puisque c’est en réalité la question des ressources qui se trouve occultée :
« Rien n’est créé à partir de rien. Le cloud est ancré dans des centres de données tentaculaires, qui chauffent et sont refroidis par des rivières et des centrales électriques au charbon. Les crypto-monnaies sont particulièrement gourmandes en ressources. Au début des années 2020, la hausse de leur valeur mettait à rude épreuve les réseaux électriques du monde entier, car les gens câblaient de vastes entrepôts d’ordinateurs fonctionnant jour et nuit pour résoudre les équations qui permettaient d’extraire de nouvelles pièces de monnaie. (…) On estime que la consommation annuelle d’électricité pour le minage de bitcoins est plus élevée que celle de la Suède tout entière. La discussion de Srinivasan sur le cloud country ne fait aucune mention de l’utilisation de l’énergie ou du changement climatique. Le poids de l’adaptation à la montée des marées, aux inondations, aux incendies et aux événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents serait vraisemblablement supporté par d’autres. » (p. 230)
Ou encore, et cette fois en conclusion avec par conséquent une portée plus large encore :
« Quels que soient les fantasmes de fuite (exit fantasies), les zones ne peuvent pas échapper à la Terre. (…) Les zones ont des habitants. Il n’existe pas d’ardoise vierge. » (p. 250)
Telle qu’elle fonctionne dans cet ouvrage, l’approche contrefactuelle présente cependant une seconde fonction : elle permet de montrer que dans cette histoire récente de la zonification capitaliste, d’autres devenirs (plus soutenables écologiquement et socialement) étaient également possibles et en germe, comme Slobodian y insiste notamment dans son analyse des transformations de Londres sous l’ère thatchérienne à la fin des années 1980.

Lorsqu’en 1986, Margaret Thatcher entreprend de déréguler les services financiers, elle décide de faire construire un nouveau quartier d’affaires nommé Canary Wharf, qu’elle conçoit comme une miniature de Hong Kong, c’est-à-dire comme une enclave visant à favoriser l’investissement de capitaux étrangers. Mais cette décision a avant tout une portée politique. En choisissant de faire construire ce nouveau quartier sur les lieux mêmes des docklands, et donc dans ce qui fut un quartier central de la classe ouvrière londonienne, il ne s’agit pas seulement d’effacer tout un pan de l’histoire et de la mémoire ouvrière. Il s’agit de mettre fin à tout un ensemble de projets élaboré par le gouvernement de la ville, le Greater London Council (GLC) qui, à partir du début des années 1980, avait porté une vision socialiste ou municipaliste de Londres, attentive aux liens entre communautés d’immigrés et classes ouvrières ainsi qu’au pouvoir de décision et aux besoins des habitants en matière de logements et de transports publics. Avec l’édification de cette « Hong-Kong-sur la-Tamise », pour reprendre le surnom de Canary Wharf, c’est donc, comme le remarque Slobodian, le « prototype d’une nouvelle forme de zone » (p. 54) qui fait son apparition : celui de zones entièrement dédiées aux investissements des promoteurs étrangers et où (comme dans le quartier new yorkais au doux nom de Billionaire’s Row) la zonification s’opère par le biais privilégié de la spéculation sur l’immobilier de luxe. Mais c’est aussi un projet et des expériences municipalistes qui se trouvent enterrés, comme le souligne avec force l’auteur en notant que :
« Comme la cathédrale du Sacré-Cœur construite sur le point culminant de Paris après la destruction de la Commune de Paris en 1871, Canary Wharf était également un monument à une version vaincue de la ville. Les projets urbains socialistes de la Londres rouge ont été abandonnés, éclipsés et démolis pour construire des véhicules d’investissement pour les plus riches. Le résultat est une ville en miettes. » (p. 55)
Néolibéralisme et libertarianisme : La question de l’État
Pour celles et ceux qui avaient lu Les Globalistes, il est par ailleurs intéressant de s’interroger sur les apports voire les revirements opérés par Crack-up Capitalism. À première vue, on pourrait en effet penser que Slobodian prend le contrepied du récit proposé dans son ouvrage de 2018, en montrant que c’est la zonification ou la fragmentation, bien plus que la globalisation, qui constitue la tendance politique la plus importante de notre présent. Les choses se révèlent cependant plus complexes. D’abord, parce que Les Globalistes se terminait déjà sur une analyse de la crise de légitimité rencontrée dès la fin du 20ème siècle par le projet néolibéral ( et qui se cristallise dans la naissance de l’altermondialisme au Brexit). Mais aussi parce que ce qui intéresse Slobodian dans Crack-Up Capitalism, c’est de privilégier cette fois le courant libertarien, tout en continuant d’intégrer des figures et réseaux associés au néolibéralisme. D’où une délicate question qui se pose, et qui concerne le rôle même de l’État au sein de ce processus de zonification.

À la suite de nombreux auteurs, à commencer par Michel Foucault, ce que mettait en évidence Les Globalistes, c’est le rôle positif et constituant de l’État dans le projet néolibéral. Faire de la mouvance libertarienne ou anarcho-capitaliste le fer de lance du projet de zonification du monde, c’est donc, en apparence au moins, prendre au sérieux le rêve d’un monde qui ne serait pas seulement sans démocratie, mais plus radicalement sans État. Or c’est ici que les choses se compliquent. Car si Slobodian indique dès l’introduction que : « C’est le sécessionnisme, et non le globalisme, qui représente le mantra des penseurs qui sont au cœur de ce livre » (p. 23), cela ne signifie pas à ses yeux qu’on puisse en conclure à une pure et simple opposition entre ces deux projets. Et si, tout au long de son récit, Slobodian s’attache pour l’essentiel à des projets, expériences et figures de la mouvance libertarienne, le diagnostic qu’il dresse en conclusion est parfaitement clair (à défaut d’être réellement justifiée, on y reviendra) : « Quelle que soit la rhétorique, les zones sont des outils de l’État et non une libération à son égard. » (p. 250).
À travers la proposition de faire du mouvement de la zonification la tendance la plus importante pour interroger le devenir du capitalisme contemporain, ce qui se révèle au fil des pages, c’est donc un jeu complexe où, tout en étant ce qu’il s’agit officiellement de dépasser ou de limiter, l’État demeure dans le même temps un acteur de premier plan ; ne serait-ce que parce qu’il conserve la fonction d’autoriser ou d’instaurer lui-même ces zones économiques spéciales. D’où par conséquent une idée centrale qui se dégage, à savoir que la tendance sécessionniste des radicaux du marché n’est en réalité pas tant à envisager comme le contraire que comme l’autre face de la globalisation, et cela dès les années 1970. De même que le libertarianisme n’est pas tant à envisager comme adverse au néolibéralisme que comme un projet qui, tout en admettant des divergences concernant la conception du rôle de l’État, n’en partage pas moins des points d’accord au premier rang desquels l’idée que la démocratie est ce qu’il convient de désactiver et que la liberté doit donc s’entendre en un sens exclusivement économique.
La tendance sécessionniste des radicaux du marché n’est en réalité pas tant à envisager comme le contraire que comme l’autre face de la globalisation.
Il est de ce point de vue intéressant de noter que le livre, qui prend son point de départ dans les années 1970 à Hong Kong, commence avec la fascination exercée par cette colonie britannique sur Milton Friedman, au moment même où elle devient pour la Chine un modèle pour s’ouvrir au capitalisme en créant des zones économiques spéciales dont Shenzhen reste la plus connue. Se rendant en 1978 à Hong Kong, à l’occasion d’une rencontre de la Société du Mont-Pèlerin (fondée en 1947 par le théoricien néolibéral Friedrich Hayek), c’est en effet un nouveau modèle de gouvernance que découvre Friedman, où les exigences démocratiques des masses ne viennent pas contrarier le fonctionnement du libre marché et où les élites économiques fonctionnent main dans la main avec le gouvernement pour élaborer les règles les plus favorables au capital. En sorte qu’avec Milton Friedman, c’est donc une figure centrale du néolibéralisme de l’école de Chicago qui inaugure dans l’ouvrage l’intérêt politique porté au phénomène de la « zone » ; intérêt qu’on retrouve chez Thatcher et son propre projet, une décennie plus tard, de transposer le « modèle Hong Kong » dans la ville de Londres.
En faisant le choix de débuter son récit à Hong Kong, à travers sa découverte par Milton Friedman, on voit que Slobodian ne quitte donc pas tant la galaxie des intellectuels et figures néolibéraux qu’il ne l’interroge sous l’angle d’une tendance demeurée dans l’ombre dans Les Globalistes : la tendance à privilégier le micro ou les petites échelles qu’un néolibéral comme Milton Friedman partage donc avec les libertariens (à commencer par son fils et son petit-fils, David et Patri), et qui invite peut-être aussi à réévaluer les liens entre néolibéralisme et libertarianisme, comme paraît le faire Slobodian au moment où il situe les membres de la Société du Mont-Pèlerin qui débarquent à Hong Kong en 1978 :
« Au sein du groupe néolibéral, il y avait des penseurs de différentes nuances, mais ils étaient unis par la conviction que le capitalisme devait être protégé de la démocratie à l’ère de la démocratie de masse. Il y avait quelques groupes principaux de penseurs. Ceux qui nous intéressent le plus dans ce livre se reconnaissent dans le terme ‘‘libertarien’’. Bien que le libertarianisme comporte de nombreuses écoles et tendances, elles sont unies par la conviction que le rôle de l’État est de protéger le marché, et non de posséder des biens, de gérer des ressources, de diriger des entreprises ou de fournir des services tels que les soins de santé, le logement, les services publics ou les infrastructures. Le maintien de la sécurité intérieure et extérieure, la protection de la propriété privée et le caractère sacré des contrats : tels devraient être les principaux rôles du gouvernement. La principale différence (…) se situe entre ceux qui visent à un État minimal (parfois appelés minarchistes) et ceux qui promeuvent l’absence d’État (connus sous le nom d’anarcho-capitalistes). » (p. 34)
Écriture terrestre de l’histoire et échelles politiques du monde
On peut par conséquent considérer que l’un des aspects les plus importants de Crack-Up Capitalism tient au fait de complexifier le diagnostic établi par Les Globalistes. Car ce que montre Slobodian, c’est au fond que la globalisation néolibérale s’est très tôt doublée d’une tendance à la fragmentation, la mise en place d’un ordre économique mondial s’étant d’emblée accompagnée d’un intérêt porté à ce que l’auteur désigne comme des « micro-ordonnancements » (micro-ordering) entendus comme « création d’arrangements politiques alternatifs à une petite échelle » (p. 17). Cette complexification ou dialectisation de l’analyse de la globalisation vise d’abord à récuser la thèse de Francis Fukuyama qui, en 1989, prophétisait cette « fin de l’histoire » que serait la convergence, enfin réalisée, entre le modèle politique de la démocratie parlementaire et l’économie globale de marché. D’où la question, à nouveau contrefactuelle, qui invite à lire autrement l’histoire du présent :
« Et si la fin de l’histoire n’était pas le damier de plus de deux cents États-nations existant dans des conditions de démocratie libérale, mais des dizaines de milliers de juridictions de divers systèmes politiques en concurrence constante ? » (p. 22)
Mais elle permet aussi de mettre au jour ce qui forme l’une des visées essentielles des projets respectivement néolibéral et libertarien : la sanctification du marché libre et de ses mécanismes de mises en concurrence par rapport à laquelle la démocratie se présente comme un danger. Ou, pour le dire dans les termes que nous avions nous-mêmes choisi dans Le Choix de la guerre civile. Une autre histoire du néolibéralisme avec Pierre Dardot, Christian Laval et Pierre Sauvêtre : une méfiance radicale vis-à-vis de la démocratie, qui s’apparente à une véritable « démophobie » et implique ce processus d’ « ennemisation » consistant à constituer toutes celles et ceux (écologistes, féministes, opposants aux politiques d’austérité et de privatisation) qui s’opposent à la logique du marché en ennemis de l’État néolibéral5.

L’un des aspects les plus originaux du travail de Slobodian, dans Crack-Up Capitalism comme dans Les Globalistes, est à cet égard de s’installer moins directement dans la critique externe que d’analyser au peigne fin les objectifs, projections et espoirs qui président aux projets et entreprises portés par les néolibéraux ou, puisqu’ils se trouvent placés au premier plan de son dernier ouvrage, les libertariens. Cela permet de mieux saisir la nature d’un certain nombre de tendances et dynamiques politiques en cours tout comme les bonnes raisons qu’il y a, dans une visée démocratique, écologique et sociale, de s’y opposer. Mais cela permet aussi de comprendre les modalités très concrètes à partir desquelles ces projets parviennent à consolider le fonctionnement du capitalisme à l’échelle mondiale, en le mettant à l’abri de tout contrôle démocratique.
Il y a toutefois une autre dimension de ces deux ouvrages de Slobodian – en lesquels on peut voir comme un diptyque – qui retient tout particulièrement l’attention : le choix de faire de la question des échelles (globale et locale ou macro et micro) la pierre angulaire à partir de laquelle analyser ces utopies d’un capitalisme à l’état pur, dont la progressive réalisation compromet toujours davantage les ressorts de la démocratie tout comme les conditions d’habitabilité de la planète. Et, pour ce qui est cette fois plus spécifiquement de Crack-Up Capitalism : le choix d’une écriture qu’on pourrait aller jusqu’à qualifier de « terrestre », en ce qu’elle part chaque fois d’une description matérielle des lieux auxquels se rattache la grande diversité des « zones » analysées par l’auteur, qui s’appuie ici sur un important corpus de travaux en géographie et en architecture contemporaine, s’inscrivant ce faisant dans le cadre du « tournant spatial » des sciences sociales qui s’est opéré à partir du dernier tiers du 20ème siècle6.
Ce choix se révèle en effet d’une grande force pour analyser la manière dont les projets néolibéraux et libertariens parviennent à quadriller ou à engainer l’espace-monde dans un corsage capitaliste. Les échelles du global et de la zone se présentant ainsi comme des niveaux d’échelle moins opposés que complémentaires, et tous deux étroitement dépendants de cette troisième dimension – dont l’actualité révèle, y compris à travers l’élection en Argentine d’une figure libertarienne comme Javier Milei, qu’elle devient sans cesse plus importante – qu’est celle de ce qu’on pourrait appeler le national-étatique. Mais il y a cependant un intérêt supplémentaire à ce choix méthodologique ou multiscalaire qui concerne moins l’analyse des imaginaires politiques qui soutiennent les projets des thuriféraires néolibéraux et libertariens que la question des stratégies permettant de leur opposer des alternatives. Ou pour le dire autrement : permettant d’opposer à cette logique générale de la privatisation ou de la dépossession une logique du commun.
Slobodian n’examine pas ces autres formes de sécession ou de « fragmentation » pouvant se rattacher aux traditions anarchistes, communalistes ou opéraïstes.
Cette question des alternatives et du commun ne se trouve pas posée directement par Slobodian. Ce dernier prend soin de mentionner les oppositions rencontrées par les expérimentations qui, comme à Londres, au Honduras ou à Ciskei, ont violemment imposé des choix organisationnels et territoriaux défavorables (quand ce n’est pas néocolonialiste et raciste) aux populations locales. De même que, dans une très belle conclusion intitulée « Be Water », il prend également soin de donner toute sa force au cri de révolte des activistes hongkongais qui, exigeant en 2019 la démocratie et l’auto-détermination, ont repris à l’icône de la ville, Bruce Lee, l’expression « be water ». Ce que Slobodian commente de manière suggestive, à moins qu’il ne faille dire héraclitéenne, en disant que : « Ce que cela signifie ne peut être découvert que dans le processus du devenir » (p. 253) ; cette « ur-zone » (p. 250) qu’est Hong Kong demeurant elle-même soumise à cette contingence du devenir à laquelle ouvre la dynamique des luttes et rapports de force politiques.
La question, en revanche, que ne pose pas Slobodian dans ce livre est celle des rapports – antagonistes – qu’il est permis d’établir entre cette tendance sécessionniste des « radicaux du marché » et ces autres formes de sécession ou de « fragmentation »7 pouvant se rattacher aux traditions anarchistes, communalistes ou opéraïstes. Dans un entretien à propos de cet ouvrage, l’auteur raconte qu’à cette question qui lui a plusieurs fois été posée, il répond sur le mode de la plaisanterie qu’il lui faudrait « écrire Crack-Up Commoning en réponse à Crack-Up Capitalism8 »,. Et on peut du reste se demander dans quelle mesure ce titre ne fait pas tacitement référence à l’ouvrage de John Holloway, Crack Capitalism, où c’est l’ensemble des brèches ou des zones (« zones à défendre », « zones autonomes ») ouvertes par les luttes et expérimentations anticapitalistes qui se trouve constitué en matrice pour envisager un dépassement du capitalisme9.
Ce qui est certain, c’est que lorsqu’on lit le dernier ouvrage de Slobodian depuis un point de vue où la question des échelles politiques du monde se trouve appréhendée sous un angle écologique, la question de savoir comment conjuguer le global et le local se présente comme une question stratégiquement décisive, invitant tout autant à s’opposer aux logiques de la globalisation et de la zonification décrites par Slobodian, qu’elle n’invite à inventer de nouvelles formes d’articulation entre ces différentes échelles, auxquelles il convient d’ajouter celle de la Terre. De même que globalisation et fragmentation fonctionnent ensemble dans la réalisation des utopies capitalistes portée par les néolibéraux et les libertariens, de même y a-t-il en effet une exigence politique, pour quiconque tient à la simple idée de la valeur intrinsèque de la vie (humaine comme non-humaine), à inventer de nouvelles manières de penser le politique à l’échelle mondiale ou planétaire, comme aux échelles différenciées des territoires, écosystèmes et lieux de vie10.
Car ce que remarque Slobodian, c’est que cette tendance au sécessionnisme capitaliste comporte aussi une dimension sacrificielle. Si les rêves d’un monde sans démocratie vont souvent de pair avec une occultation de la question des ressources, ils n’en incluent en effet pas moins une certaine conception de la gestion du réchauffement climatique, où les pauvres se voient condamnés à en subir de plein fouet les conséquences ou à se voir transformés simple en main d’oeuvre servile :
« Un autre type de zone qui revient dans les discussions sur le climat est l’idée de la zone de sacrifice, une zone où les établissements humains sont abandonnés à l’élévation du niveau de la mer. Au niveau mondial, de nouvelles formes d’inégalité apparaissent déjà, les communautés les plus pauvres étant désignées comme zones de sacrifice et entrant dans une ‘‘retraite gérée’’, tandis que les régions plus riches commencent à planifier l’édification de digues, de bermes et d’autres formes de confinement. Lorsque le Seasteading Institute a conclu un partenariat de courte durée avec la nation de Tahiti, dans le Pacifique Sud, ses dirigeants ont parlé de manière plutôt vague de la façon dont ses structures flottantes pourraient fournir un espace d’habitation alternatif aux résidents tahitiens, alors que le niveau de la mer continue de monter. Au-delà de la question évidente de l’imminence de phénomènes météorologiques extrêmes qui détruiraient probablement de telles structures, la vision de la façon dont, en fait, les habitants seraient intégrés dans le nouveau Waterworld a été peu discutée. Seraient-ils des membres à part entière ou une classe inférieure permanente ? » (p. 249-250)
On le voit, la catégorie de « zone » se révèle ici extrêmement large. Mais si elle vise à mettre au jour une tendance qui, aux yeux de Slobodian, n’en est qu’à ses débuts, elle entend aussi à questionner les devenirs d’un monde en régime de réchauffement climatique et condamné, à plus ou moins proche échéance, à voir se réduire drastiquement ses propres zones d’habitabilité.
De quelques zones d’ombre
Le choix d’avoir, à la différence de ce qui était le cas dans Les Globalistes, privilégié la forme du récit à celle d’une analyse proprement théorique présente l’intérêt de rendre ce livre accessible à un large public. Reste qu’il s’accompagne d’une tendance à laisser dans l’ombre un certain nombre de questions essentielles dont on peut regretter qu’elles ne se trouvent à aucun moment posées de manière plus directe. Au nombre de ce qu’on pourrait donc, cum grano salis, appeler ici les « zones d’ombre » de cet ouvrage, figure les rapports entre néolibéralisme et libertarianisme. Plutôt qu’un minutieux travail comparant ces deux mouvances Slobodian se contente de pointer leurs affinités et notamment leur commune obsession pour une liberté économique entendue comme étant en opposition avec la liberté politique et la démocratie.
En sorte que c’est la question même de l’État, de son rôle par rapport au processus de « zonification » et de la manière dont il se trouve respectivement analysé au sein des mouvances néolibérales et libertariennes qui demeure au final assez opaque. À deux reprises dans la conclusion de l’ouvrage (p. 247, p. 250), l’auteur souligne que la zonification ne s’opère pas tant contre les États qu’elle n’en constitue un « instrument » (tool). Reste que cette assertion ne fait à aucun moment l’objet d’une véritable justification, ce qui aurait supposé de faire de la question de la souveraineté de l’État et de ses propres métamorphoses historiques un objet d’analyse autonome11.
Slobodian nous invite à regarder la manière dont la zonification se présente aujourd’hui comme une stratégie de premier plan pour immuniser le capitalisme contre toute revendication démocratique et égalitaire.
Tout se passe ainsi comme si, avec Crack-Up Capitalism, Quinn Slobodian avait pris le parti d’entraîner son lectorat dans un récit qui n’avait pas tant pour objectif de livrer les clés d’un diagnostic historique exhaustif que d’ouvrir à cette expérience de pensée consistant à prendre au sérieux les « rêves » sécessionnistes des libertariens pour se demander vers quel type d’horizon politique nous conduirait leur réalisation. Tout l’enjeu de ce livre étant donc de mettre au jour une tendance contemporaine à cette forme anti-démocratique de fragmentation où se préfigure l’émergence d’un monde où le capitalisme atteindrait enfin sa forme pure : un monde où la domination et l’exploitation ne seraient plus entravées par aucune limite.
Crack-Up Capitalism n’est donc pas seulement un grand livre d’histoire du présent consacré à ce qu’on pourrait appeler les utopies réelles des radicaux du marché. Sa portée est bien plus vaste et, comme le suggère la conclusion, elle est directement politique : en nous invitant à regarder la manière dont la zonification se présente aujourd’hui comme une stratégie de premier plan pour immuniser le capitalisme contre toute revendication démocratique et égalitaire, cet ouvrage invite aussi à agir et encourager les diverses expérimentations contemporaines visant à une réappropriation de la démocratie. Il s’agit donc d’un livre utile et important pour quiconque considère que cela ne saurait se faire que dans l’horizon de mondes post-capitalistes.
De la même autrice, lire aussi sur Terrestres : « Désirer après le capitalisme », juillet 2023.
Notes
- Q. Slobodian, Les Globalistes. Une histoire intellectuelle du néolibéralisme, Paris, Seuil, 2022.[↩]
- M. Davis, Le stade Dubaï du capitalisme, Paris, Amsterdam, 2007.[↩]
- Q. Deluermoz, P. Singaravélou, Pour une histoire des possibles, Paris, Seuil, 2016.[↩]
- Organisation libertarienne fondée par Patri Friedman et financée par Peter Thiel, dont le projet est de créer des îles artificielles sur l’océan afin d’échapper aux juridictions étatiques et d’inventer de nouvelles règles économiques favorables à la concurrence et la libre circulation du capital.[↩]
- P. Dardot, H. Guéguen, C. Laval, P. Sauvêtre, Le choix de la guerre civile. Une autre histoire du néolibéralisme, Montréal, Lux, 2021.[↩]
- Voir sur ce point Robert Poole, « Qu’est-ce que le ‘‘spatial turn’’ » ? » 2017. Revue d’histoire des sciences humaines, no 30: 207‑38.[↩]
- Voir notamment à ce sujet Josep Rafanell I Ora, Fragmenter le monde, Paris, Divergences, 2018.[↩]
- https://intellectualhistory.web.ox.ac.uk/article/a-conversation-with-quinn-slobodian-crack-up-capitalism-penguin-2023[↩]
- J. Holloway, Crack Capitalism, Paris, Libertalia, 2016.[↩]
- Sur ce point, je me permets de référer au colloque Cerisy « Vers une politique des mondes ? » que nous avions co-organisé avec Laurent Jeanpierre et Pierre Sauvêtre en juin 2022, et dont les Actes seront prochainement publiés.[↩]
- Parmi de nombreux travaux à ce sujet, voir : Thomas Biebricher (2014), « Sovereignty, Norms, and Exception in Neoliberalism », Qui Parle, 23(1), 77–107. https://doi.org/10.5250/quiparle.23.1.0077; P. Dardot, C. Laval, Dominer. Enquête sur la souveraineté de l’Etat, Paris, La Découverte, 2020 ; J. Martin, The Meddlers: Sovereignty, Empire, and the Birth of Global Economic Governance, Harvard, Harvard University Presss, 2022.[↩]