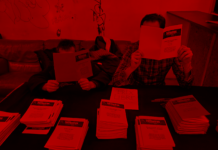Dagognet et Canguilhem, critiques d’une écologie sans visage
Dagognet et la nature suspecte
Pour de bonnes raisons, semble-t-il, Dagognet suspecte à la fois la valeur épistémologique et le contenu normatif de la notion de nature. Sur le plan épistémologique, soutient-il, concevoir la nature comme un modèle qu’il conviendrait d’imiter, ou comme un réservoir de secrets bienfaisants qu’il s’agirait de dévoiler et de consacrer, s’avère souvent contre-productif, voire fallacieux, comme dans le cas de la pharmacologie ou des techniques agricoles[1]. En outre, estime-t-il, la nature comme nature naturante, à laquelle nous devrions confier les procès de régulation techniques, productifs ou curatifs, est également une illusion trompeuse : une partie de la pratique médicale ne doit-elle pas, précisément, s’opposer à la lutte de l’organisme contre lui-même[2] ? L’agriculture comme pratique productive ne doit-elle pas répondre aux agressions des milieux contre certaines de leurs composantes ? Sur le plan normatif, Dagognet se montre encore plus incisif. La notion de nature promeut l’invariable, la stabilité, l’harmonie, et ne peut conduire nécessairement, explique-t-il, qu’à une régression lorsqu’elle est mobilisée en politique : le mythe de l’âge d’or justifie l’utopie des « fades bergeries[3] » et l’idée de nature humaine, nous motiverait, comme chez Hobbes, à défendre la dictature.
Comme le montre Xavier Guchet dans ce volume, la condamnation de la notion de nature chez Dagognet s’accompagne toutefois d’une réhabilitation et dans certains cas d’un éloge. En effet, tout en ne souscrivant pas aux « noires analyses » des naturalistes, Dagognet souhaite que la nature soit une source d’inspiration invitant à une « heureuse révision » de la société industrielle qui permettrait l’avènement d’une éco-industrie, luttant contre le gaspillage, recyclant les matériaux et contrôlant les débordements de l’industrie[4]. Face à l’économie capitaliste, où « les bénéfices maximisés et immédiats rongent la société industrielle[5] », Dagognet défend vigoureusement « l’éco-usine qui intègre de puissants correcteurs ». Plus encore, il conçoit la technique non seulement comme le prolongement des opérations qui s’effectuent dans la nature, mais également comme un moyen de réveiller cet « esprit qui dort ». Si la technique s’oppose à la nature, c’est seulement dans la mesure où elle n’est pas assez rationnelle, où elle est ce domaine du réel qui « ne parvient plus à se ressaisir et qui, à la limite, s’est perdu » : « [la] technique, par opposition à une nature profuse et aveugle, rationalise et économise. » C’est pourquoi Dagognet écrit que si l’industrie ne peut pas se passer de la nature, cette dernière doit en même temps jouer le rôle de repoussoir : elle est un « négatif qui l’aiguillonne. » Et c’est également la raison pour laquelle il ajoute : « A son insu, l’écologiste travaille, s’active en faveur de son adversaire[6]. »
Canguilhem critique de l’anti-technicisme
À n’en pas douter, la position de Dagognet se place avant tout sur le plan politique[7]. Elle est très proche de celle que Georges Canguilhem a exprimée dans une conférence prononcée à Strasbourg en 1973 et publiée en 1974[8]. Il y analyse ce qu’il estime être un basculement de l’écologie comme recherche scientifique à un « discours idéologique sur la Nature, discours ambigu et équivoque » débouchant sur une double sensibilité divergente : un anti-technocratisme de droite défendant la petite entreprise ou de gauche célébrant le « sauvage » ; un anti-technologisme mariant « apologie naïve, naturiste des produits agricoles ou horticoles dits biologiques » et la valorisation de ce qu’on appellerait aujourd’hui l’éco-tourisme. Tout comme Dagognet le dira plus tard[9], Canguilhem constate déjà l’effet « manifeste et alarmant » de l’industrie perturbant les différentes formes de vie et les cycles naturels ; la finitude des ressources organiques et minérales terrestres ; l’importance de l’écologie comme science qui « nous enseigne pourquoi et comment l’avenir de l’homme est enjeu. » Enfin, il admet d’emblée qu’on ne peut guère mener une réflexion sur ce sujet en niant le rôle déterminant sinon central du système d’économie.
Pour Canguilhem et Dagognet, l’écologie politique serait porteuse de valeurs plus que problématiques, oscillant entre « retour à », « solution de nostalgie sous l’empire d’un mythe » et « regret entêté de modes archaïques de culture[10] ». Canguilhem rappelle que « la technique est originairement la forme humaine de l’organisation de la matière par la vie » et qu’il faut cesser de dramatiser l’enjeu sous forme de dilemme irréconciliable : la technique ou la vie, pour lui préférer l’hybride de la technique et la vie. La perspective est donc celle d’une organisation de la technique au sens fort de régulation, c’est-à-dire faisant correspondre les besoins humains et les contraintes du milieu. Pour cela il faut « casser le ressort actuel du développement technique dans l’économie capitaliste », qui repose sur un imaginaire où la machine domine notre rapport à la nature[11]. L’objectif de cette mutation serait de remettre le processus économique sur ses pieds en cessant de subordonner la satisfaction des besoins à la logique de la production, de mettre un terme au décrochage croissant entre fabrication de désirs pour écouler la production et satisfaction des besoins.
Une cible indéfinie
Le rapprochement de ces deux critiques permet de mettre au jour chez Dagognet et Canguilhem une opération commune qui s’articule en trois moments : (i) déterminer les valeurs véhiculées par un ensemble de discours imputés aux naturalistes et aux écologistes qui en sont les incarnations récentes ; (ii) élucider les oppositions ou les amalgames fallacieux que revêt leur mobilisation du terme de nature ; (iii) proposer une réponse à la fois conceptuelle et normative qui les évite tout en répondant au souci moral suscité par les diagnostics de la détérioration grandissante des milieux de vie. Un tel enchaînement discursif témoigne à la fois de la volonté de s’approprier une question légitime apparaissant dans la société, tout en la dépouillant de traits trop encombrants, voire sulfureux, si l’on pense aux rapprochements qui peuvent être faits entre, d’une part, ce que disent Dagognet et Canguilhem des valeurs véhiculées par les écologistes ou les naturalistes et, d’autre part, et la façon dont la notion de nature a pu être mobilisée dans le domaine politique dans la première moitié du XXe siècle.
Si une telle ligne argumentative ne manque pas d’intérêt et peut s’avérer salutaire, quel effet est-elle capable de produire sur celles ou ceux qui la reçoivent ? En d’autres termes, en la prenant au sérieux, peut-on voir si les figures majeures de ce que Dagognet nomme les « naturalistes » correspondent aux critiques exposées ci-dessus? Trouvera-t-on chez les pionniers de la pensée écologiste des années 1970 et 1980 les travers relevés par Dagognet ? C’est à de telles questions que nous allons tenter de répondre dans un premier temps pour ensuite examiner les réponses proposées par Dagognet à la question écologique. Nous pourrons ainsi caractériser sa façon de la prendre au sérieux et de l’interpréter, et nous demander si, au fond, il n’a rien appris de la pensée écologique. Notre propos n’est pas de faire comparaitre la pensée de Dagognet devant le vénérable tribunal d’un courant de pensée qui lui était étranger, mais plutôt de détecter les signes d’une occasion ratée. Car les historiens et philosophes des sciences français auraient pu prendre en charge les les questions écologiques telles qu’elles ont été pensées dans la seconde moitié du XXe siècle mais la rencontre entre ces deux courants de pensée n’a pas eu lieu.
Dans les ouvrages que Dagognet consacre à la question de la nature, de l’industrie, des déchets et de l’agronomie, un adversaire unique est sans cesse convoqué, mais rarement incarné par des auteurs ou des courants. Cet adversaire a un nom, le naturalisme, mais pas de visage : le philosophe ne procède guère à une analyse de la littérature dite écologiste qu’elle soit militante ou savante. Ce problème de méthode autorise toutes les généralisations : « l’écologiste grossit le péril », « sème la peur », développe une « religion de la terre[12] », un « romantisme pleurnichard[13] ». Chez Dagognet, c’est surtout la figure de Rousseau qui incarne ce qu’il appelle le naturalisme[14]. Dagognet en attribue l’origine à l’auteur du Contrat Social : « Nous ne devons qu’à Jean-Jacques cette sorte de dévotion, ce “fameux amour de la nature”[15]. » Après Rousseau que Dagognet cherche à exorciser, c’est l’ombre de Ruskin qui semble envelopper presque entièrement la question de la nature lorsque l’œuvre dudit « champion du “naturalisme”[16] » est analysée en une dizaine de pages, dans une lecture d’ailleurs fort contestable[17]. Dagognet ne dialogue pas avec la mémoire du promeneur solitaire, pas plus qu’avec celle de l’écrivain et artiste britannique du XIXe siècle, mais plutôt avec l’esprit qu’ils auraient insufflé à certaines figures du courant écologiste qui se seraient entichées d’une nature « immuable », « bucolique[18] », « tristement ravagée par l’industrie », « d’un âge d’or[19] ». Ce courant auquel Dagognet répond est avant tout un mouvement social dont il est contemporain, qui émerge dans les années 1960 et porte à un point inédit l’audience de l’écologie comme question centrale des sociétés industrielles. Qui sont donc ces « ces philosophies contestataires et nihilistes, ces philosophies de l’apocalypse[20] », ces auteurs écologistes contemporains de Dagognet ?
Trois visages d’écologistes des années 1970 : Gorz, Charbonneau, Moscovici
André Gorz, Bernard Charbonneau et Serge Moscovici apparaissent comme trois interlocuteurs possibles, tous trois nés comme Dagognet dans le premier quart du XXe siècle, trois intellectuels qui publient articles et livres importants à partir des années 1960 jusqu’à la fin des années 1990 et trois acteurs impliqués dans diverses luttes écologistes au cours de cette période.
André Gorz (1923-2007) en tant que journaliste influent aux Temps modernes et surtout au Nouvel observateur où il publie son premier article sur la question écologiste en janvier 1970 puis participe en 1972 au hors-série du journal La dernière chance de la Terre écoulé à 125 000 exemplaires. Il collabore au mensuel Le Sauvage, supplément « écologie » du Nouvel Observateur publié à partir d’avril 1973. Ses articles sont repris dans Écologie et politique (1975) puis dans une Écologie et liberté (1978)[21]. Bernard Charbonneau (1910-1996) publie des articles dans Esprit dans les années 1930, dans Foi et vie dans les années 1950, puis de manière régulière dans plusieurs revues écologistes à partir de 1972 dans La Gueule ouverte, Combat-Nature, et l’hebdomadaire protestant Réforme[22]. Parmi plusieurs engagements, il s’est notamment illustré dans la création avec Jacques Ellul en 1973 du Comité de défense de la côte aquitaine pour aider victorieusement les populations locales dans leur lutte contre le développement du tourisme de masse, semblable à celui qu’à connu la côte d’Azur à partir des années 1960[23]. Serge Moscovici (1925-2014), dont les travaux fondateurs de la psychologie sociale ont été internationalement reconnu[24], est l’un des théoriciens de premier plan du mouvement d’écologie politique en France[25]. Il participe en 1970 à la naissance de l’association des Amis de la Terre, parrainée par Claude Lévi-Strauss[26]. Il écrit lui aussi dans Le Sauvage et une série d’ouvrages fondateurs dont Essai sur l’histoire humaine de la nature (1968) et La Société contre nature (1972).
Gorz, Charbonneau et Moscovici représentent bien, à la fois comme source d’inspiration et comme acteurs, une partie du mouvement social écologiste des années 1960 et 1970. Leurs interventions bifaces, savante et militante, les placent au cœur de la cible des attaques de Dagognet. Il est donc pleinement légitime pour notre propos de reconstituer un dialogue entre ces quatre auteurs. Il ne s’agit pas de construire avec ces auteurs un « dialogue Potemkine », une scène postiche et factice qui mobiliserait des intellectuels commodes pour incarner le naturalisme qui irrite tant Dagognet. L’enjeu pour ces intellectuels est tout autant la définition qu’ils donnent de la nature que les perspectives politiques qu’ils fondent à partir de celle-ci. Le point de départ et le point d’arrivée de leur pensée écologique sont le « monde vécu » chez Gorz, le « style de vie » chez Charbonneau, et des « formes de vie » chez Moscovici, c’est-à-dire une mise en question radicale des modes de production des marchandises et des artefacts techniques autant que des subjectivités.
André Gorz, la nature antihumaine et l’humain comme être antinature
Qui a écrit : « La nature, par elle seule, mène au fouillis, sinon au chaos. Ce sont les hommes qui ont régularisé les fleuves, protégé et aménagé leurs terres et, même par leurs plantations, régularisé jusqu’au climat[27] » ? Et qui, dans un même élan, a semblé répondre au premier :
La Nature n’est pas bonne pour l’homme. Elle n’est pas un jardin planté pour lui. La vie humaine sur terre est précaire et, pour s’épanouir, elle a besoin de déplacer certains équilibres de l’écosystème. […] La Nature n’est donc pas intangible. Le projet « prométhéen » de la « maîtriser » ou « domestiquer » n’est pas nécessairement incompatible avec le souci écologique[28] ?
Dagognet est l’auteur en 1990 de la première citation et Gorz de la seconde en 1977. Mais reconnaissons d’emblée qu’il est difficile de soupçonner un antagonisme dans les positions de ces deux auteurs. Dans la suite de ses œuvres, Gorz affirme sans ambiguïté le caractère agonistique du rapport entre humains et nature : le domaine de l’homme s’étend dans l’exacte mesure où l’empire de la nature recule. Fidèle en cela à Marx, Gorz fait du travail et de l’inventivité technique une caractéristique anthropologique fondamentale. La culture prise au sens le plus large du terme est donc une activité visant à s’émanciper de la nature et à transformer à l’avantage du monde humain le donné naturel. Pour autant, ce rapport de transformation et de domination entraîne, dans le cas des sociétés industrielles, la destruction de la nature, son aliénation complète, d’où le « problème du rapport moral de la liberté à la nature » qu’a tenté d’élucider Gorz dans une partie de son œuvre. Notons simplement que l’enjeu central d’une société écologique est l’émergence d’une culture où l’autolimitation des besoins permet d’éviter la destruction des bases naturelles nécessaires au développement de la vie : « Actuellement, il s’agit de restreindre à nouveau les droits de la raison économique en la subordonnant à des buts écologiques et sociaux, sans pour autant renoncer aux libertés, aux droits des personnes à l’autodétermination et à l’épanouissement[29]. » À partir des années 1970 au cours desquelles il rencontre les enjeux écologiques, Gorz insiste sur l’interdépendance profonde et la circularité féconde entre la critique du capitalisme et l’approche écologique de critique des besoins qui prend la forme générale d’une critique culturelle et existentielle de la vie quotidienne, qui « conduit en retour à approfondir et à radicaliser encore la critique du capitalisme[30] ».
Bernard Charbonneau, l’auto-engendrement de l’homme et de la nature
Le géographe et philosophe bordelais Bernard Charbonneau partage avec Gorz la même suspicion contre tout usage fétichisé de la nature[31]. Dans un ouvrage important, Le jardin de Babylone, publié en 1969 par les éditions Gallimard vingt-cinq ans après sa rédaction, Charbonneau rappelle que nommer et parler de la nature est un geste propre aux modernes qui découvrent le sentiment de la nature au moment où ils la maîtrisent. Auparavant, , il n’y avait donc pas de nature, mais un ordre sacré : « Paysans et païens, ils ne pouvaient aimer la nature ; ils ne pouvaient que la combattre ou l’adorer[32]. » À partir de la « Grande Mue » technico-industrielle, utiliser le terme de nature revient à évoquer la naissance de l’individu, son désir de liberté : « La nature n’est qu’un des noms que celui-ci s’est donné, […] n’est qu’un des noms de sa liberté[33]. ». On ne peut guère faire un usage plus profane du concept de nature que de l’associer à l’émergence de l’individu dans sa quête moderne d’autonomie.
Charbonneau rappelle qu’il faut envisager la nature dans sa double signification historique, à la fois comme milieu d’où l’espèce humaine a émergé, « l’homme n’est qu’une des formes de la nature vivante », et comme construction historique, « invention des temps modernes ». Cette dialectique offre un matérialisme ouvert rétif à toute vision mythifiée : « La nature est à la fois la mère qui nous a engendrés, et la fille que nous avons conçue ; si elle venait à disparaître, c’est l’homme qui retournerait au chaos. Donc c’est lui qu’il s’agit au fond d’illustrer et de défendre[34]. » Nulle trace ici d’une nature « immuable » évoquée par Dagognet, car la nature est un processus inachevé pris dans un devenir historique.
Alors que Dagognet assimile régulièrement l’écologie à une idéologie abstraite, anhistorique, et les écologistes à des bavards incapables de comprendre la nature comme une construction sociale, Charbonneau, en fin géographe et observateur patient des campagnes européennes, ne cesse d’étudier et de célébrer la lente superposition de l’action de la nature et des techniques humaines, cette trame mêlant jaillissement de la vie et main de l’homme au contenu indissociablement technique et naturel[35]. C’est précisément dans l’invention des paysages qui témoignent de la soumission réciproque – de l’homme à la nature, de la nature à l’homme – qu’on en voit la forme accomplie[36] : en cela, Charbonneau s’accorde parfaitement avec le mot d’ordre de Canguilhem, la technique et la vie.
Serge Moscovici, la nature comme rapport historique
Dès le commencement du volumineux Essai sur l’histoire humaine de la nature[37] Serge Moscovici alerte sur les nouveaux pouvoirs à disposition des sociétés humaines :
En effet, consciemment, méthodiquement, nous sommes à même d’intervenir dans l’équilibre biologique de la plupart des espèces végétales ou animales, de les préserver ou de les détruire, d’aménager le climat, de modifier le cycle des transformations énergétiques, notre action géomorphique ne connaît plus de limites[38].
La nature serait-elle en danger ? La question ainsi formulée pourrait bien être un contre-sens selon Moscovici, pour deux raisons. D’une part, la nature est la matière organisée historiquement, notamment par l’activité humaine. Par conséquent elle ne peut être menacée, à moins d’imaginer la disparition intégrale et imminente de la matière elle-même. D’autre part, il n’existe pas d’opposition de principe entre le naturel et l’artificiel car les artifices humains ont toujours fait partie de la nature. « Un art ne fait pas reculer la nature : mais un état de celle-ci est bouleversé par l’apparition d’un autre état. Cela ne signifie pas la transformation du monde naturel en monde technique, mais l’évolution du monde naturel lui-même[39]. » Donc la technique n’est pas anti-nature et l’humanité ne possède ni ne révèle la nature, elle en est à la fois un facteur interne et un régulateur[40].
Le « naturalisme », terme que Moscovici emploie à l’instar de Dagognet, se présente comme un « passager clandestin de notre histoire », contre lequel se sont dressés les plus grands philosophes, tout en faisant de la nature une effigie[41]. Ce déroutant paradoxe, Moscovici l’explique par un dilemme qui traverse notre histoire, à savoir l’alternative entre, d’une part, « l’homme ou la nature » (culturalisme) et, d’autre part, « l’homme et la nature » (naturalisme). La première option, qui domine nos représentations, soutient et promeut l’idée de « séparation de l’homme et de la nature, de l’histoire et de la nature, de l’esprit et de la matière, des sciences de l’homme et des sciences de la nature[42] ».
Le naturalisme, au contraire, souligne l’unité des termes : la société n’a jamais été séparée de la nature, il n’y a jamais eu de rupture anthropologique radicale[43]. Il vise la refondation des rapports entre société et nature[44], car toute organisation sociale est également une organisation naturelle, et vice-versa. Par conséquent, tout changement social, toute création de nouveaux types de connaissance ou de nouvelles techniques, institue un nouveau rapport à la nature qui est implicitement « choisi » – qu’il s’agisse de la prohibition de l’inceste ou des réseaux de télécommunication. C’est ce choix que le naturalisme exhibe et souhaite rendre digne de nos scrupules moraux. Il cherche à le rendre politique, à l’investir de valeurs, car nos mondes en sont affectés[45].
L’écologie de Dagognet
Aucun de ces trois pionniers de l’écologie politique n’illustre la quête d’un âge d’or, d’un retour à une nature bienfaisante, d’un appel à soumettre le politique, les savoirs ou les arts à un ordre préétabli dont l’harmonie aurait été brisée par la modernité industrielle. Bien plutôt, ces penseurs, qui sont aussi des activistes, voient dans la question écologique un inédit historique qu’il s’agit de prendre au sérieux en tant qu’il requiert que soit pensée de façon critique notre histoire, tout en proposant une vision originale des rapports possibles avec la nature.
La tentation du socialisme saint-simonien
Nous l’avons vu, Dagognet s’accorde avec le diagnostic des écologistes lorsqu’il évoque « les immenses dégâts liés à une industrialisation sans retenue ni garde-fous[46] », autant qu’il voit en la nature un correctif à l’agir industriel. En outre, il va jusqu’à retenir trois principes fondamentaux des savoirs écologiques : 1) l’interdépendance des phénomènes naturels et leur complexité peuvent être une source d’inspiration pour une « néo-rationalité bioéconomique » ; 2) en élargissant le cadre spatio-temporel habituel, l’écologie offre une vue plus juste des interactions naturelles et, par extension, des effets des actions humaines ; 3) enfin, parce qu’elle décrit le vivant dans toute sa complexité, l’écologie complique les schémas classiques d’appréhension du monde, exclusivement quantitatifs[47]. Cette proposition est intéressante, en ce qu’elle exprime le souci de tirer les conséquences de l’écologie scientifique dont s’est beaucoup inspirée la pensée écologique[48]. Mais on peut se demander comment Dagognet parvient à rendre de tels principes compatibles avec son industrialisme revendiqué.
Rappelons en effet qu’à ses yeux, attaquer le productivisme ou développer une critique radicale de la société industrielle, revient à nier « sa rationalité et son éminence ». Dagognet suggère même de faire du développement historique des deux cent cinquante dernières années une caractéristique anthropologique : « Non pas Homo faber mais homo industrialis ! » La position de Dagognet s’inscrit ainsi dans le socialisme saint-simonien qui met au cœur de sa philosophie sociale l’importance d’une élite scientifique organisée, qui oriente vers la planification et la centralisation.
Deux exemples sociotechniques choisis par Dagognet peuvent illustrer la façon dont il tente concrètement de concilier le progrès technique et l’attention aux dégâts qu’il occasionne. Premièrement, Dagognet réfute la critique écologiste de la technique moderne selon laquelle un certain nombre de technologies (immenses réseaux de transport, biotechnologies, complexes chimiques, centrales nucléaires) favorisent les structures verticales, la bureaucratie, et finalement échappent au contrôle des citoyens, provoquant ainsi une aliénation généralisée. Dagognet se concentre sur le nucléaire qu’il défend vigoureusement en appelant à un renforcement de la surveillance et du confinement, en estimant que les déchets sont remarquablement bien gérés et que le nucléaire est l’exemple paradigmatique d’une rationalité maîtrisée :
Jamais la société technicienne n’a autant réussi ni aussi bien su créer un univers cohérent, organisé, par où elle s’autonomise : l’uranium se trouve en abondance dans le monde ; l’eau des océans en fournirait. On sait encore retraiter celui dont on a usé : on en retire les déchets, on récupère ce qui en reste, donc joue pleinement l’économie des moyens. En somme, c’est la nature qui gaspille et non pas l’industriel. […] La technique, par opposition à une nature profuse et aveugle, rationalise et économise[49].
Dans cette perspective, ce serait une erreur de se fier à la « nature » puisque la rationalité industrielle est mieux à même de prendre en compte les principes écologiques. Mais la nature nous montre un chemin nucléaire encore plus radieux dans cette centrale qui brûle au-dessus de nos têtes : « Et elle fonctionne si bien (non par la fission, mais par la fusion nucléaire) qu’elle réintroduit justement ses opérateurs, voire ses déchets, dans ses réactions d’autofabrication (lumière et chaleur)[50]. »
Sur l’agronomie, Dagognet défend une position très tranchée, dans Des révolutions vertes. Se fondant sur une critique du vivant, au « rendement » défectueux, incapable de bien synthétiser l’énergie lumineuse qu’il reçoit[51], il soutient qu’il faudrait « changer « le moteur végétal » lui-même, au rendement particulièrement bas. L’agrobiologie[52] futuriste mettra fin aux derniers restes du naturalisme tenace : après la mort des villages et la disparition des paysans, celle de la terre et même des végétaux[53]. » Dans un paragraphe programmatique intitulé « vers la pomme éprouvette », il s’enthousiasme pour les records de production, les cadences, la production de viande à la chaîne, calibrée scientifiquement, automatisée puis célèbre l’avènement prochain d’une agriculture qui se sera complètement débarrassée de son substrat originel[54], désormais dispensable, car il « complique ou retarde » : « Ainsi l’agrobiologie ne cesse-t-elle de descendre une pente qui élimine tour à tour, après les paysans, le paysage lui-même, les pluies, les arbres, les feuilles, le soleil[55] ». Dagognet chante également les vertus de la monoculture sur des fermes de cent hectares (une surface considérable dans les années 1970), annonce que l’accomplissement de l’agronomie, qui prend le nom d’agrochimie, se fera dans la fusion avec l’industrie « qui finit par l’absorber entièrement[56] ». La longue marche de la raison dans l’histoire du champ est présentée comme un récit d’émancipation : rationalisation de l’espace, optimisation des intrants puis des plantes elles-mêmes, « outils végétaux » ou même « plante-usine[57] ».
Quelle place occupe la nature dans cette vision de l’agronomie ? Si Dagognet fustige le refus des engrais chimiques sous prétexte qu’ils seraient artificiels[58], il approuve toutefois les méthodes qui se servent de la nature pour « la retourner contre elle », comme les procédés de sylviculture qui utilisent certaines espèces afin de repousser des nuisibles au lieu de passer par de la chimie[59].
Dans les deux cas, Dagognet défait les a priori naturalistes pour montrer que les techniques envisagées ne sont pas des violations de l’harmonie supposée de la nature. Au contraire, les techniques améliorent les procédés naturels, organisent de façon plus efficace la production, sont capables de maîtriser rationnellement le métabolisme des plantes et animaux, voire permettent de se passer de ce qui apparaissait comme des paramètres inaliénables et fondamentaux de l’humaine condition. Ce dernier point est sans doute le plus important, car il dénote ce à quoi tient vraiment Dagognet, à savoir que la condition humaine, en tant qu’ensemble de facteurs conditionnant non choisis et radicalement contingents, est, en droit, entièrement révocable à l’aune de ce que peut la rationalité technique. L’écologie n’est utile que lorsqu’elle permet d’améliorer la condition humaine. En cela Dagognet est parfaitement cohérent avec le rôle qu’il assigne à la nature.
Eco-industrie et techno-providentialisme
Afin d’étayer ce point, il faut restituer les positions de Dagognet sur l’évolution des sociétés modernes au cours des deux derniers siècles. Dans son livre sur la question agricole, Dagognet livre une vision d’ensemble où une collectivité consciente, plus exactement une élite scientifico-technique, est à l’origine des changements agricoles. S’inscrivant dans les pas de Marx, Dagognet décrit le capitalisme comme opérateur historique de transformations nécessaires : la capacité de dissolution des formes passées et des « techniques rudimentaires[60] » et la puissance de concentration des moyens techniques a fait du capitalisme « l’une des plus grandes inventions de l’homme[61] ». Pour autant, ce n’est qu’un système transitoire qui va devenir prochainement obsolète puisqu’il freine ou retarde le mouvement du progrès par rapport à l’actuel stade technique de l’humanité, guidée par la science qui « parvient à imposer des fins nouvelles ». D’après la généalogie de cette situation que propose Dagognet, l’humanité semble néanmoins prise dans un devenir historique au-delà du politique : « Impossible de revenir en arrière. Il convient, au contraire, d’accélérer le mouvement : l’histoire des sciences, qui réactive la courbe du passé, nous permet d’entrevoir l’avenir, d’accomplir notre destin[62]. » La politique, entendue comme réflexion collective ininterrompue sur les finalités et les moyens qu’une communauté se donne, s’efface derrière la science, qui s’affirme comme le grand récit « émancipateur » indiscutable.
En suivant la distinction proposée par le philosophe Bruce Bégout entre deux schémas linéaires du temps du progrès, l’eschatologie et la téléologie, on pourrait suggérer que le terme de « techno-providentialisme » s’appliquerait mieux à la posture de Dagognet que celui de « techno-messianisme » parfois utilisé[63]. Bégout rappelle en effet que l’eschatologie est de type messianique (événement soudain et inattendu) alors que la téléologie est de type providentiel (la finalité se dévoile progressivement) : « L’eschaton advint là où le telos devient[64]. » Tandis que l’eschatologie envisage la fin comme un terme (un événement – religieux ou révolutionnaire – coupant l’histoire en deux, elle est marquée par la discontinuité), la téléologie renvoie à la finalité comme tension vers un but (le cours temporel est continu et extensif). L’attention portée à un processus graduel et irréversible (orienté vers un monde meilleur) caractérise la téléologie, davantage que la destination qui relève d’une pensée eschatologique[65].
Et c’est sur ce point que Dagognet se différencie de Moscovici, bien qu’il partage largement sa critique du naturalisme comme sa vision de la technique et des sciences. Au lieu d’adhérer à l’idée de rationalité émancipatrice dans l’histoire humaine, Moscovici n’établit aucune hiérarchie entre les différents rapports historiques à la nature. De plus, les sciences et les techniques, si elles ne sont pas en elles-mêmes problématiques, sont inscrites dans des structures sociales[66], que l’écologisme remet légitimement en question – raison pour laquelle Moscovici appelle les écologistes à s’allier aux scientifiques[67]. Dagognet ajoute à ces deux thèses que l’automatisation est essentielle pour l’accroissement de la productivité[68]. Ainsi affirme-t-il que le progrès technique « constitue l’essence de l’homme et instaure le champ de sa liberté[69] ». La technique est ce qui sert la rationalité, rend « l’homme plus ouvert et le délivre aussi des plus noires superstitions[70] ». En tant qu’elle s’incarne historiquement dans un système productif, l’industrie, elle nous fait entrer, dit Dagognet, dans « un univers entièrement construit libéré de ses contraintes[71]». La machine étant source de « prodigieux accroissements » en termes de vitesse, d’efficacité et de puissance énergétique, Dagognet distingue l’industrie par trois avantages :
- a) l’autonomie. Elle [la machine] ne dépend plus de l’eau ou de la vallée. Et si l’énergie électrique relève encore du barrage, l’industrie ne manque pas de la transporter partout, sans la gaspiller en cours de chemin ;
- b) la liberté des ressources de départ, puisque le polyéthylène peut aussi bien venir des hydrocarbures que des résidus végétaux ;
- c) le souci de puiser dans le « presque rien », l’offert, le simple, le délaissé, de quoi composer les ensembles les plus architecturés, qui réunissent en eux des attributs antithétiques[72].
À ceux qui objecteraient que les produits synthétiques s’opposent à la nature, Dagognet répond que ces derniers évitent la consommation des espaces chéris par les naturalistes à l’instar des forêts[73]. La seule alternative Devant aux pollutions et aux risques provoqués par l’industrie, que Dagognet reconnaît et déplore, est l’« éco-industrie ». Face aux grandes catastrophes (Amoco Cadix, Bophal, Tchernobyl), il serait déraisonnable d’interdire les industries nucléaires ou chimiques. Il faut toutefois multiplier « les « garde-fous » et les stratégies de défense. » L’éco-industrie « sait filtrer, incinérer, raffiner, épurer, décanter, recycler […] », et Dagognet adoube le mouvement écologique à condition qu’il se cantonne à la promotion des obligations et des contrôles, des investissements dans « l’hygiène, la sécurité et l’épuration des eaux comme des airs ». Notre monde n’est pas détruit par l’usine, le rôle de cette dernière est plutôt d’organiser les énergies pour le modifier : la lutte écologique n’est admissible, louable et légitime que pour préserver les milieux, « sans nuire à la marche des fabriques[74]».
Certes l’éco-industrie n’est pas une invention de Dagognet. C’est un champ de recherche actif qui a émergé dans les années 1970 et dont l’ambition fondamentale était de prendre en compte ce que l’économie appelait les « externalités environnementales ». Partant, cette éco-industrie se propose de penser des « symbioses industrielles », réhabilitant les déchets (matériaux, énergie, flux de toutes sortes) en matière première[75]. L’historien Jean-Baptiste Fressoz a montré que cette idée n’est pas récente, mais déjà promue au XIXe siècle par les industriels soucieux de rendre plus acceptables les pollutions en combinant des métabolismes vertueux et l’économie libérale, une idée très tôt contestée[76]. De plus, l’idée que l’industrie émancipatrice accroît sa rationalité en parvenant enfin à recycler les matériaux pour reboucler les flux de matière, ignore que l’avènement de la société industrielle est précisément l’histoire de la destruction des pratiques de recyclage populaires très largement répandues jusqu’à la fin du XIXe siècle[77].
Ce problème fait signe vers une ambiguïté fondamentale des positions de Dagognet qui l’apparente à celle de l’un des pionniers de la géochimie, Vladimir Vernadsky. Lorsque à propos de la dynamique des sociétés industrielles, Dagognet explique que « la libération se trouve au terme du mouvement en cours[78] », il est difficile de ne pas le rapprocher d’un article de 1925 où Vernadsky imaginait comment l’humanité pourrait faire face aux limites de la biosphère sur le plan de l’énergie et de la production agricole[79]. En conquérant d’une part des énergies « inépuisables », comme la force des marées, l’énergie atomique et le soleil et, d’autre part, en utilisant directement l’énergie solaire afin de synthétiser les aliments, nous pourrions nous affranchir de la consommation des êtres vivants, et court-circuiter le cycle de la vie organique, dont la structure fondamentale repose sur la captation et l’accumulation d’énergie par les végétaux. Et Vernadsky de résumer sa grande thèse : d’être hétérotrophe (qui se procure sa matière organique en la prélevant sur d’autres organismes), l’homme doit devenir autotrophe (qui transforme la matière inorganique en matière organique par la géochimie). Conscient de la radicalité de sa proposition, Vernadsky soulignait que « ce fait serait le couronnement d’une longue évolution paléontologique, représenterait non une action de la volonté libre humaine, mais la manifestation d’un processus naturel. »
Tout comme Vernadsky, Dagognet reconnaît les attaches de notre condition de terriens, les spécificités évolutives qui nous lient aux autres vivants par des relations de prédation ainsi que la finitude de l’énergie techniquement disponible. Mais il ne conclut pas come Vernadsly que ces attaches sont inamovibles. Il estime qu’aucune attache n’est absolue dans notre condition, qui est précisément d’arrachement radical. C’est donc essentiellement dans le refus de prendre soin de nos attachements de terriens que Dagognet s’oppose à l’écologie politique[80].
Conclusion
Dagognet a donc procédé à une mise en scène du naturalisme pour affirmer qu’il « sert principalement à nier tout changement[81] ». Comme le montre de bref survol de la pensée de trois naturalistes, penseurs et activistes contemporains de Dagognet, le courant écologiste français ne se reconnaît pas dans cette proposition. Finalement, Dagognet donne vie à un théâtre écologiste largement dépeuplé. Il présente quelques arguments avec peu de générosité, et bien des positions et des orientations qu’il attribue à l’écologie ne correspondent pas aux œuvres de ses principaux théoriciens. Dagognet évoque « l’écologisme » comme s’il s’agissait d’une doctrine unifiée, mais il n’en donne aucune définition précise, et il utilise fréquemment comme cible de ses critiques un terme générique « l’écologiste » où l’usage du singulier renvoie à une représentation unidimensionnelle personnifiant le tout de l’écologie, écrasant la pluralité des approches sous une figure tutélaire. De par leurs attaques contre l’écologisme, Dagognet et Canguilhem rejoignent le train des critiques adressées à la pensée écologique dans les années 1990 par un certain nombre d’auteurs français, qui décelaient sous un prétendu amour inconditionnel de la nature la haine de l’homme[82].
Cependant chez Dagognet, comme chez Canguilhem, le rejet de l’écologisme s’accompagne d’un radicalisme politique. En effet, Dagognet se montre très critique à l’égard du capitalisme, et défend un socialisme de teinte saint-simonienne qui ouvre un horizon politique ambitieux. En un sens différent, Canguilhem appelle à une réorientation complète de l’appareil productif, dans son fonctionnement comme dans ses finalités.
Or, on l’a vu, Gorz, Charbonneau et Moscovici développent une perspective émancipatrice redessinant profondément la vie sociale, économique et culturelle des sociétés industrielles, au-delà du capitalisme ou en tout cas sous une forme métamorphosée. Canguilhem croit et donne à penser que les discours écologistes et critiques du capitalisme « ne mettent pas en question une conception de la technique héritée du siècle des Lumières », alors que c’est précisément tout le contraire[83]. Serge Audier a récemment montré que les antinomies qui servent à caractériser et finalement à disqualifier la pensée écologique à travers les couples d’opposition tels que société ouverte/fermée et Lumières/anti-Lumières, par une partie des commentateurs se révèlent globalement inopérante[84]. En un sens, c’est Dagognet lui-même qui durcit la notion de nature, qui « naturalise la nature » en enfermant le naturalisme dans une politique purement réactionnaire, et en n’admettant pas que cette notion puisse être investie autrement pour pointer vers ce que Moscovici appelle le culturalisme.
Finalement, c’est peut-être une réflexion sur le concept de milieu qui permet aux philosophes français de penser ensemble technique et écologique comme le suggèrent Victor Petit et Bertrand Guillaume[85]. Cette articulation ouvre une réflexion sur les types historiques de socialisation de la nature, permettant de dépasser l’idée commune d’une écologie fusionnant avec la nature tout comme l’éco-industrie. Faut-il imputer le rendez-vous manqué entre le courant français d’histoire et de philosophie des sciences françaises et la pensée écologique française à une incompatibilité entre ces philosophies ou bien aux excès de généralisation de Dagognet et Canguilhem dans leur traitement du naturalisme ? L’échantillon de penseurs écologistes que nous avons examiné suggère qu’il n’y avait pas vraiment incompatibilité mais plutôt une vision caricaturale des « naturalistes » chez Dagognet et Canguilhem. Le Dagognet des années 1990 ne semble pas vraiment éloigné des penseurs écologistes en qui concerne la vision de la nature. Mais sur la vision du progrès et de la société industrielle, l’écart est considérable. Peut-être la disparition de tous ces penseurs au cours des vingt dernières années incitera-telle à les lire en rendant justice à chacun, par-delà les anathèmes répétés qui ont retardé l’émergence et la visibilité en France d’une philosophie de l’écologie et d’une écologie des techniques.
L’on peut même pour finir imaginer un dialogue post-mortem entre ces deux traditions philosophiques sous le signe d’une pratique agricole, domaine cher à Dagognet,: la permaculture née en Australie au début des années 1970[86]. Cette technique de mise en culture du sol combine, en effet, des caractéristiques qui paraissent habituellement antagonistes. Un écosystème pensé et construit en permaculture est le comble de l’artifice : le paysan-technologue métamorphose l’espace naturel qu’il cultive. Elle réussit à concilier productivité à l’hectare, diversité des cultures et des variétés, rentabilité économique, enrichissement du sol et création d’humus, stockage de CO2, faible dépense énergétique, résilience des milieux, beauté de l’écosystème pour dessiner une sorte d’optimum agricole. Loin de s’appuyer sur une vision idéalisée de la nature qu’il s’agirait de garder intacte, elle suppose une intervention très forte sur le milieu et un savoir théorique et pratique avancé[87]. Un tel cas concret de technique offre un terrain propice pour rêver à une réconciliation possible entre Dagognet et les penseurs écologistes.
Texte a paraître dans Jean Gayon et Bernadette Bensaude-Vincet (dir.), Actes du colloque Dagognet (12-2016), Editions matériologiques, Paris (A paraître en 2018)
[1] F. Dagognet, La raison et les remèdes, Presses Universitaires de France, 1964 et F. Dagognet, Des révolutions vertes. Histoire et principes de l’agronomie, Hermann, 1973.
[2] X. Guchet, « La nature jugée par François Dagognet », dans cet ouvrage.
[3] F. Dagognet, Considération sur l’idée de nature, Vrin, 1990, p. 160.
[4] Ibid., p. 17, nous reviendrons sur ce point plus en avant.
[5] F. Dagognet, L’essor technologique et l’idée de progrès, Arman Colin, 1997, p. 125.
[6] F. Dagognet, Considérations sur l’idée de nature, op. cit., citations respectives p. 135, 180, 170, 144 et 18.
[7] Nous reprenons ici la conclusion de l’article de Xavier Guchet présent dans ce volume. et orienter avons e avons axaminé
[8] Que l’on retrouve également en texte annexe de la réédition en 2000 de F. Dagognet, Considérations sur l’idée de nature, op. cit. La conférence de Canguilhem s’appuie d’ailleurs sur l’ouvrage de Dagognet, Des révolutions vertes. Histoire et principes de l’agronomie, op. cit.
[9] Au début des années 1970, les positions de Canguilhem et Dagognet convergent sur la critique du naturalisme mais ne se recoupent pas sur le diagnostic de la crise écologique : Canguilhem la prend tout à fait sérieux, ce que fera Dagognet seulement vingt ans plus tard, quoique de manière incomplète.
[10] Sur cette critique du naturalisme, voir également G. Canguilhem, « Nature dénaturée, nature naturante », in Savoir, faire, espérer : les limites de la raison, Publications des Facultés Universitaires Saint Louis, t. 1, 1976, p.71.
[11] Imaginaire que Canguilhem qualifie de « machination ».
[12] F. Dagognet,, Considérations sur l’idée de nature, op. cit., p. 186, 180, 176.
[13] F. Dagognet, Des révolutions vertes. Histoire et principes de l’agronomie, op. cit., p. 163.
[14] Rousseau est mobilisé dans deux de livres : F. Dagognet : Considérations sur l’idée de nature, op. cit., et L’invention de notre monde, Encre Marine, 1995.
[15] F. Dagognet, Considérations sur l’idée de nature, op. cit., p. 12.
[16] Ibid., p. 100.
[17] Pour une lecture contrastée et bien plus nuancée, irréductible à une pensée réactionnaire, voir S. Audier, La société écologique et ses ennemis. Pour une histoire alternative de l’émancipation, La découverte, 2017, p. 299-305 ; pour une approche plus générale voir P. Jaudel, La pensée sociale de John Ruskin, Marcel Rivière, 1972.
[18] F. Dagognet, L’invention de notre monde, op. cit., p. 185.
[19] F. Dagognet, Considérations sur l’idée de nature, op. cit., p. 18.
[20]F. Dagognet, L’invention de notre monde, op. cit., p. 86.
[21] Voir W. Gianinazzi, André Gorz, une vie, La découverte, 2016, p. 198-203. Pour une introduction intellectuelle à Gorz, voir F. Gollain, « André Gorz, un marxiste existentialiste. L’histoire et le sujet de l’histoire », La Revue du MAUSS, n° 34, , 2009, p. 349-367.
[22] Pour la bibliographie de Bernard Charbonneau, voir J. Prades dir. Bernard Charbonneau : une vie entière à dénoncer la grande imposture, Éditions Érès, 1997, p. 213-220.
[23] Pour une introduction à sa vie et à sa pensée, voir D. Cérézuelle, Écologie et liberté. Bernard Charbonneau, précurseur de l’écologie politique, Parangon, 2006.
[24] Pour une présentation de cet aspect de son œuvre sous un angle biographique voir Ohayon Annick, « À Serge Moscovici (1925-2014) », Nouvelle revue de psychosociologie, 1/2015 (n° 19), p. 235-240.
[25] Voir S. Lavignotte, Serge Moscovici ou l’écologie subversive, Neuvy-en-Champagne, Le passager clandestin, 2016.
[26] W. Gianinazzi, André Gorz, une vie, op. cit., p. 199 et 202.
[27] F. Dagognet, Considérations sur l’idée de nature, op. cit., p. 8.
[28] A. Gorz, Ecologie et politique, Seuil, 1978 (1977), p. 28. Pour un approfondissement de cet aspect de la pensée de Gorz, voir W. Gianinazzi, André Gorz, une vie, La Découverte, 2016, p. 196-197.
[29] A. Gorz, « La vie, la nature, la technique », in André Gorz, Le fil rouge de l’écologie. Entretiens inédit en français, Editions de l’EHESS, 2015, p. 19-81.
[30] A. Gorz, Ecologica, Galilée, 2009, p. 15.
[31] Sur la critique précoce de la nature comme catégorie réifiée, voir le texte de jeunesse, Le sentiment de la nature, force révolutionnaire in Bernard Charbonneau, Jacques Ellul, Nous sommes des révolutionnaires malgré nous. Textes pionniers de l’écologie politique, Seuil, 2014, p. 119-192 et p. 123-124. En 1980, Charbonneau propose un premier bilan du mouvement écologiste, une critique sans concession de ses impasses dogmatiques et politiques, voir Bernard Charbonneau, Le feu vert, Parangon, 2009 (1980), et notamment sur le fétichisme de la nature, p. 169-174.
[32] Bernard Charbonneau, Le Jardin de Babylone, Gallimard, 1969, p. 10.
[33] Ibid., p. 11 et 27.
[34] Ibid., p. 28, 17, 12.
[35] Parmi les vingt ouvrages qu’il a publiés, signalons B. Charbonneau, Le Jardin de Babylone, op. cit., ; La fin des paysages, Anthropos, 1972 ; Tristes campagnes, Denoël, 1973 ; Notre table rase, Denoël, 1974 ; Un festin pour Tantale. Nourriture et société industrielle, Sang de la terre, 1997.
[36] Ibid., p. 26, 74, 75, 77.
[37] Dagognet semble avoir lu l’Essai de Moscovici puisqu’il cite une fois une reprise de citation de Kepler (F. Dagognet, Considérations sur l’idée de nature, op. cit., p. 162). Mais Dagognet n’a guère plus d’égard pour un penseur qui a pourtant consacré une œuvre majeure à la question de la nature.
[38] S. Moscovici, Essai sur l’histoire humaine de la nature, Flammarion, 1977 (1968), p. 7.
[39] Ibid., p. 36.
[40] Ibid., p. 20. Pour plus de détail sur l’inspiration bachelardienne de ce point, voir ibid., p. 390-415.
[41] Ibid., p. 10-12.
[42] Ibid., p. 90.
[43] Serge Moscovici en fait la démonstration sur le plan paléoanthropologique, anthropologique, éthologique, dans La société contre nature (1972).
[44] S. Moscovici, Hommes domestiques et hommes sauvages, op. cit.,, p. 91. Dans un entretien avec Pascal Dibie, Moscovici dit de l’écologie post mai 68 : « pour moi, il s’agissait de mouvements que j’ai appelé naturalistes, c’est-à-dire qui ont tenté au cours des siècles de changer les rapports entre la culture et la nature. » Serge Moscovici, Réenchanter la nature. Entretiens avec Pascal Dibie, Editions de l’Aube, 2002, p. 42.
[45] Ibid., p. 37-38. Moscovici propose ce qu’il appelle une technologie politique, dont l’objet est précisément de faire de tels choix dans les domaines des sciences et des techniques. Voir S. Moscovici, De la nature. Pour penser l’écologie op. cit., p. 46 et 217 et Essai sur l’histoire humaine de la nature, op. cit.,, p. 539-540.
[46] F. Dagognet, Considération sur l’idée de nature, op. cit., p. 169.
[47] Ibid., p. 198-207.
[48] Voir D. Worster, Les pionniers de l’écologie, Nature’s Economy, Le sang de la terre, 2009 (1977) et J-P. Déléage, Histoire de l’écologie. Une science de l’homme et de la nature, La découverte, 1991.
[49] F. Dagognet, Considération sur l’idée de nature, op. cit, p. 181-183.
[50] F. Dagognet, Des détritus, des déchets, de l’abject. Une philosophie écologique, Les empêcheurs de penser en rond, 1997, p. 93.
[51] « Le moteur végétal gaspille les ressources dont il dispose […] Il constitue l’ « usine » la plus mal gérée qui soit. ( F. Dagognet, Des révolutions vertes. Histoire et principes de l’agronomie, op. cit., p. 156).
[52] Par agrobiologie, il entend agriculture chimique hydroponique, tout le contraire de l’actuelle agro-écologie.
[53] Ibid., p. 171.
[54] « Désormais, le champ n’est plus réorganisé ni corrigé, ni fertilisé : il est supprimé. » in ibid., p. 156.
[55] Ibid., p. 157.
[56] Ibid., p. 171.
[57] Ibid., p. 154.
[58] F. Dagognet, Considérations sur l’idée de nature, op. cit., p. 138.
[59] Ibid., p. 158.
[60] F. Dagognet, Des révolutions vertes. Histoire et principes de l’agronomie, op. cit., p. 169.
[61] Ibid., p. 171.
[62] Ibid., p. 14. Ce « techno-providentialisme » est construit sur une appréciation sans nuance du passé, fait « de stagnation et de famines ». Autre témoignage de la sûreté de ses jugements : il juge la très forte concentration des terres agricoles qui se déroule depuis l’après-guerre de manière favorable, comme « un moment inévitable de l’histoire » et à propos du capitalisme, il estime que « peu à peu celui-ci s’éliminera. » ibid., p. 171 (voir aussi p. 153-154), p. 166 et 169.
[63] Par exemple par G. Balandier, Le grand système, Fayard, 2001, p. 20.
[64] C. Bouton, B. Bégout (dir.), Penser l’histoire, de Karl Marx aux siècles des catastrophes, Editions de l’Eclat, 2011, p. 202.
[65] Plus généralement, à propos des attributs généraux du progrès et plus spécifiquement sur la dimension « messianique » du progressisme, voir Pierre-André Taguieff, Le sens du progrès. Une approche historique et philosophique, Flammarion, 2004.
[66] Gorz a également insisté sur ce point capital de la critique des sociétés industrielles, sous l’influence d’Ivan Illich, en forgeant les notions de technologies-verrou et technologies-carrefour qu’il applique notamment au nucléaire, « l’électro-fascisme », voir André Gorz, Ecologie et politique, op. cit., p. 111-128. Dès les années 1930, Charbonneau a mis en cause le progrès comme « mythe », au sens d’un temps historique qui se présente ouvert et dont la délibération sur son contenu est théoriquement possible mais pratiquement impossible : dominé par la logique profonde de rationalisation, le progressisme dans sa variante « futuriste », l’idéologie d’accompagnement des sociétés industrielles, a une forte composante réactionnaire : il forclot les possibles historiques et rejoue, sur un autre registre, l’hétéronomie des sociétés du passé. Le devenir, censément indéterminé, est pris dans la nécessité historique d’un certain développement techno-marchand.
[67] F. Dagognet, De la nature, op. cit, p. 46-51
[68] Bien qu’il se défende d’être productiviste, voir Ibid., p. 10.
[69] F. Dagognet, L’essor technologique et l’idée de progrès, op. cit., p. 4.
[70] Ibid., p. 6.
[71] F. Dagognet, L’invention de notre monde, op. cit., p. 120.
[72] Ibid., p. 156.
[73] Ibid., p. 158.
[74] Ibid., p. 183, 184 et 185, voir une position identique dans F. Dagognet, L’essor technologique et l’idée de progrès, op. cit., p. 125.
[75] S. Barles, « Ecologie industrielle » in Dictionnaire de la pensée écologique, D. Bourg et A. Papaux, Puf, 2015, p. 330-332.
[76] J.B. Fressoz, « La main invisible a-t-elle le pouce vert ? Les faux-semblants de « l’écologie industrielle » au XIXe siècle », Techniques & Culture 2016/1 (n° 65-66), p. 324-339.
[77] Voir Sabine Barles, L’invention des déchets urbains. France 1790-1970, Champ Vallon, 2007.
[78] François Dagognet, Des révolutions vertes. Histoire et principes de l’agronomie, op. cit., p. 11
[79] Vladimir Vernadsky, « L’autotrophie de l’humanité », Revue générale des sciences, 1925, 36, p. 495-502. Les citations suivantes en sont extraites.
[80] Bruno Latour, « Arrachement ou attachement à la nature ? », Écologie politique, n° 5, Hiver 1993, p. 15-26 ; Emilie Hache « Retour sur Terre », in Emilie Hache (dir.), De l’univers clos au monde infini, Dehors, 2014.
[81] F. Dagognet, Considérations sur l’idée de nature, op. cit., p. 127
[82] On pourra se reporter à M. Gauchet, « Sous l’amour de la nature, la haine des hommes », Le Débat 1990/3 (n° 60), p. 247-250 ; L. Ferry, Le nouvel ordre écologique, Paris, Grasset, 1992 ; P. Pelletier, L’imposture écologiste, Géographiques Reclus, 1993 ; D. Lecourt, Contre la peur, PUF, 1990 ; A. Berque, Médiance, Géographiques Reclus, 1991.
[83] Dans Technocritique. Du refus des machines à la contestation des technosciences, La découverte, 2014, François Jarrige brosse un ample portrait des multiples résistances opposées au « progrès technique » de l’ère préindustrielle jusqu’au début du XXIe siècle. En s’appuyant sur un vaste corpus d’auteurs écologistes, Fabrice Flipo a proposé une confrontation entre l’écologisme et les deux grandes philosophies politiques de la modernité, le « marxisme » et le « libéralisme ». (F. Flipo, Nature et politique. Contribution à une anthropologie de la modernité et de la globalisation, Éditions Amsterdam, 2014). Pour une approche rigoureuse et profonde, centrée notamment sur le XIXe siècle et le lien entre la critique socialiste, anarchiste et la pensée « pré-écologiste », voir S. Audier, La société écologique et ses ennemis. Pour une histoire alternative de l’émancipation, La découverte, 2017.
[84] Ibid., p. 5-94.
[85] Victor Petit, Bertrand Guillaume. « We have never been wild: Towards an ecology of the technical milieu », in S. Loeve, X. Guchet, B. Bensaude-Vincent (eds) French Philosophy of Technology, Springer, 2018, p. 81-100.
[86] Inventée par le biologiste Bill Mollison et l’essayiste David Holmgren. Voir « Permaculture » in Dictionnaire de la pensée écologique, op. cit., p. 759-762
[87] Sur la productivité et la validité économique des fermes de permaculture, voir étude de l’INRA : S. Guégan et F. Léger, Maraîchage biologique permaculturel et performance économique, 2015. Sur l’expérience de la ferme étudiée, voir le livre écrit par le couple de producteurs P. et C. Hervé-Gruyer, Permaculture. Guérir la terre, nourrir les hommes, Actes Sud, 2014.