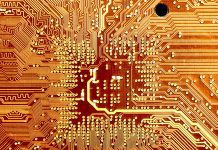Ce texte est une réponse à un article de Jocelyne Porcher, publié dans la revue Terrestres, dans lequel celle-ci revient sur la production artificielle de viande. L’autrice de cet article, Élodie Vieille Blanchard, est présidente de l’Association végétarienne de France.
C’est une image apocalyptique qui nous saute à la gorge, paysage de béchers violacés, en négatif sur fond noir. Symbole de chimie, de laboratoire, d’artificialité. Les mots ne sont pas moins frappants. Rien que dans le titre, trois expressions nous saisissent : « manger in vitro », « vivre sans les animaux », « un projet inhumain ». Qui voudrait d’un tel monde ? Dans le corps de la tribune de Jocelyne Porcher, parue en octobre dans Terrestres et consacrée à ce que serait un monde qui cesserait de mettre à mort les animaux pour les manger, d’autres mots aussi provocants : « mort-vivant », « détruire tout un pan de notre culture multi-millénaire », « barbarie », « rupture avec la vie »…
Ce déluge d’affects et d’angoisses en dit certainement beaucoup sur la manière dont l’auteure perçoit à la fois les revendications animalistes, qui ont gagné en résonance dans l’espace public au cours des dernières années, et l’avenir qu’elles peuvent dessiner. L’objectif de cet article est de démêler les idées des fantasmes, et de reposer les termes du débat, afin de créer un espace de discussion factuel et posé sur la viande cellulaire, mais aussi sur l’exploitation animale.
Storytelling et défense du morceau de viande
Cela fait une quinzaine d’années que Jocelyne Porcher, ancienne éleveuse devenue sociologue, s’attèle à faire tenir ensemble deux idées intuitivement contradictoires : que nous pouvons à la fois aimer les animaux et les tuer pour les manger. Tandis que la première idée engendre spontanément le rejet de la consommation de viande chez bon nombre de nos congénères (« Les animaux sont mes amis… et je ne mange pas mes amis » aurait dit l’écrivain britannique George Bernard Shaw, végétarien notoire), et tandis que l’association de la pensée « j’aime les animaux » et du comportement « je mange de la viande » génère un inconfort psychique scientifiquement éprouvé, dans de nombreuses études de psychologie cognitive (on parle alors de « dissonance cognitive »1), Jocelyne Porcher œuvre inlassablement à réunir ces deux morceaux de puzzle rétifs à l’assemblage. Sa démarche repose tout d’abord sur la mise en avant d’une dichotomie : il y aurait d’un côté les « productions animales », régies uniquement par l’exigence de rentabilité, que Porcher condamne, et de l’autre « l’élevage », qu’elle valorise. Est associée à cette vision une théorie du don et contre-don : nous offririons aux animaux « une vie bonne », du moins dans le cadre de « l’élevage », et ils nous offriraient leur vie en retour2.
À moins de se refuser à toute empathie envers les animaux, ou de s’inscrire dans une logique strictement économique, au mépris de toute autre considération, il apparaît difficile de ne pas condamner l’élevage industriel et tout ce qu’il implique pour les animaux : mutilations, confinement, etc. Selon un sondage mené par l’association CIWF, 87% des personnes interrogées se disent opposées à ce type d’élevage. Dans le même temps, l’attachement à l’alimentation carnée demeure très prégnant dans la population française. On peut penser qu’il en est de même parmi les représentants du monde académique. Tandis que la plupart des spécialistes anglo-saxons d’éthique animale, à l’image de Peter Singer ou Tom Regan, considèrent qu’il n’est pas juste d’exploiter les animaux pour les manger, bon nombre d’intellectuels français construisent des théories alambiquées pour justifier la légitimité morale à manger de la viande3, ce qui s’avère parfois acrobatique lorsqu’on ne dénie pas la conscience affective aux animaux. Par exemple, que nous nous érigerions au-dessus des autres espèces en refusant notre statut de carnivore (Dominique Lestel4), que nous renoncerions ainsi à notre culture et à notre histoire civilisationnelle, ou bien que l’ « arrangement » conclu avec les animaux serait équitable et juste (Jocelyne Porcher5).
À mon avis, la distinction faite par Porcher entre élevage et productions animales peut se comprendre si on admet sa volonté de mettre en avant son indignation pour les pires maltraitances faites aux animaux, et dans le même temps son goût pour la viande6. Il s’agit de condamner certaines méthodes d’élevage, certaines pratiques d’abattage, sans remettre en question la légitimité à exploiter et tuer les animaux pour des sociétés comme la nôtre, qui n’en dépendent aucunement pour leur subsistance. Dans le monde intellectuel, mais aussi dans un certain milieu politique concerné par les souffrances animales7 ou défenseur de l’agriculture paysanne, ce discours séduit beaucoup. Cependant, la vision dichotomique qu’il porte résiste très peu à l’examen. Il existe en effet un continuum entre les productions animales les plus industrielles et l’élevage paysan le moins violent pour les animaux, entre lesquels on ne peut pas établir une frontière étanche. Ainsi par exemple, en France, les veaux issus des vaches laitières bio se retrouvent souvent dans des élevages conventionnels, où ils sont engraissés jusqu’à leur mort à un très jeune âge. De même, les poules pondeuses bio proviennent la plupart du temps des mêmes couvoirs industriels que les poules élevées en batteries de cages. Tous ces animaux sont abattus à la chaîne, et souvent saignés conscients8, après avoir été « étourdis » au moyen d’un pistolet qui leur perfore le crâne, d’une pince qui les électrocute, ou d’un gaz qui les asphyxie. Ils sont abattus dans leur pleine enfance, ainsi des cochons, qui pourraient vivre jusqu’à 20 ou 30 ans, et que Porcher propose de tuer à un an et demi, plutôt qu’à six mois comme dans l’élevage industriel9.
S’il s’agissait pour Porcher d’appeler à un boycott radical des produits issus de l’élevage industriel, j’approuverais pleinement un tel discours, dont l’application conduirait à réduire drastiquement la souffrance animale (en France, 80% des animaux sont issus des productions intensives), mais aussi toutes les dégradations écologiques associées. Quand bien même je ne souscrirais pas à sa défense de « l’élevage », il me semblerait très positif d’amorcer un tel changement de modèle alimentaire. En réalité, si Porcher condamne la consommation de viande industrielle, elle consacre surtout son énergie à la promotion de la viande issue de l’élevage paysan et semble assez réticente à appeler à consommer globalement moins de viande10, une prescription pourtant consensuelle aujourd’hui lorsqu’on envisage l’impact écologique de l’élevage.
À présent, comment aborder la théorie du don et contre-don, qui est exposée dans chacun des écrits de Porcher ? Aborder le premier sens de ce modèle (le « don ») conduit à remettre en avant les éléments présentés plus haut. Dans un article qui dissèque finement les arguments de la sociologue, le philosophe Enrique Utria rappelle que « la vie « bonne » promue par Porcher correspond [pour les animaux] à une vie châtrée ou mutilée, séparée socialement, confinée territorialement, et que la durée de cette vie est susceptible de correspondre à un vingtième de leur espérance de vie »11. Comment considérer une telle vie comme un cadeau, et comment la voir comme par essence supérieure à la vie des animaux sauvages, ce que Porcher fait valoir dans ses écrits12 ? Pour ce qui est du deuxième sens de ce modèle, comment voir comme « contre-don » ce qui est en réalité un arrachement violent de la vie aux animaux, lorsque leur comportement à l’abattoir démontre leur terreur, lorsqu’ils tentent de toutes leurs forces de s’enfuir13 ?
La vision fantasmée d’un projet transhumaniste, au service des multinationales
À cette vision romantisée de l’élevage, Jocelyne Porcher oppose un projet prétendument soutenu par les associations animalistes, celui « d’effacement des animaux de la production alimentaire grâce aux biotechnologies ». Selon elle, ces associations travailleraient à « mettre l’accent sur la violence industrielle en arguant qu’elle est inhérente à l’élevage lui-même et [à] promouvoir une seule voie alternative, se passer complètement des animaux via le véganisme et plus concrètement d’ici quelques années via la viande in vitro et les produits de l’agriculture cellulaire. » Ce qui suggère que les associations animalistes œuvreraient activement à la promotion de l’agriculture cellulaire14. C’est une idée qui est souvent colportée par les défenseurs de l’élevage. En 2014, j’ai été interpellée à plusieurs reprises sur la question de la viande cellulaire, à la suite de la publication de l’ouvrage-débat Faut-il arrêter de manger de la viande ?, co-signé avec René Laporte, du Syndicat de la viande. Ignorante à l’époque des développements sur le sujet15, j’ai vigoureusement dénié l’idée que les associations animalistes et végétariennes soutiendraient un tel projet, qui me semblait un peu fou, et à vrai dire assez effrayant. Depuis, j’ai pu percevoir à plusieurs reprises le lien qui était fait par les défenseurs de l’élevage entre le projet d’un monde végane et celui de la culture cellulaire de viande, de manière plus fantasmée que réellement documentée.
Dans ce contexte, je me suis intéressée de près au sujet16. Il est avéré que le développement de la viande cellulaire est soutenu activement par la plupart des organisations animalistes états-uniennes, au motif que la croissance actuelle de la demande de viande, à l’échelle mondiale, est insoutenable sur le plan écologique, et qu’il serait plus difficile de changer les consciences que de développer des technologies permettant de produire de la viande sans passer par les animaux. Ces technologies remplaceraient l’élevage intensif, ultradominant dans les pays qui consomment le plus de viande, qui considère les animaux comme des machines à produire de la chair, sans aucun égard pour leurs intérêts et leurs besoins. Afin de maximiser la conversion de protéines végétales (l’alimentation des animaux) en protéines animales (leur chair), ce mode d’exploitation animale recourt à la modification génétique, aux antibiotiques, à l’éclairage artificiel, et contraint drastiquement les déplacements des animaux, qui sont également mutilés, et abattus à un âge très jeune. Puisque les bêtes y sont considérées strictement comme des machines à produire des cellules, il s’agirait de court-circuiter l’étape qui consiste à les faire naître (par insémination artificielle) avant de les faire grossir (le plus vite possible) puis de les égorger. Sur ce point, Jocelyne Porcher n’a pas tort, la viande cellulaire peut apparaître comme un prolongement logique de la zootechnie17.
Cependant, il n’est pas du tout exact que les associations animalistes et véganes européennes soutiendraient le développement de cette technologie, lorsqu’elles font la promotion d’une alimentation végétale, aussi bio et locale que possible, et peu transformée. Il n’y a qu’à consulter les sites « cuisine » des associations françaises les plus importantes, 1·2·3 Veggie pour l’AVF, et Vegan Pratique pour L214, pour s’en rendre compte. À l’AVF, nous n’avons pas encore statué sur le sujet de la viande cellulaire, qui nous apparaît comme particulièrement complexe. Idéalement, nous aspirons à un monde qui consomme des légumes, céréales, légumineuses, fruits et oléagineux issus d’une agriculture bio, paysanne et équitable. Mais nous nous efforçons aussi de faire preuve de pragmatisme : en admettant que la production de viande par culture cellulaire permette effectivement de réduire drastiquement l’impact écologique et la souffrance animale, faudrait-il se passer de cette solution, qui est promue par les associations animalistes outre-Atlantique non comme la solution unique à tous les problèmes du monde, mais comme une solution parmi d’autres à la pression croissante sur les ressources, générée par l’accroissement de l’effectif humain sur Terre, et le changement de modèle alimentaire à l’échelle de la planète18 ?
Pour nous autres représentants d’associations pragmatiques, qui cherchons à agir de la manière la plus efficace possible pour stimuler et accompagner la transition alimentaire, il s’agit en permanence de renégocier la position du curseur, sur l’axe idéalisme-pragmatisme. Les enjeux sont très importants, tant sur le plan de la souffrance animale (chaque jour, 3 millions d’animaux sont égorgés dans les abattoirs français) que sur le plan écologique (l’élevage est massivement émetteur de gaz à effet de serre, et lourdement consommateur de terres agricoles, de ressources énergétiques et d’eau potable). La transition alimentaire vers un modèle plus végétal est donc aujourd’hui perçue comme l’un des moyens les plus efficaces de réduire notre impact sur la planète. Afin de choisir les stratégies les plus pertinentes, il s’agit d’évaluer la propension de nos condisciples à changer d’alimentation, l’acceptation sociale potentielle des produits de culture cellulaire, mais aussi l’impact écologique réel de ces produits, qui apparaît en réalité plus lourd que ce qu’annoncent leurs promoteurs19. Le tout, évidemment, en prenant au sérieux les effets potentiels sur la société du développement de ces produits, et notamment la possibilité de perdre des emplois agricoles, au profit d’emplois industriels20. En résumé, il ne s’agit pas d’adopter naïvement ou de rejeter viscéralement cette approche (en qualifiant la viande cellulaire de « prototype du mort-vivant » comme le fait Jocelyne Porcher), mais plutôt de réfléchir posément au développement de ces produits, en gardant une vigilance sur son impact potentiel. Qualifier les défenseurs des animaux d’ « idiots utiles » de la fondation Bill Gates, au motif que celle-ci soutient financièrement les startups engagées dans la viande cellulaire, me semble couper court à toute réflexion sur les intentions des acteurs à l’origine de ces startups, qui sont le plus souvent des entrepreneurs sérieusement préoccupés par la crise écologique en cours, mais également sur les potentiels bénéfices de ces entreprises.
Dans une optique conséquentialiste chère à l’altruisme efficace21, qui inspire ces acteurs, il s’agirait d’évaluer les effets écologiques réels de telle ou telle démarche, plutôt que de la « démoniser » au motif qu’elle servirait aux intérêts du grand capital. De fait, dans les débats actuels autour de l’essor de l’économie végane, les promoteurs de l’altruisme efficace mettent en avant les bénéfices d’une alimentation végétale industrielle sur une alimentation animale industrielle : « toutes choses égales par ailleurs, ne vaut-il pas mieux que Nestlé investisse dans les protéines végétales, plutôt que de se cantonner aux protéines animales ? ». Cette remarque pragmatique ne doit pas nous dédouaner d’une réflexion approfondie sur le modèle de société que nous voulons construire : quels types de structures et d’organisations voulons-nous favoriser pour la production et la distribution alimentaires ? Les visions structurées d’un avenir agricole qui prenne en considération à la fois les questions liées à la ruralité, à la condition animale et à la durabilité sont encore rares, cependant les expérimentations développées au Royaume-Uni autour de l’agriculture bio-végane me semblent tout à fait riches et stimulantes, en ce qu’elles cherchent à conjuguer insertion sociale dans la production alimentaire locale, soutenabilité écologique et refus de l’exploitation animale22. Il me semble que les tensions, réelles ou ressenties, entre le projet d’un monde végane et la réappropriation citoyenne de la production alimentaire, peuvent donner lieu à une riche réflexion sur le modèle agricole de demain. Il nous appartient d’inventer un projet qui réponde à des aspirations diverses, de manière créative et collaborative.

Sortir de l’exploitation animale, un projet inhumain ?
Pour condamner le véganisme, et, au-delà, le projet d’un monde végane, Jocelyne Porcher y associe implicitement deux caractéristiques : un modèle alimentaire fondé sur les biotechnologies d’une part (voir plus haut) et la disparition des animaux domestiques d’autre part. Condamnant ces deux aspects, elle considère condamner ainsi le véganisme. Or l’essor actuel du véganisme dans de nombreux pays industrialisés ne s’accompagne pas de la consommation de produits issus de la culture cellulaire, qui ne sont pour l’instant commercialisés nulle part. Loin de favoriser les produits issus des biotechnologies, il semble que les véganes soient davantage préoccupés par les enjeux écologiques23, et favorisent la consommation de produits biologiques.
Pour le reste, il est évident que, si nous devenions tous véganes, une grande partie des animaux pourraient disparaître de nos paysages. Jocelyne Porcher montre involontairement, en évoquant d’une part l’ouvrage Zoopolis (qui envisage la possibilité d’offrir aux animaux domestiques un statut de citoyenneté) puis le prétendu projet des « abolitionnistes » (qui serait de faire disparaître totalement les animaux de nos sociétés), que le sujet ne fait pas consensus parmi les animalistes. La réflexion sur ce que pourraient devenir nos relations avec les animaux dans un monde post-exploitation est d’ailleurs embryonnaire, et Zoopolis constitue sa première pierre significative. Dans un contexte où la production de viande croît considérablement à l’échelle mondiale, la réflexion sur un tel monde constitue encore une expérience de pensée, certes stimulante, davantage qu’un projet politique concret.
Pour Porcher, une société qui n’exploiterait plus les animaux serait « inhumaine », et la sortie de cette exploitation « extrêmement violente ». Le refus d’exploiter les animaux et de les tuer pour satisfaire nos désirs alimentaires serait selon elle un « refus de la mort », qui préparerait l’ « homme augmenté » et le transhumanisme. Mais le véganisme n’est pas le refus de la mort, c’est le refus de l’assujettissement total d’êtres sensibles par les humains, qui implique leur création (par insémination artificielle, dans la quasi totalité de l’élevage), leur maintien dans des conditions propices à l’exploitation de leurs produits (chair, lait, cuir…), impliquant le plus souvent l’enfermement, puis leur exécution, dans la peur et la douleur. Ce n’est pas que nous n’assumons pas la mort des animaux, ou notre propre mort, c’est tout simplement que nous condamnons l’idée que cet assujettissement serait légitime, et que nous le voyons comme une version particulièrement abjecte du droit du plus fort. Au cours des derniers mois, j’ai pu entendre à plusieurs reprises de la bouche des défenseurs de l’élevage ce genre d’élément de langage (« oui, c’est vrai que nous devons tuer les animaux, mais tout le monde meurt »). J’ai été frappée par la malhonnêteté de l’argument, qui en tout état de cause, justifie le meurtre (puisque la victime d’un meurtre finira bien par mourir un jour, nous ne ferions que lui prendre sa vie par anticipation, ce qui ne serait pas bien grave).
Porcher nous explique aussi que le passage à la viande in vitro signerait le passage à du « travail mort » dans nos relations avec les animaux, tandis que « travailler avec les animaux, même en systèmes industriels, reste[rait] de l’ordre du travail vivant ». Je trouve particulièrement surprenant que Jocelyne Porcher défende ici implicitement l’élevage industriel, qui serait préférable à la production de viande cellulaire, lorsqu’on connaît les souffrances qu’il engendre chez les animaux, mais également chez les travailleurs des fermes industrielles et des abattoirs, dont le quotidien est très difficile. Est-ce que le besoin qu’a l’être humain, selon Porcher, de passer du temps avec les animaux, peut justifier l’exploitation et la mise à mort de créatures sensibles ? « Tout sauf imaginer la fin de l’élevage », tel semble être le motto de la sociologue, qui refuse délibérément d’envisager d’autres voies. C’est ainsi que Porcher répondait à la question poignante d’une jeune fille de 17 ans, qui l’interpellait sur son rejet du véganisme24, dans un débat organisé en janvier dernier par France Culture : « Je ne serai pas végane, et jamais, parce que j’aime les animaux, j’aime profondément les animaux, et je préfère devoir ma vie aux animaux plutôt qu’à la vitamine B12 ou à la Fondation Bill Gates ».
Imaginer un monde végane
Si le véganisme, dans sa forme contemporaine, est apparu au milieu du 20e siècle (avec la fondation de la Vegan Society, en Angleterre, en 1944), il a longtemps consisté en un engagement individuel, manifestant le refus de contribuer à l’exploitation animale. La mobilisation pour créer un monde sans exploitation animale remonte, quant à elle, à une dizaine d’années. Elle se traduit par exemple par l’organisation de « marches pour la fermeture des abattoirs » (en 2018, 35 marches ont été organisées à l’échelle de la planète). Quant à la réflexion sur ce que serait un monde végane, elle est également récente. Le devenir de nos relations avec les animaux constitue un pan important de cette réflexion, mais il n’est pas le seul : il s’agit aussi de penser les aspects économiques, agricoles, ou culturels d’une telle évolution. C’est pour rassembler les éléments d’exploration sur ce sujet que j’ai travaillé sur l’ouvrage Révolution végane, publié en septembre dernier. Des interviews que j’ai menées, des éléments prospectifs que j’ai rassemblés, il est ressorti qu’un tel monde présenterait de très nombreux bienfaits, tant en termes écologiques qu’économiques, ou de santé publique, du moins à l’échelle des pays industrialisés ou en voie d’industrialisation, qui contribuent le plus à l’explosion de l’élevage sur Terre, et à tout son cortège de nuisances (actuellement, l’humain et les animaux d’élevage constituent 96% de la masse des vertébrés sur Terre, au détriment des espèces sauvages, et de la biodiversité en général).
Évidemment, de grandes questions surgissent, et notamment celle du devenir de nos relations avec les animaux, dans un monde qui ne les exploiterait plus. Will Kymlicka et Sue Donaldson, les auteurs de Zoopolis25, ont proposé de repenser nos relations avec les animaux en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent (animaux domestiques, sauvages ou liminaires26). En particulier, nous pourrions inventer de nouvelles relations avec les animaux domestiques, qui se fonderaient davantage sur la réciprocité, ce qui impliquerait de prendre soin d’eux, et en particulier de ne pas prendre leur vie pour satisfaire à nos désirs personnels. Cet interdit moral du meurtre, « expression ultime de la violence »27 comme anéantissement d’autrui, figure parmi les prescriptions de la plupart des religions, mais aussi de textes qui fondent la vie commune des êtres humains, comme la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans sa version positive de « droit à la vie ». Étendu aux animaux, ou en tout cas à tous ceux qui sont reconnus comme disposant d’une conscience affective, il constitue un pilier de l’éthique animale28. Les auteurs de Zoopolis ne récusent pas l’idée que les animaux pourraient nous rendre certains services (comme l’entretien des paysages, par exemple). En revanche, ils tracent une ligne rouge entre utilisation et commercialisation des produits issus des animaux, cette dernière conduisant immanquablement, selon eux, à une instrumentalisation des animaux, dans le but de maximiser la rentabilité. Dans sa tribune, Jocelyne Porcher qualifie la proposition de Donaldson et Kymlicka d’ « illusion », sans justifier sa position. On aurait souhaité qu’elle développe davantage.
Il s’agit dans cette réflexion, et plus globalement dans la réflexion animaliste autour du véganisme, de concevoir nos relations avec les animaux dans un cadre qui soit mutuellement bénéfique, d’inclure véritablement ces frères et sœurs non humains dans notre considération, et de revoir l’organisation de nos sociétés sur cette base. Cette approche englobe et prolonge le projet d’une société fondée sur le refus du racisme, du sexisme et de toutes les discriminations. Il s’agit d’envisager un humanisme « inclusif » qui prenne véritablement en compte les intérêts des animaux29, et en particulier l’intérêt à ne pas être tué, plutôt que de rejeter dos à dos leurs intérêts et ceux des humains. Il me semble qu’un tel projet devrait nous mobiliser avec enthousiasme, plutôt que de cristalliser nos peurs du changement : quelle opportunité plus fructueuse de refonder nos sociétés sur la durabilité et la prise en compte véritable d’autrui, dans sa singularité et sa différence ?
Notes
- Martin Gibert, Voir son steak comme un animal mort, Lux, Montréal, 2015.[↩]
- Jocelyne Porcher, Vivre avec les animaux, La Découverte, Paris, 2011. [↩]
- Thomas Lepeltier, L’imposture intellectuelle des carnivores, Max Milo, Paris, 2017.[↩]
- Dominique Lestel, Apologie du carnivore, Fayard, Paris, 2011. [↩]
- Jocelyne Porcher, op. cit. [↩]
- « J’aime les cochons, mais j’aime aussi la côte de porc gascon ou limousin. […] La viande d’un cochon de bonne race, bien élevé et tué dignement [sic], est un régal sans équivalent. » Jocelyne Porcher, « J’aime la compagnie des cochons… et la côte de porc gascon », Causeur, n° 38, septembre 2016, p. 67, citée par Lepeltier, ibid., p. 58.[↩]
- Ainsi de François Ruffin, qui dans un discours à l’Assemblée nationale, en mai 2018, appelant à réformer les pratiques de l’élevage, déclarait « manger un steack, boire du lait, me faire cuire un oeuf, je souhaite le faire sans honte, sans la crainte d’avoir engendré, derrière, tortures et souffrances, sans devoir me fermer la conscience. » https://francoisruffin.fr/cause-animale/[↩]
- Comme l’ont montré les nombreuses enquêtes de l’association L214 menées dans les abattoirs français depuis 2015.[↩]
- Enrique Utria, « La viande heureuse et les cervelles miséricordieuses », in Lucile Desblache (dir.), Souffrances animales et traditions humaines : rompre le silence, Presses universitaires de Dijon, 2014, p. 48.[↩]
- https://www.terraeco.net/La-question-n-est-pas-de-manger,54829.html, cité par Lepeltier, ibid., prologue.[↩]
- Enrique Utria, ibid., p. 48.[↩]
- Jocelyne Porcher, ibid., p. 35. [↩]
- Sur la résistance animale à l’enfermement et à l’abattage, https://blog.l214.com/2017/04/14/terrifiees-elles-sechappent-dun-abattoir[↩]
- Production de viande, poisson ou cuir par la culture de cellules animales. [↩]
- Les startups consacrées au développement de la viande cellulaire ont commencé à se développer dans les années 2010. [↩]
- Ce travail de documentation a conduit à la publication d’un dossier spécial intituléViande cellulaire et autres nourritures du futur, Alternatives végétariennes n°133, automne 2018. [↩]
- Une approche rationnelle de l’élevage développée au 19e siècle dans le but de maximiser sa rentabilité, et qui conçoit les animaux comme des machines à produire de la chair. [↩]
- Paul Shapiro, Clean Meat, Simon & Schuster, New York, 2018.[↩]
- Élodie Vieille Blanchard, « Viande cellulaire, quel impact écologique ? », Alternatives végétariennes, 133, automne 2018. [↩]
- Paul Shapiro, ibid.[↩]
- Philosophie et mouvement social qui cherche à déterminer rationnellement les moyens les plus efficaces de parvenir à un but donné, par exemple la réduction de la faim dans le monde, ou de la souffrance animale. https://altruismeefficacefrance.org/[↩]
- Par exemple : https://kindling.org.uk[↩]
- Renan Larue et Valéry Giroux, Le véganisme, PUF, Paris, 2017, p. 93.[↩]
- « Sachant que c’est pas économiquement viable, c’est pas écologiquement viable, c’est pas viable d’un point de vue philosophie de tuer un animal pour sa propre consommation, qu’est-ce qui nous empêche, qu’est-ce qui vous empêche de […] tester le véganisme ? ».[↩]
- Will Kimlycka et Sue Donaldson, Zoopolis, une théorie politique des droits des animaux, traduit de l’anglais par Pierre Madelin, Alma, Paris, 2016.[↩]
- Il s’agit des animaux qui partagent nos espaces de vie sans pour autant avoir été domestiqués, comme les rats ou les pigeons.[↩]
- Corine Pelluchon, Tu ne tueras point. Réflexions sur l’actualité de l’interdit du meurtre, Editions du Cerf, Paris, 2013. [↩]
- Yves Bonnardel, Thomas Lepeltier et Pierre Sigler (dir.), La Révolution antispéciste, PUF, Paris, 2018. [↩]
- Martin Gibert, ibid., pp. 171-174.[↩]